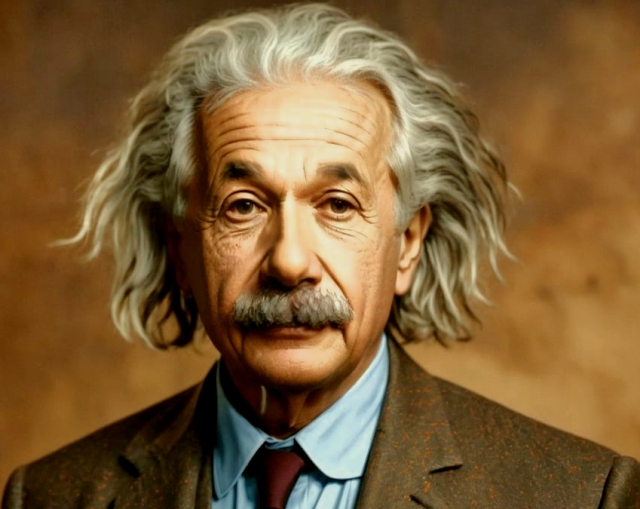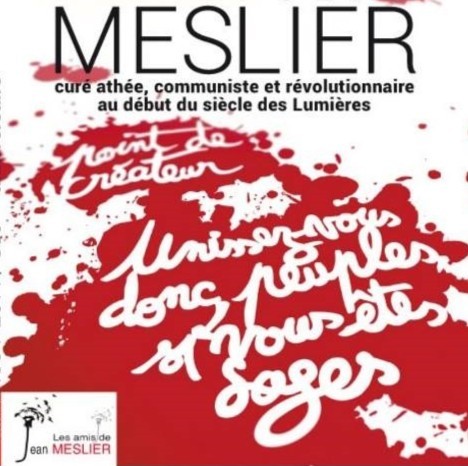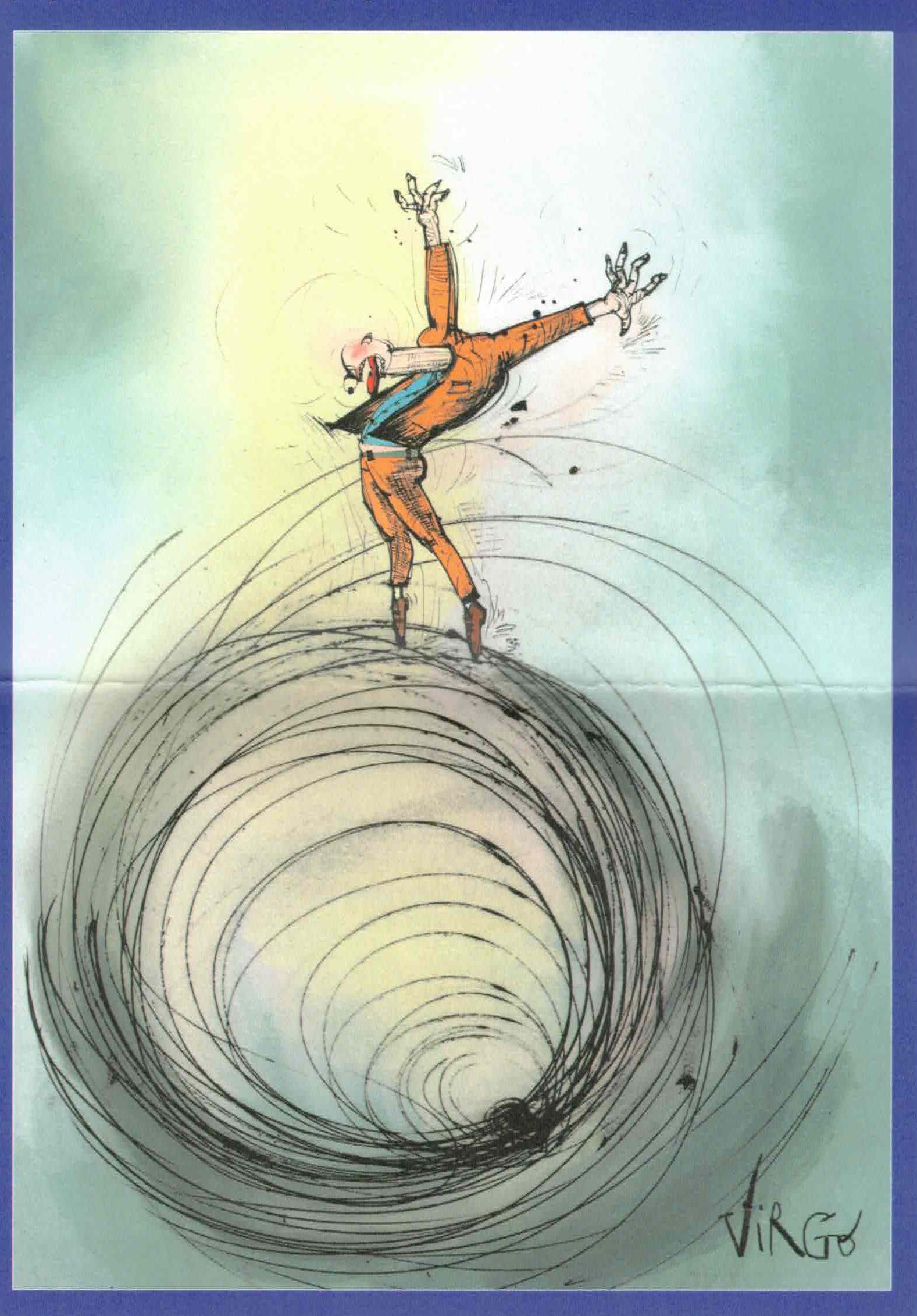
Débat : L’Intelligent Design est-il soluble dans l’anticléricalisme ?
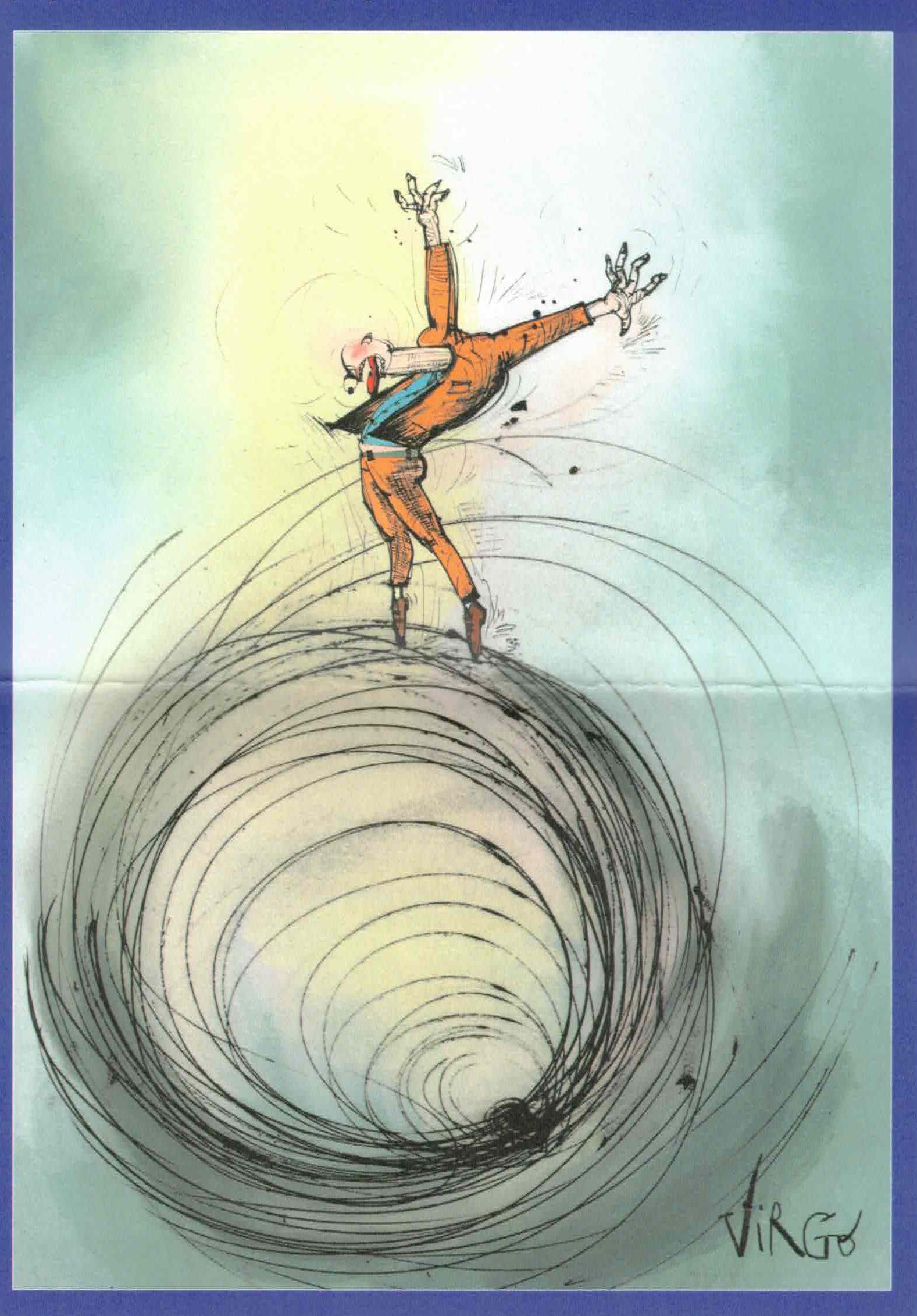
Dessin de Virgo (paris), paru dans Le Batia moûrt soû, n° 94, 1er juin 2025.
Notre ami Éric Delgla nous a fait part d’un point de vue profondément original, à propos de la légitimité du discours athée concernant les grandes questions métaphysiques – la matière et la vie, pourquoi et comment ? Il prend ses distances avec une des pierres de touche du discours athée, à savoir le refus de l’idée que l’histoire de l’univers, y compris la nôtre, aurait été planifiée par une intelligence supérieure, qu’on appelle généralement Dieu. Mais il insère ce plaidoyer pour l’Intelligent Design dans une philosophie anticléricale résolue. Cette combinaison inédite, presqu’un oxymore à nos yeux, est suffisamment inattendue pour nous inciter à la publier, mais elle demeure plus que problématique, ce qui justifie la réponse que nous lui avons adressée, signée par PG, et qui suit l’envoi d’Éric Delgla.
L’échange n’aura sans doute pas fait bouger les lignes : chacun campe sur ses positions. Ainsi, Éric Delgla nous a confirmé ses convictions dans un courriel qui nous remercie par ailleurs de l’intérêt accordé à sa communication initiale :
Je souscris à ce concept d’« intelligent design » mais je me refuse à lui donner un caractère divin. La science ne s’accordant pas sur l’existence de ce grand horloger, elle n’est d’aucun concours pour aider à le définir. J’ai donc laissé travailler mon imagination pour en trouver une définition cohérente, qui bien entendu n’engage que moi.
En observant notre époque, je constate que depuis quelques décennies, l’humanité commence à jouer au grand horloger. Manipulation génétique, prise en compte du dérèglement climatique et tentative de mise en place de mesures réparatrices, tentative par la Nasa de dévier de sa trajectoire l’astéroïde Dimorphos, autant d’initiatives nouvelles qui me confortent dans cette idée.
A mes yeux, l’humanité serait donc en capacité de devenir le grand horloger du prochain univers. En fait j’aurais du écrire : « le Vivant » serait donc en capacité…car l’humanité n’est que la forme de vie sur terre, ayant acquis une intelligence prospective. Le vivant reste à mes yeux un tout indivisible.
Et quant à nous, nous restons convaincus que si de nombreuses questions sont aujourd’hui encore en manque de réponses, ce n’est pas une fuite en avant, largement au-delà des procédés validés par les progrès des sciences, qui pourrait nous faire progresser dans l’élucidation des mystères de l’histoire du monde, biosphère comprise.
*
Dieu est une fake news
Éric Delgla
Introduction
Mon enfance a baigné dans la religion catholique. Pas dans une pratique rigoureuse, non, mais dans une pratique de tradition.
Dès l’adolescence, j’ai éprouvé des doutes quant à ce Dieu omniscient, omnipotent. Ce Dieu, père tout puissant qui laisse pourtant de par le monde, les drames se dérouler sans intervenir. On m’a répondu « les voies du seigneur sont impénétrables ». Cela ne m’a pas convaincu.
Une intuition lancinante me poussait à rester sur mes gardes.
Je voyais bien que ce concept de Dieu était bien trop pratique pour faire tenir les gens tranquilles. Je voyais bien qu’il y avait une certaine connivence entre pouvoir et religion.
J’éprouvais également des difficultés avec d’autres concepts inhérents à la religion catholique, notamment avec la vie après la mort, et la résurrection. Promesses gratuites, bien trop lointaines, qui n’engagent que ceux qui croient.
L’absolution des pêchés par la confession, procédé bien trop avantageux pour ne pas avoir été inventé par les hommes plutôt que par Dieu, me posait également problème.
Le fait que l’on dise que Dieu avait créé l’homme à son image, alors que tout me porte à croire que s’il y a eu une puissance créatrice elle ne doit sûrement pas avoir établi de hiérarchie. Elle a créé un tout, le ciel et les étoiles, l’inerte et le vivant. Dans un excès d’orgueil, après avoir cru que le soleil tournait autour de la terre, l’Homme avait cru que Dieu lui avait accordé une intention particulière….
La vie a passé. Je me disais athée et tout allait bien. Je me disais que plus la science progressait, plus les religions reculaient.
En fait non, tout n’allait pas si bien que ça. Depuis un siècle, malgré les progrès scientifiques en cosmologie, thermodynamique, physique, biologie, chimie et autres sciences, une partie non négligeable de la communauté scientifique, persiste dans l’idée qu’une force créatrice a été nécessaire pour le réglage précis du Big-bang, sans lequel notre univers n’aurait pu accueillir la vie.
Des scientifiques de renom disent aujourd’hui, que loin d’être une explosion aléatoire, le Big Bang était au contraire réglé avec une précision défiant toutes les probabilités. Ils expliquent que si une seule des constantes fondamentales de la physique (gravitation, vitesse de la lumière, zéro absolu, constante de Planck, etc.) avait été un tant soit peu différente, il aurait soit donné une « soupe cosmique » homogène, incapable de donner la vie, soit implosé aussi rapidement qu’il était apparu.
Difficile de concilier cette vision des choses avec un athéisme revendiqué.
A moins que…
Soyons rationnels
Trois hypothèses s’offrent à nous :
Soit Dieu a créé l’univers et la vie sur terre. Et ce Dieu, toujours présent doit inspirer notre conduite. Nous lui devons à la fois reconnaissance, respect et vénération.
Soit tout est dû au hasard. Après le chaos initial, l’univers s’est assagi et en quelques points une mutation de l’inerte au vivant s’est opérée. Il semble en effet possible, que compte tenu du milliard de galaxies qui composent notre univers, les conditions favorables soient réunies pour que la vie apparaisse en quelques points de l’univers. Dans ce cas, nous n’avons aucune reconnaissance à avoir envers quiconque.
Soit une intelligence supérieure a réglé certains paramètres afin que l’univers soit ce qu’il est, et, pour que dix milliards d’années après le Big-Bang, le passage de l’inerte au vivant soit possible. Cependant, tout porte à croire que cette intelligence supérieure n’est plus présente dans notre univers, car elle n’a pu s’y maintenir. Il n’y a donc pas lieu de la considérer d’essence divine.
Si nous lui devons reconnaissance et respect, il n’y a pas à lui porter vénération.
J’ai, pour ma part, évolué à travers ces trois hypothèses.
Face au nombre de questions sans réponses, j’ai du rechercher ailleurs les explications qui me faisaient défaut. Dernièrement la lecture de l’ouvrage de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies : Dieu. La Science. Les Preuves, m’a conforté dans l’idée, que la théorie d’un monde bâti sur le pur hasard, n’était plus soutenable. Mais cet ouvrage cherche tellement à faire feu de tout bois pour accréditer que la science prouve Dieu, que sûrement par esprit de contradiction, mes réflexions m’ont conduit à une conclusion diamétralement opposée à la leur.
Je me propose de vous faire partager ces réflexions.
La légende d’un Dieu créateur
Au commencement de l’humanité, il n’y a que les croyances pour expliquer l’incompréhensible. Les avancées scientifiques ne viendront que bien plus tard. Pendant des millénaires une prolifération de croyances locales va régenter sans partage l’organisation des sociétés humaines.
Au VIe siècle avant Jésus-Christ une évolution va s’amorcer au sein du peuple Hébreu. A rebours de tout ce qui se pratique alentour, ce peuple va ériger le culte d’un Dieu unique, omniscient et omnipotent. De ce premier monothéisme vont découler les trois religions que sont le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam. Ces trois religions regroupent aujourd’hui prés de la moitié des croyants.
Suivant les époques, les manifestations de Dieu prennent des formes différentes.
Auprès des Patriarches du peuple Hébreu, Dieu intervient en personne. C’est lui qui chasse Adam du paradis, c’est lui qui demande à Noé de construire une Arche en vue du déluge, c’est également lui qui guide Abraham vers le pays de Canaan et passe ensuite Alliance avec lui.
Avec Moïse, Dieu transmet son message par le truchement d’un buisson ardent qui ne se consume pas. Enfin avec Jésus-Christ et l’Archange Gabriel, Dieu utilise un intermédiaire pour transmettre sa parole.
Les messages délivrés sont rarement en langage clair, l’usage de métaphores ou de paraboles laissent une grande place à l’interprétation.
Les miracles, événements surnaturels considérés d’origine divine, sont aussi d’autres manifestations de Dieu. Peu nombreux dans la bible hébraïque, ils sont surtout présents dans le nouveau testament, où l’on peut en recenser plus d’une trentaine attribués à Jésus-Christ. Dans l’Islam, les miracles sont relégués au second plan, car seule prime la parole d’Allah.
Dans les trois religions, la légende est construite autour d’un Dieu toujours présent. Ce Dieu contemporain, témoin du comportement de chacun de nous, n’interfère pourtant pas dans notre quotidien.
Cela se saurait…
Penser le contraire est faire preuve de naïveté.
S’il en est besoin, permettez-moi une petite séance récréative qui viendra étayer cette affirmation.
Si un individu lance un dé à six faces un très grand nombre de fois, le nombre d’apparitions de chacune des faces sera très proche du nombre de lancers divisé par six. Autrement dit, aucune face ne sera avantagée. Cela résulte du principe mathématique de la loi des grands nombres, et toute action autre que le trucage du dé n’y changera rien. Les prières et appels à Dieu n’y changeront rien… Dieu est trop occupé, me direz-vous, pour se prêter à ce genre de distraction… et j’accepte volontiers votre remarque.
Mais cette loi des grands nombres est la base de toutes les études de probabilités. Elle est aujourd’hui omniprésente dans les nombreuses projections qui régissent nos sociétés.
Je n’ai pourtant jamais eu connaissance d’un statisticien, ayant invoqué une possible intervention divine pour justifier une prévision non conforme.
Dans son for intérieur, chacun de nous, a aujourd’hui conscience d’une relation de cause à effet, qui régit notre quotidien. Par exemple, si sur une portion du réseau routier très accidentogène, l’autorité responsable met en place des mesures de sécurité, telle qu’une réduction de la vitesse, on peut prédire avec une assez grande précision, le pourcentage de vies qui seront ainsi sauvées. Et on pourra vérifier cette prédiction. On pourra donc en attribuer le mérite à l’autorité décisionnaire.
Si au contraire, on décide de ne rien faire, si toutes choses restent égales par ailleurs, on verra le nombre de morts par accident se reconduire d’année en année. Dieu ne sera pas intervenu… Il s’agit pourtant là, non plus de jeu de dés, mais de vies humaines…
Il est donc flagrant que notre quotidien est régi par des lois naturelles, prédictibles, dans lesquelles le hasard a sa place. Seuls quelques faits résistent à notre compréhension, ce sont les tours de magie et les miracles.
L’intervention divine est pourtant sollicitée chaque jour par des milliers de ferventes prières. Mais pour quel résultat ?
Avec un récit datant de près de trois millénaires et rien de bien nouveau pour attester l’existence d’un Dieu omniprésent mais peu actif, il va devenir bien difficile de maintenir des églises dynamiques.
Combien de temps encore le croyant va-t-il accepter, pour fonder sa foi, un récit suranné, régulièrement en conflit avec les avancées scientifiques ?
Pour les contemporains d’Abraham, l’œuvre de Dieu est bien sûr perceptible, c’est l’univers visible, mais pas sa complexité, les connaissances de l’époque ne le permettent pas.
Les récits religieux de l’époque ont valeur scientifique et les conflits intellectuels à venir ne peuvent encore être envisagés. A cette époque, la terre est plate et c’est le soleil qui tourne autour de la terre.
Les écrits fondateurs sont une narration de faits historiques, dans le style de l’époque, souvent ambigu, laissant une large place aux paraboles, métaphores et allégories. L’écriture du VIe siècle avant Jésus-Christ est rare, limitée tant en supports qu’en scribes. Le narrateur n’est pas un témoin direct, il se contente bien souvent de transcrire des récits oraux qui lui ont été rapportés. La tentation d’enjoliver les faits, pour en faire un récit épique est sûrement très grande.
Ce Dieu qui s’est révélé aux hommes il y a maintenant trois millénaires s’est montré bien discret depuis, un émissaire par ci par là, quelques miracles et puis c’est tout. Nulle observation avérée ne vient témoigner d’une quelconque intervention divine.
Ce Dieu omniscient et omnipotent est surtout omnioisif, oui ! Il y a pourtant beaucoup à faire, le monde qu’il nous a légué était bien pour un départ de quelques milliers d’humains, mais il n’a pas été aménagé pour les milliards que nous sommes aujourd’hui ; en conséquence, il nous a fallu tout faire par nous- mêmes.
Ce n’est pourtant pas faute de l’avoir vénéré, pas moi, mais les milliards de croyants qui l’ont prié tous les jours, qui lui ont construit synagogues, mosquées et cathédrales remarquables. Pour quel résultat ?
Nous n’avons pas tout bien fait certes, nous avons un peu pollué, un peu nui à la biodiversité, un peu perturbé le climat. Et alors, nous a-t-il guidés ? Que nenni, aucun conseil, pas un signe… ou si peu.
Dieu se désintéresse-t-il du sort des siens ?
Une histoire juive résume bien cette situation :
Deux juifs âgés, assis sur un banc discutent pour passer le temps et font des blagues sur la Shoah, des blagues toutes plus horribles les unes que les autres. Dieu qui les écoute n’en peut plus et finit par descendre auprès d’eux pour les sermonner. Un des deux juifs, pas du tout intimidé lui répond : mais vous, vous ne pouvez pas comprendre, vous n’étiez pas là… !
Et oui, Dieu n’était pas là pendant la Shoah : Dieu est toujours présent mais n’intervient jamais. Les voies du Seigneur sont toujours aussi impénétrables…
Mais alors pourquoi le prier si fréquemment ?
Le récit religieux manque de crédibilité, que l’on soit athée ou croyant, cette constatation s’impose. Les théologiens disent qu’il faut interpréter les textes religieux, leur trouver parfois un sens caché. Mais pour s’affirmer, les trois religions abrahamiques s’accusent mutuellement de mauvaise interprétation. De quoi ébranler tout croyant qui s’autorise à y réfléchir un instant. Il est vrai que le croyant n’est pas incité à ce type de réflexion. La foi est au-delà de la raison…
D’autant que les théologiens s’offusquent peu quand ces mêmes textes sont présentés au premier degré par leurs prédicateurs, auprès de peuples primitifs, ou de jeunes enfants, deux publics peu ouverts au second degré…
Un monde sans Dieu
Les tenants d’un monde sans Dieu se distinguent au sein de deux courants principaux : les athées et les agnostiques. Les athées plaident pour l’inexistence de Dieu, les agnostiques considèrent que l’on ne peut prouver ni l’existence, ni l’inexistence de Dieu.
D’un premier abord j’aurais tendance à dire que les agnostiques ont une approche prudente et mesurée et que c’est eux qui sont dans le vrai. Mais en y regardant de plus près, je me dis que douter de l’existence de Dieu, n’est-ce pas déjà la rejeter ?
La distinction entre athéisme et agnosticisme me semble de peu d’intérêt, les deux courants cherchent une explication du monde sans Dieu. Les premiers l’affirment avec plus de conviction que les seconds, c’est tout.
D’après les croyants, nier Dieu obligerait, entre autres, à trouver une réponse cohérente aux deux questions majeures que sont l’origine de l’univers et l’apparition du vivant.
Je pense pour ma part qu’en la matière, la mise en avant d’hypothèses est une approche honnête et suffisante. La démarche scientifique a besoin de temps pour se construire. Il n’y a pas lieu d’apporter une réponse immédiate à tout. Je préfère un scientifique qui doute, mais qui cherche, à un religieux convaincu de sa croyance.
Fort de ces préalables, je vous propose donc un survol rapide des principales hypothèses qui ont été mises en avant par les non croyants.
L’origine de l’univers
Jusqu’au milieu du XXe siècle, l’expansion de l’univers n’était pas clairement établie. La majorité des scientifiques postulaient pour un univers stationnaire, qui n’avait donc ni début ni fin. De ce fait, le problème de sa création ne se posait pas.
Au milieu du XXe siècle, la confirmation de l’expansion de l’univers a posé un grave problème aux matérialistes, car cette expansion implique un début de l’univers donc une création. L’expansion de l’univers semble donner raison aux religieux, car eux ont une explication toute trouvée, et qui de plus est annoncée depuis des siècles. Reste cependant une nouvelle interrogation de taille : qui a créé dieu ?
Une autre hypothèse est, que même si la partie de l’univers que nous avons pu observer à ce jour, nous dit qu’il est en expansion, il se peut que l’univers dans sa globalité soit stationnaire, mais en expansion en certains endroits, stationnaire ailleurs et même en contraction en d’autres endroits, comme à l’intérieur des trous noirs.
Une troisième hypothèse est que cette expansion ne soit pas immuable. Il se peut qu’il y ait une alternance de phases d’expansion et de contraction. Une succession de Big Bang et de Big Crunch.
De nombreuses autres hypothèses pour s’exonérer d’une création de l’univers ont été un temps évoquées mais sans une grande force de conviction, comme par exemple la théorie du multivers (une multitude d’univers parallèles).
L’apparition de la vie sur terre
Deux hypothèses sont en la matière avancées par les tenants d’un monde sans Dieu : l’apparition spontanée de la vie sur terre en milieu favorable et une vie d’origine extraterrestre, apportée sur notre planète, par une des nombreuses météorites l’ayant percutée.
La théorie de la génération spontanée a été très largement répandue, elle remonte à Platon et Aristote et perdurera jusqu’à ce que Pasteur démontre que dans tous les cas supposés de génération spontanée, il y avait en fait des germes. C’est ainsi que, pendant longtemps, on a cru que les souris pouvaient naître spontanément d’un tas de détritus et les asticots d’un morceau de viande en décomposition.
Depuis le milieu du XXe siècle, de nombreuses expériences ont été tentées pour recréer les conditions de l’apparition de la vie sur terre. Plusieurs essais ont été menés sur des bouillons de produits chimiques soumis à des variations de température, à des décharges électriques et autres bouleversements externes. A ce jour ces expériences n’ont pas abouti, même si quelques acides aminés ont ainsi pu être synthétisés. Mais nous sommes très loin de l’apparition du plus simple organisme vivant.
Parallèlement, des molécules entrant dans la composition des organismes vivants ont bien été identifiées sur des comètes et des météorites. Une première origine extraterrestre de la vie n’est donc pas à exclure, mais la question n’est pas de trouver où cette prouesse a pu se dérouler, mais plutôt de comprendre comment elle a pu se produire.
Ces deux hypothèses restent donc plausibles, même si les récentes avancées scientifiques dans le domaine de l’infiniment petit, nous révèlent un monde d’une complexité inattendue.
Se questionner sur l’origine de l’univers et l’apparition de la vie, sont sûrement deux questions qui vont occuper les scientifiques et les philosophes, pendant encore bien des siècles. Car il ne suffira pas, de décrire une à une les phases nécessaires aux deux évolutions majeures que sont le passage du néant à quelque chose et le passage de l’inerte au vivant. Il faudra aussi expliquer le pourquoi.
Le doute des scientifiques
Au cours du dernier siècle, grâce aux avancées technologiques, les scientifiques du monde entier ont révolutionné la compréhension de l’univers.
Dans le domaine de l’infiniment grand, les observations de l’univers grâce aux télescopes spatiaux, notamment Hubble puis James Webb, ainsi que les modélisations informatiques, entre autres, ont permis d’infirmer ou de confirmer de nombreuses hypothèses.
Dans le domaine de l’infiniment petit, là aussi des progrès considérables ont eu lieu. Concernant la question de l’apparition de la vie sur notre planète, le dernier siècle écoulé a été porteur de découvertes majeures. Mais à ce jour, ces découvertes nous apportent plus de questionnements que de réponses. Les progrès dans les sciences de l’astrobiologie, qui œuvrent à la compréhension de la vie dans l’univers, nous ont révélé un monde du vivant d’une complexité insoupçonnée.
Dans ces deux domaines donc, de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, les scientifiques du monde entier ont conscience que la complexité de notre monde va encore, pour de nombreuses années, se dérober à leur compréhension.
Mais la connaissance scientifique progresse chaque jour et sur des bases de plus en plus solides, car confirmées et recoupées par des approches convergentes des différentes disciplines.
Notre univers a une histoire, qui a commencé avec sa naissance, le Big Bang, il y a 13,8 milliards d’années. Les phases suivantes, bien identifiées, ne doivent rien au hasard : apparition rapide des atomes légers, mais il a fallu 3,8 milliards d’années pour les atomes lourds, 8,8 milliards d’années pour que le soleil se forme, 10 milliards d’années pour que les formes les plus élémentaires de la vie apparaissent sur la Terre, etc. Le genre Homo n’a que 3 millions d’années.
Il est bien sûr possible que certains de ces chiffres soient corrigés dans le futur. Ils le seront chaque fois qu’une avancée nouvelle de la connaissance le rendra nécessaire. Cela ne pose pas de problème à la démarche scientifique, qui reste souple et ouverte en permanence aux évolutions, contrairement aux religions qui sont figées.
Face à cet agenda extraordinaire, dont les chiffres nous donnent le tournis, nous pouvons adopter deux attitudes : soit on se dit qu’il s’agit d’une constatation à posteriori de faits qui ont eu lieu et que le hasard aurait pu faire un calendrier différent, soit on se dit que tout était minutieusement programmé dès le départ, pour que cela se déroule ainsi et pas autrement.
Le choix entre ces deux positions est crucial. Le hasard, bien qu’impossible à maîtriser, nous est malgré tout plus familier. Dans notre quotidien nous côtoyons le hasard en permanence. C’est le hasard qui nous fait nous trouver au bon endroit au bon moment, et qui parfois, malheureusement nous trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Il est vrai aussi que dans ces situations d’autres disent que c’est Dieu qui l’a voulu ainsi… Dans leur esprit, Dieu pourtant bien discret dans le déroulement des événements majeurs de notre monde, s’occuperait également du quotidien de chacun de nous.
La théorie du hasard a eu ses adeptes parmi les scientifiques, à qui la religion posait problème. Cette théorie est construite sur le fait qu’une multiplication des tentatives va forcément aboutir à terme à un heureux dénouement. C’est le principe du jeu de dés évoqué précédemment. Si je lance 3 dés une seule fois, j’ai peu de chances d’obtenir 3 faces identiques, mais si je multiplie les tentatives, je finirai par y parvenir.
Rapportée à l’univers, cette théorie trouve sa justification dans les dimensions du cosmos observable ; plusieurs milliards de galaxies contenant chacune plusieurs milliards d’étoiles.
Il y a forcément dans le nombre quelques planètes, comme la nôtre, favorables au développement du vivant. Quant au passage de l’inerte au vivant, les tenants de la théorie du hasard postulent pour une apparition spontanée de la vie en milieu propice. Comme nous l’avons vu précédemment, à ce jour les tentatives pour recréer ce milieu propice n’ont pas abouti. Cela ne permet cependant pas d’écarter complètement cette hypothèse.
Avec les avancées sur la connaissance de l’ADN, et avec le décodage du message génétique extrêmement élaboré qu’il contient, il devient de plus en plus difficile d’expliquer la vie sans l’intervention d’une intelligence créatrice.
Fred Hoyle, cosmologiste et astronome britannique, détracteur du Big Bang, a eu cette formule imagée, pour réfuter la théorie du hasard dans l’apparition de la vie : « il y a autant de chances que la vie ait émergé par hasard, que de chances qu’une tornade balayant un entrepôt d’un chiffonnier ferrailleur, assemble un Boeing 747 à partir des matériaux qui s’y trouvent. »
Aujourd’hui, dans le domaine de l’astrobiologie, une partie de la communauté scientifique s’accorde sur le fait que l’Univers a eu un début, il y a 13,8 milliard d’années, qu’il aura une fin, et que tout cela a été très finement programmé pour qu’entre autres, il y 3,8 milliards d’années, la Vie soit apparue sur terre.
Mais accréditent-ils l’idée d’un Dieu créateur, maître de l’Univers ?
Parlent-ils du même Dieu que les religieux ?
Un même constat pour deux approches différentes
Dans le domaine scientifique, les avancées se font par des hypothèses nouvelles. Pas toujours bien accueillies de prime abord, seules celles qui seront confirmées finiront par être acceptées. La théorie du Big Bang est une belle illustration de cet état de fait. Après qu’Einstein ait publié en 1905 sa théorie de la relativité restreinte, puis en 1915 la théorie de la relativité générale, amenant ainsi une perception nouvelle de l’univers. Des cosmologistes, Alexandre Friedman et Georges Lemaître en ont tiré dès 1922 une conclusion inattendue : l’univers est en expansion.
Dans un premier temps, cette théorie fut très mal accueillie par Einstein, qui ne s’y rallia qu’en 1931, en reconnaissant que la constante cosmologique introduite dans ses calculs, pour nier cette expansion, était la plus grande erreur de sa vie. Mais avant d’en arriver à cette acceptation, il avait fallu les travaux de Georges Lemaître en 1927, dénigrés dans un premier temps et finalement reconnus en 1964, après l’observation fortuite du rayonnement fossile cosmologique.
Pendant 3 décennies encore, la théorie du Big Bang sera combattue par quelques réfractaires. Mais les observations concordantes se succédant, et surtout toutes les théories alternatives s’effondrant, elle sera enfin largement acceptée après un siècle de contestations.
Les avancées scientifiques ne révèlent pas le créateur lui-même, mais une œuvre d’une précision et d’une complexité telles que l’intervention d’une intelligence supérieure semble avoir été nécessaire à sa conception. Auprès d’une partie des scientifiques cette idée va se renforcer, au fur et à mesure que la complexité de l’œuvre est révélée.
Les religieux au contraire veulent accréditer l’idée d’un Dieu toujours présent, que nous devons à la fois craindre et vénérer. C’est de leur fonds de commerce qu’il est ici question.
Le récit est fragile, aussi les religieux font feu de tout bois pour en renforcer la crédibilité.
La position des scientifiques prônant la nécessité d’une intelligence créatrice est du pain bénit pour les religieux. Il leur est facile de dire que la science ne fait que confirmer les paroles d’Abraham prononcées 2600 ans plus tôt. Donc, conséquence logique de cette prophétie : seul Dieu avait pu souffler à Abraham une vérité qui ne pouvait être concevable par ailleurs.
Il est certes exact qu’Abraham a prôné un Dieu unique créateur de l’Univers, que cette création a été progressive, qu’en plus de l’univers, le Dieu d’Abraham a créé la vie, à partir de la matière. Tout cela semble bien être confirmé par la science.
Il est cependant important d’y regarder de plus près.
En prônant un Dieu unique, Abraham n’avait d’autres choix que d’en faire le créateur de tout son environnement. Il n’y a donc pas de caractère prophétique du récit, mais un simple hasard qui fait se rapprocher la légende avec les constatations scientifiques.
Sur de nombreux autres points de la légende d’Abraham, les divergences d’avec les constats scientifiques sont au contraire flagrants.
D’après la bible hébraïque le monde a été créé en 6 jours, des milliards d’années pour les scientifiques ; la terre est créée avant le soleil pour les religieux, 500 millions d’années après pour les scientifiques ; l’Homme est créé à l’image de Dieu pour les religieux, il est le résultat d’une lente évolution du vivant pour les scientifiques…
Voir plus loin
La science ne peut aujourd’hui tout expliquer. Il lui reste pour cela, de nombreuses connaissances à maîtriser. Au regard du chemin déjà parcouru, l’humanité me semble bien engagée, pour acquérir les savoirs qui nous font encore défaut. Sauf accident, il nous reste plusieurs siècles pour cela, voire plusieurs millénaires. Ces savoirs nous permettront un jour d’expliquer, j’en suis certain, l’origine et le fonctionnement de l’univers, ainsi que l’apparition et l’évolution de la vie sur terre, et peut être ailleurs dans l’univers.
Ayant compris cela, la prudence voudrait qu’on attende les avancées scientifiques, plutôt que d’émettre de nouvelles projections hasardeuses.
Pourtant, comme l’a fait Abraham il y a 2600 ans, l’Homme a besoin de se projeter en permanence, dans une légende utopique, mais fondatrice. Il a besoin de voir plus loin.
Voir plus loin, c’est ce qu’ont fait les légendes religieuses à une époque où la science en était à ses balbutiements. Mais les légendes religieuses ont un gros défaut, on l’a vu précédemment, c’est leur rigidité. Le récit ne peut s’amender, puisqu’il est issu de la parole divine.
Au fil du temps, les acquis scientifiques mettent régulièrement en défaut ce récit. Ils rendent plus délicate sa diffusion. Cela a été le cas notamment au cours du XVIIe siècle avec le conflit qui a opposé l’Église catholique à Galilée, ou à la fin du XIXe siècle lorsque Charles Darwin a formulé sa théorie de l’évolution.
Le rôle de la légende est de donner une explication à ce que le savoir ne permet pas encore de comprendre. Mais dès que le savoir avance, la légende doit faire amende honorable, pour se reconstruire sur les nouvelles bases.
Une légende novatrice doit donc être évolutive, en accord avec les acquis de la connaissance. Elle doit également être considérée à sa juste valeur, dénuée de toute passion. Elle ne doit pas détourner inutilement l’énergie humaine de ses causes majeures, que sont sa survie et l’acquisition de nouveaux savoirs. Elle doit au contraire les accompagner.
Car s’il y a un reproche que l’on peut faire aux légendes religieuses, c’est bien leur côté chronophage et énergivore, pour une humanité trop souvent en souffrance. En d’autres termes, l’énergie consacrée aux guerres de religions, ou à la construction des lieux de cultes, ou tout simplement en temps de prières, n’a pas amélioré d’un pouce, la situation matérielle des communautés humaines. Tout cela n’a servi à rien, si ce n’est d’avoir apporté un peu de confort moral à ceux qui y croient – réconfort apprécié par les gens qui souffrent, sans doute, mais néanmoins supercherie. Persister dans cette voie ne changera rien aux problèmes, présents ou à venir. Cela permettra seulement aux servants des différentes églises, de profiter encore un peu d’un système qui fait leur confort.
Si la vie sur terre, tout comme l’univers sont en évolution permanente, c’est que cela a un sens.
Si aujourd’hui, l’homme est doté d’une conscience et que cette conscience lui permet de s’interroger sur tout cela, c’est que cela a un sens.
C’est pour combler cette soif de sens que l’homme s’est pourvu d’une multitude de légendes, dont certaines sont devenues des religions, reconnues et partagées par de nombreux peuples. Ces légendes ont en partie rempli leur office, bien qu’elles aient apporté des réponses là où il fallait un questionnement. Et qu’elles aient exagérément mobilisé l’énergie humaine.
Si nous avons un devoir de reconnaissance envers cette force créatrice, ce n’est pas de la vénérer et de nous prosterner à ses pieds, mais c’est assurément d’essayer de la comprendre et contribuer à son dessein.
Car si le vivant, à travers l’homme, a acquis une conscience, c’est que cela a été voulu ainsi.
Mon intuition est que cette intelligence supérieure ne fait pas partie de notre univers, pas parce qu’elle l’a déserté, mais parce qu’elle ne l’a jamais habité. L’observation me montre que dans un monde en évolution, tout subit l’outrage du temps. En tant qu’être humain nous avons une durée de vie de quelques décennies, mais notre planète, notre système solaire et même notre univers ont une durée limitée, même si elle se mesure en milliards d’années. Nous savons par exemple, que toute vie sur terre sera condamnée à l’échéance d’environ cinq milliards d’années (lorsque le soleil aura épuisé ses réserves d’hydrogène).
Bien entendu, il se peut que l’aventure s’arrête bien avant cette limite ultime…
Le scénario qui m’apparaît alors le plus probable, est que cette intelligence supérieure, ce grand horloger, sachant de longue date ne pouvoir échapper à son extinction prochaine, a su mettre à profit ses connaissances, pour permettre un redémarrage de l’aventure. Son savoir lui permettait d’intervenir sur certains paramètres, et ainsi d’initier dans le futur, une nouvelle séquence favorable à l’émergence de la vie.
Imaginer cela, c’est admettre que l’évolution de l’univers en général, et l’évolution de notre planète en particulier ont obéi, pendant environ 10 milliards d’années, à une programmation minutieuse afin de préparer le passage de l’inerte au vivant. Car la vie ne s’est développée sur terre qu’au cours des trois derniers milliards d’années. C’était hier, à l’échelle cosmique…
Cette double prouesse échappe aujourd’hui à notre entendement. Mais elle n’est plus inconcevable.
Manipulation génétique, prise en compte du dérèglement climatique et tentative de mise en place de mesures réparatrices, tentative par la Nasa de dévier de sa trajectoire l’astéroïde Dimorphos, autant d’initiatives nouvelles qui me confortent dans cette idée.
A mes yeux, l’humanité est en capacité de devenir le grand horloger du prochain univers. En fait il serait plus juste de dire : « le Vivant est en capacité… », car l’humanité n’est que la forme de vie sur terre, ayant acquis une intelligence prospective. Le vivant reste pour moi un tout indivisible.
Embrasser l’évolution du vivant sur terre au cours des trois derniers milliards d’années, prendre conscience du parcours chaotique de cette évolution, et s’apercevoir que tout cela s’est fait en aveugle est tout simplement vertigineux.
Vertigineux mais salutaire, car si c’est sans nous en rendre compte que nous avons parcouru tout ce chemin, il me paraît maintenant judicieux d’endosser le statut d’acteur pour poursuivre l’évolution en pleine conscience.
Certes, pour l’instant rien n’est gagné. A ce jour, l’humanité s’est juste dotée de quoi détruire notre planète. Le but est peu glorieux, mais le processus d’acquisition des connaissances est validé. Il suffit juste de changer l’orientation.
Il est déjà remarquable de constater que les chercheurs du monde entier collaborent dans de nombreux domaines, notamment la santé, l’environnement et la recherche spatiale. Il est réconfortant, de voir que dans le domaine de la conquête spatiale, Américains, Russes, Européens, Canadiens et Japonais, n’ont cessé de collaborer au sein de l’ISS. Et ce, malgré leurs divisions exacerbées par les conflits du moment. Notamment la guerre en Ukraine.
Cette collaboration est primordiale car nous devons abandonner le mythe du surhomme, si une intelligence doit venir à bout du challenge qui se présente, ce sera, j’en suis certain, une intelligence collective. Les progrès scientifiques du dernier siècle en ont maintes fois fait la démonstration.
Quel destin ambitieux pour l’humanité ! me direz-vous.
Encore une fois, ce n’est en rien le destin de l’humanité, c’est le destin du vivant. Si une intelligence supérieure a programmé, le passage de l’inerte à un vivant évolutif, c’est que cela était nécessaire au parachèvement de l’œuvre qu’elle avait conçue. Mais ne l’oublions pas, elle a créé le vivant, pas l’homme !
L’humanité n’est que le résultat d’une évolution chaotique, le résultat d’une évolution du vivant primitif vers une forme toujours plus évoluée.
Il est évident que le grand horloger, à qui nous devons notre existence, n’est pas d’essence divine. Dieu étant par définition omniscient et omnipotent, il n’aurait pas eu besoin de nous, pour poursuivre l’aventure. Quel serait alors notre destin ? Peut-on imaginer comme le fait Bernard Weber dans son livre « Le souffle des Dieux », que les humains sont juste là, pour servir de distraction à des Dieux qui s’ennuient…De plus, le vivant si nous l’imaginons comme un tout, est bien trop éloigné de la perfection pour être d’essence divine. La distinction entre végétaux, animaux et humains, n’a pas lieu d’être. Par méconnaissance scientifique, les religions ont pu, pendant des siècles, propager l’idée que Dieu avait accordé une attention particulière à la création de l’homme. Nous savons depuis Darwin que cela est faux. Et nous savons depuis un demi-siècle environ, que notre corps ne peut se résumer à l’enveloppe charnelle que nous connaissons, car ce corps, abrite en réalité des écosystèmes riches de milliards de micro-organismes, les microbiotes. Et sans la collaboration de ces microbiotes, nous ne pourrions nous maintenir en vie. Les interactions entre les différentes formes du vivant, sont bien plus compliquées que ce qui apparaît de prime abord.
Si nous envisageons le vivant comme un tout, nous pouvons affirmer qu’il n’est porteur d’aucune des qualités morales, que nous serions en mesure d’attendre d’une création divine. Le vivant est avant tout la nourriture du vivant. Ce constat autorise toutes les bassesses et cruautés imaginables. Les rares qualités, que nous pouvons accorder aux formes les plus évoluées du vivant, comme la bienveillance ou la compassion, ne sont pas innées mais acquises par l’éducation.
Accorder ou non un caractère divin au grand horloger est fondamental. Si nous devons notre existence à Dieu, il nous suffit de nous prosterner et de prier. Si nous devons notre existence à l’intelligence supérieure que je viens d’évoquer ci-dessus, nous devons nous inscrire dans l’action.
Nous devons prendre notre destin en mains. Nous devons œuvrer pour prendre les commandes de la formidable aventure, qui a été initiée il y a plusieurs milliards d’années.
Dans l’ignorance, nous avons déjà accompli une partie du chemin, il est temps maintenant d’œuvrer avec clairvoyance.
Voilà en tous cas un challenge plaisant à relever, et un sens à donner à notre vie sur terre.
Conclusion
Des propos que j’ai tenu dans les lignes qui précédent, ont pu choquer certains d’entre vous.
S’en prendre à la religion, comme je viens de le faire, pourrait être lourd de conséquences dans certaines régions du monde.
Faut il se taire, pour autant ?
Faut il persévérer dans une attitude de mansuétude, à l’égard des concepts religieux, sous prétexte, qu’ils sont acceptés par un grand nombre, qu’ils trouvent leur origine dans des temps anciens, et que
croire ou non relève de l’intime ?
C’est à chacun d’entre nous de trouver la réponse à ces questions. Ceux qui préfèrent rester dans la protection rassurante de leur croyance peuvent le faire, mais qu’ils gardent présent dans un coin de leur mémoire que, quand bien même Dieu existerait, cela ne justifierait pas l’Église.
A une époque où nous souffrons, non pas d’un manque d’informations, mais d’une submersion de fausses informations, je considère pour ma part, que dans tous domaines, la quête de vérité est aujourd’hui une chose essentielle.
Nous ne pourrons vivre demain dans des sociétés démocratiques apaisées, si nos instances dirigeantes, ne parviennent pas à certifier la qualité du flux d’informations. Faute d’y parvenir, de plus en plus de citoyens déboussolés, rejetteront en bloc les informations officielles et se tourneront vers des thèses complotistes. Le processus est déjà engagé et chacun peut mesurer le danger que cela représente pour le délitement de nos sociétés. Les ébranlements de la démocratie américaine, pour ne citer que cet exemple, en sont malheureusement une illustration convaincante.
Les sociétés non démocratiques n’ont pas ce problème, bien au contraire, les « fake news » sont autant d’atouts habillement utilisés pour manipuler la population.
Pourrons nous demain lutter contre les « fake news » qui gangrènent nos démocraties, en continuant à sanctuariser le domaine religieux, relevant pourtant du même schéma de construction ?
Pour être forte, la démocratie a besoin de citoyens instruits, aptes à prendre des décisions rationnelles. Peut on considérer l’enseignement religieux comme une instruction fondatrice du citoyen avisé, ou au contraire, comme un frein à l’ouverture d’esprit indispensable à la prise de décisions éclairées ?
Pour ma part, j’ai tranché, et je dis clairement que quelle que soit la religion, son enseignement et l’endoctrinement qui va avec, sont des fléaux dont l’humanité devra s’affranchir pour pouvoir continuer à grandir.
La pensée scientifique, est au contraire une source d’instruction profitable au citoyen. Qui le fait grandir. Qui le rend apte à prendre des décisions éclairées, indispensables au bon fonctionnement démocratique.
Aujourd’hui, dans le domaine de l’astrobiologie, une partie de la communauté scientifique affirme avec de plus en plus de conviction qu’une intelligence supérieure a été nécessaire pour que notre univers soit ce qu’il est. Les Athées et croyants du monde entier doivent prendre cela en compte.
Mais cette force créatrice, à qui nous devons notre destin, est elle toujours en capacité d’agir ?
Comme je l’ai dit précédemment, le seul fait que nous soyons là par la volonté de cette intelligence supérieure, est la preuve qu’un rôle nous est assigné. Nous avons une utilité.
Quelle peut être cette utilité ? si ce n’est de suppléer cette intelligence supérieure qui se trouve aujourd’hui empêchée.
Si cette formidable aventure que nous vivons a un sens, et il est inconcevable qu’elle n’en ait pas, c’est à nous de le découvrir afin de contribuer à son succès.
La raison nous dit donc, que l’intelligence supérieure qui a paramétré avec précision, l’équilibre de notre univers, et qui a enclenché le processus du vivant, n’est plus de ce monde.
Nous sommes seuls et cela nous oblige.
*
De l’intelligent design à Elon Musk
Pierre Gillis
Le texte d’Éric Delgla est un ovni éditorial : il nous propose un plaidoyer virulemment anticlérical en faveur de l’intelligent design. Surprenant, en effet : on trouve très souvent les tenants ordinaires de cet intelligent design dans les rangs des propagandistes des différentes églises, qui l’érigent alors en contrefort de leurs institutions.
Ici, rien de tel, les pratiques religieuses font l’objet de condamnations sévères et convaincues :
L’énergie consacrée aux guerres de religions, ou à la construction des lieux de cultes, ou tout simplement en temps de prières, n’a pas amélioré d’un pouce, la situation matérielle des communautés humaines,
écrit-il. Et encore : « Je préfère un scientifique qui doute, mais qui cherche, à un religieux convaincu de sa croyance. »
Et pourtant, écrit-il aussi,
depuis un siècle les progrès scientifiques en cosmologie, thermodynamique, physique, biologie, chimie et autres sciences, les uns après les autres, vont conforter l’idée d’une force créatrice qui serait à l’origine de notre univers. On peut douter de Dieu, mais pas de la science.
Et donc, la science démontrerait Dieu – ou quelque chose d’approchant.
Les avancées scientifiques ne révèlent pas Dieu lui-même, mais une œuvre d’une précision et d’une complexité telles, que l’intervention d’une intelligence supérieure, d’origine divine ou non, semble avoir été nécessaire à sa conception. Auprès d’une partie des scientifiques, cette idée va se renforcer, au fur et à mesure que la complexité de l’œuvre est révélée.
Une fake news peut en cacher une autre
Après Dieu, dont Éric Delgla nous dit qu’il est une fake news, nous voici sans doute face à une autre fake news, qui prend la forme d’une affirmation gratuite, imprécise, et invérifiable. Je n’ai pas connaissance d’enquêtes d’opinion qui révéleraient les convictions philosophiques des scientifiques. Il est cependant vraisemblable que dans ce gigantesque vivier scientifique, certains soient des tenants de l’intelligent design. La phrase que je relève évoque « une partie des scientifiques » : la moitié, dix pour cent, un pour mille ? Quant au renforcement de cette idée, il me semble aussi arbitraire que la partie des scientifiques qui serait concernée. Témoignage qui en vaut bien un autre, je fréquente suffisamment les membres du département de biologie de mon université pour savoir que je n’ai jamais entendu l’un d’eux avancer cette opinion (et ce n’est pas faute de nous en être entretenus). Par contre, ce qui me semble clair, c’est que les grands moyens idéologiques sont déployés pour répandre cette idée, en particulier dans le monde des médias francophones, aujourd’hui dominés par quelques nababs réactionnaires. Alors que la littérature dans ses genres divers, philosophique, scientifique, ou fictionnelle, abonde en ouvrages qui tournent autour des grandes questions dont il est ici question, la seule référence qu’Éric Delgla évoque à l’appui de sa thèse relève malheureusement de ce registre que je décrie :
la lecture de l’ouvrage de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies : Dieu. La Science. Les Preuves, m’a fait prendre conscience, que la théorie d’un monde bâti sur le pur hasard, n’était plus soutenable.
L’ouvrage en question est une production de la multinationale Bolloré, et son premier auteur est le frère du patron, qui assure les arrières des campagnes lancées par Éric Zemmour. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce livre n’a pas convaincu tout le monde. Notre association, l’ABA, en a notamment publié un compte-rendu signé par le physicien Jean-Marc Lévy-Leblond (https://www.athees.net/dieu-et-la-science-les-preuves-a-lepreuve/), qui déshabille une production qui flirte avec l’escroquerie intellectuelle :
Passons rapidement sur la médiocrité éditoriale de l’ouvrage, encombré par nombre de redites et de citations répétitives. N’insistons guère sur la faible compréhension par les auteurs (désormais désignés par l’acronyme B&B) des théories scientifiques qu’ils invoquent à partir de lectures trop rapides d’ouvrages de vulgarisation de qualités diverses, mais donnons-en un exemple révélateur.
La science ne connaît pas l’instant zéro
Cet exemple a trait à ce qu’on appelle le temps de Planck, soit 10-43 s. B&B évoquent ce temps, extrêmement court, auquel ils attribuent une signification complètement fantaisiste, en affirmant que c’est à cet instant que les physiciens situent le Big Bang, et pas à l’instant 0. Pour les physiciens, le temps de Planck constitue la limite en-deçà de laquelle on ne peut rien dire. Pour rappel, le schéma Big Bang est construit sur la relativité générale, formalisation contemporaine de la gravitation, et sur elle seule, en oubliant les autres interactions inhérentes à la matière (électromagnétiques et nucléaires) – et toujours pour rappel, les physiciens se cassent en vain les dents depuis quelques décennies pour tenter de rendre compatibles la gravitation et les théories quantiques des champs, qui rendent compte des autres interactions.
L’appellation Big Bang est due à Fred Hoyle, un adversaire résolu du concept, qui avait choisi la dérision pour le combattre. Je connais plus d’un physicien qui regrette l’adoption du terme, porteur d’une connotation explosive qui lui est fondamentalement étrangère. Le consensus qui rassemble les physiciens porte sur l’expansion de l’univers ; considéré en remontant le temps, le processus d’expansion se retourne en concentration progressive de l’univers. Poussée à sa limite, cette concentration impliquerait divers infinis, en concentration précisément, en température, en pression, … à l’instant 0, celui du Big Bang. A ceci près qu’il est illégitime de pousser l’extrapolation à cette limite (cette illégitimité fait elle bien partie du consensus scientifique), puisqu’on n’en peut rien dire, au temps de Planck près. Les infinis « divins » ne sont pas impliqués par la physique contemporaine, qui, bien au contraire, s’est fixé une limite de pertinence. Pour la science, l’instant 0 est hors de portée, ce qui revient à dire qu’il n’y a pas d’instant 0 : la science ne le connaît pas.
Le lien postulé entre expansion de l’univers et création est une escroquerie[1]. C’est pour cette raison que Georges Lemaître, tout chanoine qu’il fût, avait remonté les bretelles de son patron théologique, le pape Pie XII, en 1951, lorsque celui-ci s’était permis cette liaison dangereuse. L’autorité de l’inventeur de l’atome primitif, concept précurseur du Big Bang, fut suffisante pour amener Pie XII à faire marche arrière, j’y reviendrai.
On ne peut que spéculer si l’on s’interroge sur ce qui, le cas échéant, aurait précédé le Big Bang. Deux pistes ont été évoquées malgré tout, qui ne tentent cependant pas l’impossible amalgame entre les deux pôles de la physique contemporaine.
La première a notamment été formulée par Edgard Gunzig[2]. Il s’interroge sur la capacité de la relativité générale à répondre seule au questionnement sur l’émergence de l’univers que nous connaissons, avec ses galaxies, ses étoiles, ses atomes, son rayonnement, sur l’émergence de la matière que la physique étudie. Non, répond clairement Gunzig, seule la théorie quantique des champs, version relativiste de la mécanique quantique, peut nous éclairer à ce sujet. Le problème théorique auquel on se heurte en développant cette idée est notre incapacité à faire cohabiter dans un même ensemble théorique relativité générale et théorie quantique des champs. On raisonne dès lors en s’appuyant soit sur un volet, soit sur l’autre. Le scénario esquissé par Edgard Gunzig quitte le registre de la relativité pour se focaliser sur la théorie quantique des champs ; il s’appuie sur ce que celle-ci avance pour régir les évènements prenant cours dans les tout premiers instants que nous pouvons tenter d’imaginer, et élimine ainsi ce point singulier qui échapperait par définition à toute description physique. Le vide quantique, qui préexiste au Big Bang, possède en lui-même la virtualité de ce Big Bang, il est « potentiellement créateur de particules, il représente la matière en veilleuse, en « attente » de pouvoir s’actualiser. »
Stricto sensu, il n’y a donc pas d’instant zéro. En suivant Gunzig, il n’est pas absurde d’invoquer un « avant Big Bang », même si la définition du temps dans un tel contexte ne manque pas de faire problème.
Les multivers cités par Éric Delgla s’inscrivent dans cette filière. Petite précision, cependant, pour continuer à cerner ce qui est « scientifiquement » acquis et ce qui ne l’est pas, dans la foulée des avancées de l’astrophysique. Stricto sensu, il n’y a jamais eu de théorie des multivers – peut-être y en aura-t-il une si les physiciens décrochent leur Graal et harmonisent relativité générale et théorie quantique des champs. En attendant, on s‘en tiendra à quelques spéculations autorisées par l’état des connaissances, que des cosmologistes se sont amusés à populariser.
D’où viennent ces spéculations ? De la version « théorie quantique des champs » du « pré Big Bang », et des propriétés du vide quantique, brièvement décrites plus haut, conformément aux idées d’Edgard Gunzig. Le XXe siècle a connu une étonnante accélération de l’expansion de nos connaissances cosmologiques, ponctuant un considérable élargissement de notre horizon : au départ d’un monde essentiellement terrestre, celui du géocentrisme, on est passé au système solaire, puis aux étoiles proches, avant de comprendre que même notre galaxie, la Voie Lactée, n’était qu’un amas parmi des milliards d’autres du même type. Les distances mesurées ou estimées ont explosé sous l’effet de ces découvertes. Les conditions d’émergence d’un univers à partir des fluctuations du vide quantique pourraient se trouver reproduites ; envisager une multiplicité de Big Bang, ce n’est jamais que poursuivre cet élargissement et parcourir une étape de plus. Le Big Bang pourrait n‘avoir pas été unique, donnant lieu à d’autres univers[3]. Pourquoi pas ?
L’autre piste a été proposée par Jean-Marc Lévy-Leblond, et ne sort pas du cadre de la relativité générale[4]. Les 13 milliards et quelques millions d’années qui se sont écoulées depuis le Big Bang sont des années au sens où nous les entendons depuis notre situation actuelle. En se rapprochant de « l’origine », le temps se modifie considérablement, et les intervalles de temps deviennent de plus en plus longs (un peu comme les distances le deviennent lors de l’expansion de l’univers), de sorte que ce que nous appelons un « instant zéro » doit être considéré comme un instant « moins l’infini » dans les référentiels adaptés à cette situation. Dans ce cas aussi, pas d’instant zéro.
Amusant de constater que cet argumentation relativiste recoupe les intuitions d’un courant de la théologie catholique, dans la foulée de Thomas d’Aquin – et Georges Lemaître s’inscrit dans cette tradition ! Comme l’a écrit Dominique Lambert[5],
la création n’est pas synonyme de commencement […] On peut imaginer que, depuis un temps infini et pour un temps infini, le monde est suspendu, quant à son existence, à une cause se situant à un autre niveau ontologique que lui.
Les allusions à la thermodynamique que se permettent B&B sont encore moins pertinentes, si c’est possible. L’éventuelle mort thermique de l’univers par homogénéisation, dont on notera qu’elle va à l’encontre de sa complexification observée, est une idée de la fin du XIXe siècle. Je me référerai aussi à une contribution de Léon Brenig, que nous avons publiée[6], et qui actualise cette vieille question, à la lumière des avancées de la thermodynamique du non-équilibre, et en distinguant l’univers observable, système ouvert, de l’univers infini, système fermé nécessaire à la validation des prédictions de la première thermodynamique.
Le paradoxe est sans doute qu’Éric Delgla pourrait souscrire à l’appel à la prudence lancé par Jean-Marc Lévy-Leblond à B&B :
comme presque plus personne ne saurait l’ignorer aujourd’hui, toute connaissance scientifique est provisoire, susceptible d’être contredite, ou au moins limitée par de nouveaux développements. Déduire de l’état de la science à un moment donné des affirmations métaphysiques ou théologiques censément universelles et éternelles est donc un pari plus qu’osé et perdant à coup pratiquement certain.
Cette mise en garde sonne comme un rappel des positions prises en son temps par Georges Lemaître face à son « patron » en religion, le pape Pie XII. Celui-ci avait en effet rapidement mesuré, une fois l’expansion de l’univers avérée, à quel point l’argument tombait bien, et il a commencé par succomber à la tentation de s’en emparer : évoquant le Big Bang, il déclarait devant l’Académie pontificale des sciences, en 1951,
Il semble, en vérité, que la science d’aujourd’hui […] ait réussi à se faire témoin de ce « Fiat Lux » initial, de cet instant où surgit du néant avec la matière, un océan de lumière et de radiations.[7]
Georges Lemaître ne l’entendait toutefois pas de cette oreille. Ses protestations furent entendues[8], ce qui conduisit Pie XII à abandonner son réflexe récupérateur. Un an plus tard, en 1952, il précisait en effet, devant l’assemblée générale de l’Union astronomique internationale, qu’il convenait de séparer les domaines de la science et de la religion.[9]
L’origine de la vie
Je me permettrai d’être plus expéditif sur ce thème, dans la mesure où il a fait l’objet d’un nombre impressionnant de confrontations, et que le texte d’Éric Delgla reproduit l’argumentation standard des partisans de l’intelligent design. Non, Darwin n’a jamais prétendu que le hasard seul permet de comprendre l’évolution. Autocitation, toute modestie bue[10] :
On doit à Patrick Tort[11] d’avoir mis le doigt sur la catégorie philosophique à l’œuvre chez Darwin, et qui contribue puissamment à sa scientificité[12] : il s’agit de la prise en compte de la contingence, du hasard pourrait-on dire si ce terme n’était pas aussi galvaudé, au cœur du mécanisme mis au jour par Darwin. Le darwinisme constitue un cadre général qui découple radicalement deux types d’événements, que ses prédécesseurs amalgamaient, et que certains de ses vulgarisateurs approximatifs s’obstinent à confondre : d’une part, l’apparition de mutations génétiques, à savoir des accidents chimiques, dont l’occurrence peut être spontanée ou induite par des phénomènes irréductibles au strict cadre environnemental (par exemple, l’exposition à des rayons X), et d’autre part, le fonctionnement de la biosphère, qui opère la sélection parmi un ensemble de mutations aléatoires. La prise en compte de la contingence, centrale dans le mécanisme mis à jour par Darwin – c’est ce qui fait sa supériorité sur Lamarck, qui n’avait pas perçu cette articulation – a fait de la théorie de l’évolution une véritable nouveauté dans le panorama des théories scientifiques ; il faut la saluer comme une extraordinaire avancée des connaissances.
Le hasard, seul, non, mais le hasard et la nécessité, pour reprendre l’expression de Jacques Monod. La nécessité agit via la sélection (souvent brutale) exercée par l’environnement, qui guide donc le processus. Il n’est donc pas possible de réfuter la théorie de l’évolution par un simple calcul de probabilités ; la citation de Fred Hoyle, pour imagée qu’elle soit, est dépourvue de pertinence (« il y a autant de chances que la vie ait émergé par hasard, que de chances qu’une tornade balayant un entrepôt d’un chiffonnier ferrailleur, assemble un Boeing 747 à partir des matériaux qui s’y trouvent. »). L’évolution est guidée, mais par les interventions naturelles de l’environnement des espèces, et pas par une intelligence supérieure, qui reste de toute façon littéralement indescriptible.
Certes, les tentatives de faire émerger la vie en éprouvette ont été vaines. Cela ne prouve qu’une chose : c’est que les conditions de cette apparition sont sans doute tellement extraordinaires que leur simulation en laboratoire est soit inimaginable, soit impossible ; mais l’histoire matérielle de l’univers est tellement riche en conditions inimaginables pour nos labos que l’impossibilité n’est certainement pas démontrée.
Peut-on repérer l’horloger du monde ?
Le lecteur qui m’a suivi jusqu’ici se demandera vraisemblablement ce qui justifie l’expression « ovni éditorial » qui ouvre ma réponse : les arguments échangés ci-dessus ont souvent été débattus, et ne sont pas fondamentalement nouveaux. A preuve les références auxquelles je fais appel, dont les dates de publication ne sont pas très récentes. J’aurais d’ailleurs pu en trouver de plus anciennes, Jacques Monod est un des noms qu’on aurait pu retenir.
L’originalité foncière de l’intervention d’Éric Delgla se situe dans la dernière partie de sa contribution, plus précisément dans la manière dont il se sort de ce qui lui apparaît comme une terrible contradiction, une incompatibilité majeure, entre l’évidente absence de trace de Dieu dans le monde qui nous abrite, et l’impossibilité (à ses yeux) du monde et de sa complexité s’il n’a pas été planifié et construit par un horloger.
Il s’agit donc pour lui d’assumer les deux pôles de la contradiction : oui, il y a un grand horloger, et non, on n’en trouve aucune manifestation observable.
Je m’en voudrais de caricaturer les positions des théologiens, et des catholiques en particulier. Tous ne sont pas des propagandistes des petits rituels superstitieux typiques des sportifs en attente de victoire, qui se signent pour recruter Dieu parmi leurs supporters. L’état du monde semble bien éloigné de toute forme de perfection divine, et le Pape François en était bien conscient[13] :
Quand nous lisons le récit de la Création dans la Genèse, nous risquons de prendre Dieu pour un magicien, brandissant sa baguette magique. Mais ce n’est pas ainsi. Dieu a créé les êtres et Il les a laissés se développer selon les lois intérieures qu’Il leur avait données[14], pour qu’ils se développent et atteignent leur plénitude. Il leur a accordé l’autonomie tout en les assurant de sa présence constante. La création s’est ainsi poursuivie pendant des siècles et des millénaires pour devenir telle que nous la connaissons aujourd’hui. Dieu n’est pas un démiurge mais le Créateur qui confère le don de l’être à tous les éléments.
Bien avant François, Augustin avait défendu une conception d’inspiration analogue[15] :
Il n’en est pas en effet de Dieu comme d’un architecte : la maison achevée, celui-ci s’en va, et même lorsqu’il cesse d’agir et qu’il s’en est allé, l’œuvre subsiste. Au contraire, le monde ne pourrait subsister, fût-ce l’instant d’un clin d’œil, si Dieu lui retirait son concours.
Il serait excessif d’assimiler les deux citations ci-dessus à une reconnaissance de la désertion par Dieu du monde d’ici-bas, à l’instar de ce qu’écrit Éric Delgla ; elles écartent même explicitement cette éventualité. Mais le problème n’a pas échappé aux responsables de l’Eglise, souvent sous la forme de l’opposition entre le bien et le mal, évidemment difficile à comprendre pour qui postule l’omnipotence d’un dieu infiniment bon.
Pascal avait plus d’audace (ou plus d’exigence ?) que le défunt Pape, en s’avançant dans cette direction. Je m’appuie ici sur l’article de Dominique Lambert déjà cité, où il explique que Pascal pense un Dieu présent au monde mais essentiellement caché[16] :
Ce qui y paraît [au monde] ne marque ni une exclusion totale, ni une présence manifeste de divinité, mais la présence d’un Dieu qui se cache. Tout porte ce caractère.
et où il rappelle les racines pascaliennes de Georges Lemaître :
Alors qu’il termine la rédaction de son fameux article qui allait initier la cosmologie du Big Bang[17], il écrit la conclusion suivante : « I think that everyone who believes in a supreme being supporting every being and every acting believes also that God is essentially hidden and may be glad to see how present physics provides a veil hiding the creation. »[18]
Credo quia absurdum, « je [le] crois parce que c’est absurde ». Maxime attribuée à Tertullien, mais bien dans l’esprit de Pascal : le croyant mérite son paradis, et son mérite est d’autant plus grand que les preuves à l’appui de sa foi se font légères. La raison et la foi n’habitent pas le même monde.
Dieu est-il ici-bas ?
Notre ovni se retrouve ainsi en bonne compagnie, dans sa tentative (difficile et ambitieuse, reconnaissons-le) de désamorcer la contradiction à laquelle il se heurte. D’où quelques hésitations dans ses propositions.
D’une part, il semble se rapprocher des positions thomistes (ou pascaliennes) lorsqu’il affirme que
Mon intuition est que cette intelligence supérieure ne fait pas partie de notre univers, pas parce qu’elle l’a déserté, mais parce qu’elle ne l’a jamais habité.
L’intelligence est donc ailleurs. Où ? On peut concevoir des réponses diverses à cette question, mais qui reviennent toujours à imaginer un monde d’idées pures, voire de lois mathématiques flottant dans un univers d’esprit pur. On en est presque à dire nulle part. Et l’idée de Dieu me semble largement compatible avec cette vision des choses, quoi qu’on dise notre ovni :
Il est évident que le grand horloger, à qui nous devons notre existence n’est pas d’essence divine.
Cette évidence renvoie à l’autre pôle de la contradiction, érigé sur le refus de l’idée d’un dieu omnipotent, idée que la connaissance de nos réalités disqualifie – la perfection est un mythe.
Et puis, basculement dans le positionnement, on lit dans la foulée que
L’observation me montre que dans un monde en évolution, tout subit l’outrage du temps. En tant qu’être humain nous avons une durée de vie de quelques décennies, mais notre planète, notre système solaire et même notre univers ont une durée limitée, même si elle se mesure en milliards d’années. Nous savons par exemple, que toute vie sur terre sera condamnée à l’échéance d’environ cinq milliards d’années (lorsque le soleil aura épuisé ses réserves d’hydrogène).
Retour brutal aux réalités d’ici-bas, auxquelles n’échapperait pas l’intelligence supérieure : elle vieillit, comme vous et moi. J’avoue que j’ai du mal à imaginer le déclin d’une intelligence supérieure qui ne serait pas connectée à une enveloppe matérielle, mais peut-être est-elle quand même faite de neurones et de connexions synaptiques, qui connaissent le vieillissement, l’usure et la nécrose…
Eh oui, faire tourner à plein rendement une intelligence supérieure, ça fatigue. Surtout quand se produisent des évènements imprévus dans des lieux improbables – l’intelligence supérieure n’étant pas omnipotente, elle ne peut avoir tout prévu. Rappelons le bruissement de l’aile du papillon au Brésil et la tornade subséquente au Texas…
Lassitude et fatigue, découragement face aux obligations du contrôle strict d’un monde de plus en plus complexe, chacun en pensera ce qu’il veut, mais le fait est là, puisque notre monde ne connaît aucune trace de l’intervention de l’intelligence supérieure – si ce n’est d’être là.
Ce retour aux réalités sublunaires, comme disait Aristote, s’inscrit dans une autre tradition, plutôt mise de côté depuis un siècle ou deux. Traditionnellement, les chrétiens ont privilégié l’unicité du monde, contrairement au point de vue de Pascal qui impose la reconnaissance de plusieurs « ordres », de plusieurs niveaux épistémologiques, qu’il convient de ne pas mélanger indûment, comme l’écrit Dominique Lambert. Au Moyen Âge, les légendes religieuses sont confrontées aux acquis « scientifiques » de l’époque, dominés par l’héritage du savoir aristotélicien. Ainsi, lorsque Jésus s’élève vers les cieux pour effectuer son Ascension, il est amené à slalomer entre les sept sphères célestes (neuf pour Ptolémée), à en croire Dante dans La Divine Comédie. Implicitement, les philosophes-théologiens-scientifiques partent de l’idée que le monde dans lequel nous vivons est unique. Revers de la médaille : ce concordisme a des limites, qui conduiront plus tard aux collisions entre conceptions opposées, une fois les incompatibilités devenues incontournables – Galilée pourrait en témoigner.
On peut aussi rappeler à ce sujet les recherches de William Whiston (1667-1752) – titulaire de la chaire de professeur lucasien à Cambridge et à ce titre successeur de Newton – pour situer l’enfer, à une époque où la physique n’est plus dans les limbes, contrairement à ce qu’elle était au Moyen âge. Diverses raisons militant contre le centre de la Terre, Whiston opta pour une localisation sur la comète de Halley, qui passe brutalement du très chaud au très froid, ce qui semble suffisamment désagréable pour en faire un lieu de punition pour les damnés.
Delgla renoue avec cette tradition qui se veut rationnelle : qu’en est-il de l’intelligence supérieure qui a créé l’univers et la vie ? A-t-elle un avenir dans le monde où nous vivons ?
L’Homme remis sur son piédestal
J’avoue mon admiration pour l’imagination débridée qui est à la manœuvre dans les parcelles de réponse proposées. Les caractéristiques standard des divinités en tous genres semblant indéfendables, c’est un anthropocentrisme renouvelé, résolu et assumé qui pourrait faire l’affaire :
En observant notre époque, je constate que depuis quelques décennies, l’humanité commence à jouer au grand horloger. Manipulation génétique, prise en compte du dérèglement climatique et tentative de mise en place de mesures réparatrices, tentative par la Nasa de dévier de sa trajectoire l’astéroïde Dimorphos, autant d’initiatives nouvelles qui me confortent dans cette idée.
A mes yeux, l’humanité est en capacité de devenir le grand horloger du prochain univers
Somme toute, c’est d’un passage de témoin qu’il s’agit, une fois la mission créatrice accomplie, à un moment qui ne doit à nouveau rien au hasard, puisqu’il semble que l’humanité, après quelques millions d’années d’évolution, ait atteint un niveau de connaissance et de maturité qui rende l’opération possible.
L’homme replacé au centre du monde… On y revient, après avoir pris conscience (scientifiquement, pour rester dans le registre qui nous occupe) qu’il n’y est pas. Et via une affirmation qui témoigne d’une naïveté désarçonnante : l’humanité est une puissante actrice des transformations de notre planète. En effet, mais pas dans le sens de la protection de notre écosystème. Le boulot a commencé il y a 12 000 ans avec la généralisation de l’agriculture, et tout s’est emballé avec l’industrialisation – réchauffement climatique à la clé. Mais jusqu’ici, il n’est question que de la planète, dont nos connaissances nous indiquent à quel point sa place dans l’univers est dérisoire. Sans parler d’éventuels ajustements des lois physiques fondamentales : jusqu’à nouvel ordre, on s’efforce de les comprendre, mais aucun organe législatif n’existe pour les modifier…
Les divagations projetant les interventions humaines dans le cosmos ont trouvé un prophète et un chef de meute dans la personne plus qu’inquiétante d’Elon Musk. Serait-il l’incarnation de l’intelligence supérieure ?
Je m’en tiendrai là, convaincu que la réflexion d’Éric Delgla est elle-même une fuite en avant face aux inconnues de notre monde, en particulier celles qui touchent à l’apparition de la vie – dont, je le répète, aucune théorie scientifique ne fait le résultat d’une programmation préalable. L’affirmation contraire n’est absolument pas le fait des avancées scientifiques. Paradoxe : cette fuite en avant se traduit par un retour au vieil anthropocentrisme. Par ailleurs, elle peut se comparer à celles que nous reprochons aux religions, même si les précautions dont elle est entourée débouchent sur des recommandations auxquelles nous adhérons : comprendre et agir plutôt que subir. Mais ses réflexions pourraient nourrir d’extraordinaires romans de science-fiction !
*
[1] Assumée par B&B, et peu importe que ce soit un effet de leur incompréhension ou de leur mauvaise foi.
[2] Edgard Gunzig, « Histoire cosmologique du vide », in Le briquet du Tout Puissant a-t-il allumé le Big Bang, ABA Editions, Bruxelles, 2017, pp. 49-73.
[3] Claude Semay, « La porcelaine du multivers », in Le briquet du Tout Puissant a-t-il allumé le Big Bang, ABA Editions, Bruxelles, 2017, p. 105-137.
[4] Jean-Marc Lévy-Leblond, « Un temps sans garantie d’origine », in Le tube à essais. Effervescience, Editions du Seuil, Collection Science Ouverte, Paris, 2020, pp. 253-260 (en particulier l’annexe pp. 258-260).
[5] Dominique Lambert, « Création et commencement. Thomas d’Aquin et Georges Lemaître », in Le briquet du Tout Puissant a-t-il allumé le Big Bang, ABA Editions, Bruxelles, 2017, p. 25.
[6] Léon Brenig, « Big Bang, irréversibilité et évolution », in Le briquet du Tout Puissant a-t-il allumé le Big Bang, ABA Editions, Bruxelles, 2017, pp. 75-104.
[7] « Les preuves de l’existence de Dieu à la lumière de la science actuelle de la nature », discours prononcé à l’Académie pontificale des Sciences le 22 novembre 1951, trad. parue dans La Documentation catholique, n° 1110, 16 décembre 1951.
[8] Dominique Lambert, op. cit., en particulier la note 38, p. 43.
[9] Discours prononcé par S.S. Pie XII lors du congrès de l’Union astronomique internationale à Rome (Italie), le 7 septembre 1952, trad. française dans La Documentation catholique, n° 1131, 5 octobre 1952.
[10] Pierre Gillis, « Introduction », in Théorie de l’évolution et croyance : le choc, ABA Editions, Bruxelles, 2019, p. 14.
[11] Directeur scientifique de l’Institut Charles Darwin International, Paris.
[12] Patrick Tort, Qu’est-ce que le matérialisme ? Introduction à l’Analyse des complexes discursifs, Éd. Belin, Paris, 2016.
[13]. http://fr.radiovaticana.va/news/2014/10/27/le_pape__l%C3%A9volution_de_la_nature_ne_contredit_pas_la_cr%C3%A9ation/1109525
[14] Entendre ici les lois de la nature, au sens où les scientifiques les révèlent ou les construisent (selon l’épistémologie dans laquelle on s’inscrit).
[15] Augustin, La Genèse au sens littéral, IV, xii, 22
[16] Pascal. Œuvres complètes, Paris, Seuil, 1963, p. 558.
[17] G. Lemaître, « The beginning of the world from the point of view of quantum theory », Nature, t. CXXVII, 9 mai 1931, n°3210, p. 706 (traduction française : « L’origine du monde du point de vue de la théorie quantique » in A. Friedmann, G. Lemaître, Essais de cosmologie,précédés de L’invention du Big Bang par Jean-Pierre Luminet (textes choisis, présentés, traduits du russe et de l’anglais et annotés par J.-P. Luminet et A. Grib), Paris, Seuil, 1997, Sources du savoir, pp.298-299).
[18] « Je pense que quiconque croit en un être suprême qu’on trouve derrière chaque être et chaque action croit aussi que Dieu est essentiellement caché, et qu’il peut se réjouir de constater comment la physique actuelle fournit un voile qui dissimule la création. » (ma traduction, PG)
Post a Comment
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.