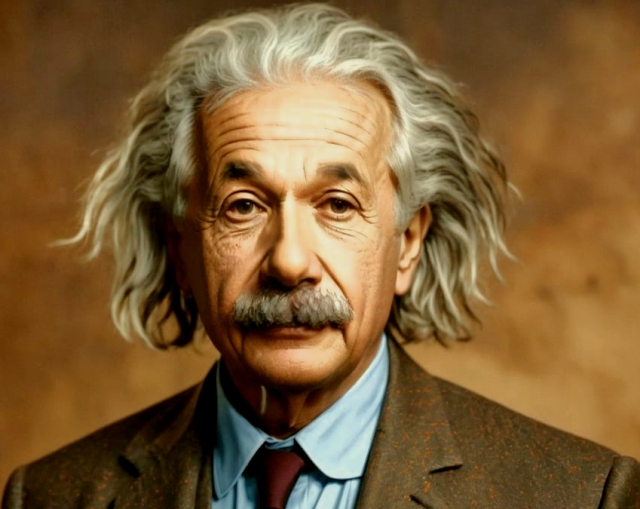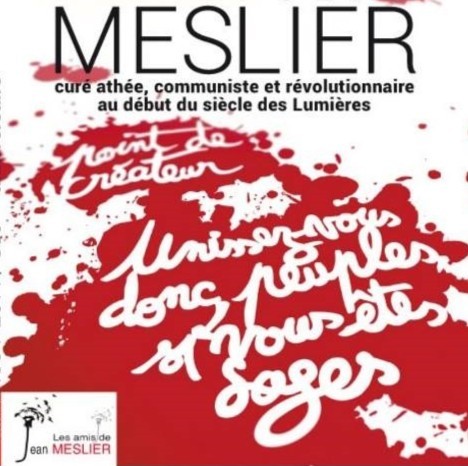
Jean Meslier, athée anarchiste ou communiste ?[¹]
Serge Deruette
Lorsque l’on aborde la question de la pensée de Jean Meslier telle que, à sa mort en 1729, il l’a léguée à la destinée posthume des manuscrits clandestins dans son Mémoire, la question de savoir s’il était communiste ou anarchiste est souvent posée.
Qu’il ait été, non un précurseur du communisme, mais un communiste lui-même est incontestable : il s’inscrit dans une tradition qui est vieille de deux siècles, et dont Thomas More, avec son Utopie, fut l’initiateur. Comme lui et les penseurs communistes qui lui ont succédé, que ce soit avant Meslier (comme Campanella au XVIIe siècle) ou après lui (comme Dom Deschamps au XVIIIe ou Cabet au XIXe siècle), tous prônent, à minima, le travail et la production des subsistances en commun ainsi que la propriété en commun des richesses de la terre et du travail. À leur différence, Meslier n’était pas utopiste : il avait un projet et un programme concret et pratique d’une révolution faite par les masses dirigées par les intellectuels au service de ces masses opprimées.
Meslier anarchiste ?
En revanche, il est bien moins aisé de prétendre que Meslier était anarchiste ou libertaire, ainsi que l’a fait par exemple Onfray qui – avant de voguer aujourd’hui vers ces autres cieux que l’on connaît – a contribué à en populariser l’idée[2].
C’est bien plus difficile parce que, à la différence du communisme, qui porte sur l’organisation sociale et économique de la société future au moins autant que sur sa forme politique, l’anarchisme est seulement un courant politique et est apparu, au XIXe siècle seulement, donc après Meslier. Et de façon multiforme qui plus est, et dans des sens opposés. Car s’ils ont comme caractéristique commune de s’opposer à l’État et à tout pouvoir contraignant, l’anarchisme revêt ou bien une dimension de libération sociale, comme l’est celui de Bakounine ou de Kropotkine, ou bien personnelle voire égoïste comme l’est l’anarchisme individualiste de Stirner et son « moi », qui a fait dire à Marx que, jeune, plutôt que de courir les filles, il courait après son « moi », ou encore au XXe siècle, par exemple, celui d’E. Armand.
L’anarchisme se réclame de la formule « Ni Dieu, ni maître », une devise qu’il a détournée du sens que lui avait donné Auguste Blanqui, qui n’était pas anarchiste (il prônait l’action révolutionnaire centralisée) et pour qui le « maître », ainsi que l’a montré Maurice Dommanget, n’était pas le dirigeant politique, mais le patron capitaliste[3]. Et comme l’anarchisme prône l’abolition de toute forme d’autorité coercitive étatique ou sociale au profit de décisions prises en assemblées et où chacun doit pouvoir vivre librement sans domination, hiérarchie, autorité ou ordre imposés, que ce soit ceux de l’État, de patrons ou de chefs, il est bien difficile de voir en Meslier un précurseur de ce courant d’idées.
Qui n’en serait pas convaincu gagne à lire ce que Meslier écrit, dans son Mémoire, sur la manière dont la société future, issue de la révolution populaire qu’il prône et qui, on en conviendra puisqu’il l’envisage précisément ainsi, se fera sous la conduite et la direction de plus sages et des plus éclairés, ceux que, deux siècles après lui, Antonio Gramsci appellera les « intellectuels organiques » du peuple.
Il en dit peu, mais ce l’est de façon suffisamment claire et convaincante pour que l’on puisse en juger de façon à trancher définitivement la question, et abandonner ces qualifications oiseuses d’« anarchiste » ou de « libertaire » qui polluent la pensée et la stratégie communistes et révolutionnaires qui étaient les siennes.
Meslier dans le texte[4]
Rien de mieux que de reprendre l’ensemble des rares passages du Mémoire où Meslier traite de la façon dont doit être dirigée la société communiste future. À la différence des textes des utopistes où les considérations abondent sur ce que devrait être la société future qu’ils prônent, elles sont rares chez Meslier : lui n’était pas un utopiste ! Il laisse donc aux hommes qui instaureront la société communiste où le partage en commun du travail et des richesses sera, avec « la bonne entente » entre eux à laquelle il les exhorte, le soin d’en déterminer les contours politiques.
Tout ce que l’on peut en dire de façon sûre, indéniable et incontestable, c’est que l’on y trouve l’idée d’« un gouvernement des sages », couplée avec celle d’une « subordination » à la fois juste et nécessaire.
- les « maux et méchancetés ne seraient certainement point si les hommes établissaient entre eux une juste proportion d’états et de conditions, et telle qu’il serait seulement nécessaire pour établir et garder entre eux une juste subordination » (VIe preuve, chap. 42 ; ŒJM, t. II, pp 16-17 ; ms 19460 BnF, f° 156 r) ;
- « une société ou communauté d’hommes ne peut être bien réglée ni se maintenir en bon ordre sans qu’il y ait quelque dépendance et quelque subordination entre eux, il est absolument nécessaire pour le bien de la société humaine qu’il y ait entre les hommes une dépendance et une subordination des uns aux autres » (ibid., ŒJM, t. II, p. 17 ; 19460, f° 156 r & v) ;
- « seulement sous la conduite et la direction de ceux qui seraient les plus sages et les mieux intentionnés pour l’avancement et pour le maintien du bien public » (ibid., chap. 48 ; ŒJM, t. II, p. 62 ; 19460, f° 167 v).
Dans la « Conclusion » de son Mémoire, Meslier ne cesse de le répéter :
- « De bons magistrats sont capables de bien gouverner les autres ; ils sont capables d’établir de bonnes lois et de faire de bons règlements de police […], et ainsi, ce sont des anciens remplis de prudence et de sagesse qu’il faut établir pour gouverner sagement les autres. » (Conclusion, chap. 96 ; ŒJM, t. III, pp. 143-144 ; 19460, f° 343 v) ;
S’adressant à ses « chers peuples », il leur dit :
- « Vous seriez heureux […] si vous étiez gouvernés seulement par de bons et sages magistrats. » (p. 145 ; f° 344 r) ;
- « Rejetez d’un commun consentement tous vos prêtres, tous vos moines et tous vos tyrans, pour établir parmi vous de bons, de sages et de prudents magistrats qui soient pour vous gouverner paisiblement, pour vous rendre fidèlement la justice aux uns comme aux autres, […] et auxquels vous dussiez, de votre côté, rendre une prompte et fidèle obéissance. » (pp. 145-146 ; f° 344 r) ;
- « Renversez, comme ils disent, tous ces orgueilleux tyrans de leurs trônes, et mettez en leur place de bons, de doux, de sages et de prudents magistrats pour vous gouverner » (p. 151 ; f° 345 r) ;
- Vous serez misérables et malheureux, vous et vos descendants, tant qu’il n’y aura point de juste subordination parmi vous […] » (p. 156 ; 19460, f° 346 v) ;
- « Que l’on attache l’honneur et la gloire, les biens et les douceurs de la vie, et même l’autorité du gouvernement à la vertu seule, à la sagesse, à la bonté, à la justice, à l’honnêteté, à la probité, etc. » (pp. 167-168 ; f° 348 v).
Meslier le répète encore dans sa lettre à « Monsieur le curé de… » par laquelle il présente la teneur de son Mémoire au confrère qui découvrira celui-ci. Il s’agit, écrit-il, de
- « mettre tous les hommes dans une juste subordination et établir parmi eux un doux et paisible gouvernement » (Lettre à « Monsieur le curé de… », Lettre reproduite dans OEJM, op. cit., t. III, pp. 203-206, citation p. 206 ; f° 358 r et 358 v, citation f° 358 v).
Voilà donc tout ce que Meslier dit de la façon dont il voit l’organisation de la société future. C’est à la fois fort peu et fort éloquent de clarté.
[1] Une version synthétique de ce texte a été publiée dans La Raison, n° 705, octobre 2025, p. 16.
[2] Les ultras des Lumières. Contre-histoire de la philosophie, IV, Paris, Grasset, 2007, p. 40 ; ou encore, tant qu’à faire, un « libertin » (ibid., p. 70). C’est pourtant ce qu’a encore fait récemment Philippe Diaz dans son récent petit livre Jean Meslier, curé, athée et anarchiste pour le XXIe siècle, paru chez L’Harmattan (2025, 167 p.) et dont nous avions rendu compte dans la Newslettern° 49 de l’ABA : « Un Meslier à nouveau recruté par l’anarchisme ! » (23 juillet 2025).
[3] Maurice Dommanget, Blanqui et l’opposition révolutionnaire à la fin du Second Empire, Paris, Libr. Rivière, 1960.
[4] Pour simplifier, j’indique entre parenthèses, à la suite chaque citation, sa référence au chapitre du Mémoire, le tome et la page des Œuvres de Jean Meslier (éd. par Roland Desné, Paris, Anthropos, 1970-1972, 3 t.), notées « ŒJM » où elle est reproduite, ainsi que le tome et le feuillet (f° recto ou verso) du manuscrit 19460 de la BnF (URL citée). Pour la clarté du propos, je souligne les termes relevants.
Post a Comment
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.