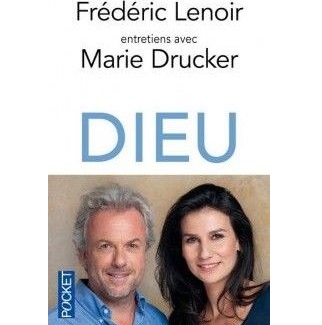Le retour de la spiritualité : nouveau masque des religions ?
Quand on observe le tableau actuel de l’état des croyances en Belgique – comme dans plusieurs autres pays voisins –, on peut mesurer aisément la révolution qui s’est opérée dans les mentalités depuis quelques décennies, même si le tableau simple que l’on
Le postmodernisme à l’assaut des Lumières
Superficiellement, du moins je le crains, l’hommage aux Lumières reste de rigueur. L’ex-président Obama y fait une fois de plus référence dans une interview donnée à l’occasion de la publication du premier tome de de ses Mémoires présidentiels tout en