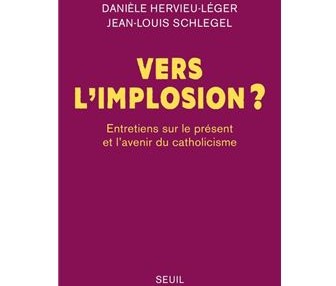Une Église en soins palliatifs
Patrice Dartevelle Inexorablement, l’Église catholique poursuit une descente que rien ne paraît arrêter. Dans son aire traditionnelle en Europe, elle a maintenant atteint un palier très bas. L’opposition entre le croyant convaincu et l’athée ou le rationaliste a dominé, depuis deux ou
Europe et religions. Retournements et enjeux
La question de l’Europe et du christianisme qui lui serait indissolublement lié fait toujours couler de l’encre. Dernière elle, frétille surtout celle de l’impensable pour d’aucuns d’une société sans religion et, à un degré moindre et quelque peu contradictoire, celle