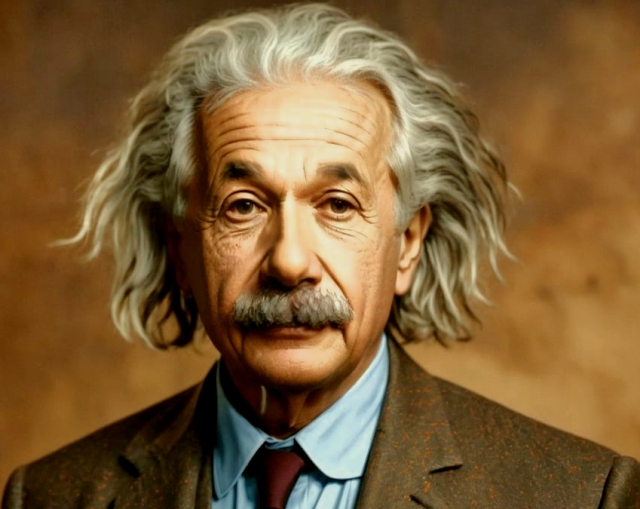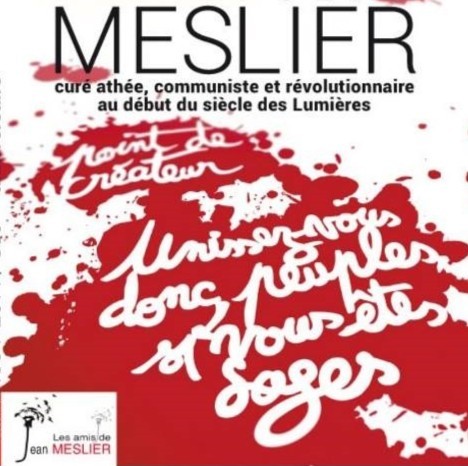Le sport, la religion et les religions.
Brève approche du phénomène
Yves Ramaekers
Le sport est aujourd’hui une passion partagée par de nombreuses personnes. Encore faut-il distinguer les pratiquants – amateurs ou professionnels – des supporteurs et des simples spectateurs ou des commentateurs, généralement intarissables sur le sujet. Tous cependant, à des degrés divers, participent à la vie du sport, même s’ils ne le pratiquent pas. Il en va de même des religions et autres spiritualités ; pour faire court, nous les engloberons souvent ici dans le terme unique de « religion ».
La caractéristique commune qui rapproche la religion et le sport, le ressort caché qui les anime est la diversion. Précision utile : la diversion est le moyen par lequel on vise à mettre un écart, une distance vis-à-vis de ce qui dérange ou de ce qui effraye. L’une – la religion – recherche une diversion par rapport à la peur, à l’angoisse face à la mort, au néant qui est entrevu et à ce qui est fantasmé au-delà ; l’autre – le sport – cherche la diversion par rapport à l’ennui, au néant qu’on entrevoit. L’un et l’autre craignent l’inaction, le loisir, le temps loisible et au final, la liberté du temps vide, de l’indéterminé où chacun se doit d’assumer sa liberté désencadrée et solitaire. Alors, comme sous la houlette les bergers et leurs chiens rassemblent le troupeau frileux, l’une et l’autre rassemblent, mobilisent, encadrent, marquent, parquent et enferment leurs adeptes dans un monde factice et rassurant.
Avant de nous enfoncer dans la jungle des relations entre religion et sport, nous rappelons cependant l’évidence qu’« Au commencement était l’athéisme… » En ce temps-là, aussi loin qu’on remonte, sans doute à des milliards d’années, tout, rigoureusement tout était athée. Les dieux n’existant tout simplement pas, il a fallu attendre l’arrivée de l’homme pour inventer les dieux et les religions. Dès lors, du point de vue athée, le sport et la religion sont des inventions et des pratiques humaines qu’il convient d’observer afin d’en comprendre le sens et la portée.
Quand donc le sport dans sa version contemporaine a-t-il fait son entrée dans nos pays ?
L’histoire situe l’apparition du sport dans sa version contemporaine au 19ᵉ siècle en Grande-Bretagne. Quasiment jusqu’au début du 20ᵉ siècle, le sport était une occupation de gens qui avaient le temps (et les moyens) de la pratiquer et qui meublaient ainsi leurs loisirs, ces temps libres que minaient l’oisiveté, l’apathie, l’atonie et l’ennui. Par la suite, le sport a changé de dimension et de nature en se diffusant dans les autres couches de population à mesure que s’étendait pour elles le temps libre, qui était essentiellement le temps libéré de la contrainte du travail.
Dans sa définition première, le sport n’était rien d’autre qu’une distraction, un divertissement – disport, desport, déport à savoir un « déportement » ludique par rapport aux routines habituelles des jours – qu’il avait été pendant des siècles, sans pour autant déborder de ce cadre ludique où il prospérait sur le mode de la spontanéité, du jeu et du passe-temps. Au niveau des pratiquants, en clair, les « amateurs », ceux qui aiment faire, le sport peut encore aujourd’hui être envisagé comme une activité de loisir et une activité choisie. Ce n’est pas le cas pour les sportifs professionnels et tout le monde d’organisations et d’affaires qui entoure le sport, où le sport doit être considéré comme l’objet même d’une entreprise. On voit la confusion qu’il y a autour de cette notion de sport, tout comme d’ailleurs, la confusion règne autour de celle des religions et des spiritualités, où on observe un même schéma d’évolution vers une professionnalisation de la structure d’encadrement.
Au fil du temps, le sport a changé de dimension en passant d’une activité ludique d’amateur (au sens premier rappelé plus haut) à une activité organisée sur le mode du commerce et de l’industrie ; passant d’une activité libre et bénévole à un monde contrôlé et réglementé ; passant du monde de la détente et du plaisir bénévoles et gratuits à celui très utilitaire de la performance et du profit. Ces deux grandes tendances continuent à exister.
Mais le sport a aussi à voir avec la religion : comme elle, par son organisation, il tend à structurer ses pratiquants et ses admirateurs autour d’une passion. Ainsi, autour de son idéologie et de la foi qu’elle implique, il tend à devenir une religion avec ses rites et ses célébrations et dans certains cas, il prend la forme d’une église. Conséquemment, le sport aussi a ses hérétiques et ses schismes.
Le cas de l’Italie
Ceci posé, venons-en au cas de l’Italie et à l’étude du professeur Stefano Pivato[1] qui raconte l’histoire du sport telle qu’elle s’est déroulée dans son pays, l’Italie. Il en a fait tout un livre.[2]
En Italie, manière d’indiquer l’importance du sport dans la vie nationale, les pratiquants réguliers ou occasionnels représentent une masse de 16 millions de personnes, soit environ 30 % de la population. Ce qui représente sans doute à peu près autant que les catholiques pratiquants[3] et les croyants pratiquants, toutes religions confondues. À cette masse qui pratique effectivement le sport ou la religion, il faut évidemment adjoindre les sportifs de comptoir, les sportifs médiatiques (les accrocs de l’écran et de la gazette) et du côté de la religion, les croyants par convenance sociale ; en ce cas, tant pour l’un que pour l’autre, cette foule grossit considérablement, mais le compte est biaisé.
D’entrée de jeu, Pivato nous dit : « En notre pays le sport a vécu des moments difficiles. ». Traduisez : les débuts furent chaotiques et contrariés, notamment par l’Église. Pour le montrer, il enchaîne ensuite une histoire du sport à travers le siècle dernier. Au début, le « sport » a été amené en Italie par les aristocrates et les riches anglais qui venaient y passer des vacances ; ils importèrent d’abord le tennis et le golf. À leur tour, les marins anglais importèrent le football ; ce sont eux qui fondèrent en 1893 le premier club de football en Italie : le « Genoa Cricket and Football Club »[4] à Gênes, lequel existe toujours sous le nom « Genoa ».
Le développement du sport de masse viendra après la Guerre de 1914-18 et s’étendra fortement du temps du fascisme et à partir de ce mouvement idéologique se développèrent les conceptions de sport populaire ou après la disparition du régime, celle de démocratisation du sport, dès lors plus tardive. La chose s’explique aisément du fait qu’il était dans l’intérêt du régime fasciste et dans ses habitudes et ses pratiques de regrouper et d’encadrer les populations et cela, dès l’enfance. Il s’agissait de renforcer la mainmise sur les populations.
Il vaut aussi la peine de noter que parallèlement à ce qui se passait en Italie, le sport a évolué partout dans le monde dans des directions similaires : de l’amateurisme vers la professionnalisation. Le sport qui était au départ une activité librement choisie et peu contraignante, conçue comme un choix et une pratique individuelle, éventuellement portée dans un groupe affinitaire, est ainsi devenu une activité collectivement encadrée et de plus en plus réglementée. De même, quand le sport s’applique à la jeunesse, il est vu comme un instrument d’éducation, de formation ou d’occupation. Dans certaines conditions, le sport mute souvent au dressage en vue d’atteindre un certain niveau de performance et même, à l’élevage quand il s’agit de préparer, de formater de futurs champions.
Le sport sous la direction du fascisme
Le fascisme est allé fort loin dans l’exploitation du sport et des sportifs. Selon Pivato, le fascisme éleva l’activité sportive en instrument éducatif de la nation et, dans une vision eugéniste, il a considéré le sport comme un moyen d’améliorer la race italienne. On ajoutera qu’il s’agissait aussi de contrôler le temps libre, de canaliser les énergies et par ce biais, d’(im-)mobiliser les esprits dans un carcan de principes et de règles. Ce fut également dans cette optique que naquit le « tifo » et ses meutes de « tifosi » qui ont conservé bien des traits de cette hérédité. En ce qui concerne le domaine sportif, le fascisme a réussi à faire de l’Italie une puissance sportive mondiale qui a remporté une série de succès, lors des Olympiades ou championnats mondiaux de football. Sans évidemment oublier, le cyclisme – qui, en Italie, fut longtemps le sport le plus populaire – où les coureurs italiens s’illustrèrent abondamment. Les effets de ce développement du sport par le régime fasciste l’ont profondément marqué et se font encore sentir aujourd’hui.
Le sport sous la houlette de l’Église
Du côté de l’Église (catholique, s’entend puisqu’on est en Italie), ce fut « je te hais, moi non plus ». Au départ, l’Église s’opposa au sport dont elle trouvait les principes teintés de « protestantisme », trop modernes à son goût. Et puis surtout, il y avait le fait que le sport entendait développer une « culture du corps » ; c’était gênant. Certains curés (de campagne ?) prêchaient que le sport « pouvait fomenter l’horrible délit de pédérastie ». Pire encore, selon eux, l’exposition du corps féminin allait à l’encontre de la mission de femme et de mère à laquelle la femme est destinée par Dieu.
Mais dès la mi-temps des années 30, l’Église se rend compte que le sport est devenu un phénomène de masse qui lui échappe, un domaine qui capt(iv)e les foules et qu’elle ne peut plus ignorer, ni contrer cette évolution. Elle propose alors, au travers de l’Action Catholique, le modèle de l’« athlète catholique » face au modèle de l’« athlète fasciste », prôné par le régime. Ce tournant met en avant le « sport catholique » et la théorie du « courage chrétien » et écarte l’image de l’athlète musculeux, gonflé par son engagement viril, pour promouvoir celle de l’athlète croyant, porté par la foi. Après la Guerre et la disparition du régime fasciste, le pape Pie XII relance cette conception du sport catholique et l’idéologie correspondante.
Manie bourgeoise et athlète prolétaire
On a pu constater, tout au long du siècle dernier, une évolution similaire du côté socialiste et communiste où on a vu se développer d’une part un courant socialiste opposé au sport considéré comme une « manie bourgeoise » et d’autre part plus tard, un courant communiste, favorable au sport, où on a retrouvé « l’athlète musculeux », confondu cette fois avec l’« athlète prolétarien », porteur militant de l’idéologie.
Du côté des femmes
Du côté des femmes cependant, les choses ont évolué différemment et beaucoup plus lentement. En Italie, en raison de la forte empreinte traditionaliste imposée par l’Église catholique, le sport féminin a connu son développement massif dans la seconde moitié du XXᵉ siècle et les poussées « émancipationnistes » des années 70-80 ont répandu une nouvelle culture du corps. Ces tendances évolutives se sont renforcées à partir de la fin du siècle et au début du deuxième millénaire, elles ont atteint un niveau tel que les distances entre le sport féminin et le masculin se sont réduites, même si les différences de genre restent encore fortes.
Umberto Eco et l’impératif utilitaire
Umberto Eco, écrivain et savant sémiologue, spécialiste des langages, tenait un point de vue sans doute plus critique, mais aussi plus contemporain. Eco soutenait que le sport est un instrumentum regni, destiné à contrôler les instincts des foules et à recouvrir (entendez camoufler) les problèmes sociaux. En quoi, il n’a pas forcément tort. Finalement, on constate que le sport suit la même voie que l’ensemble des activités de loisir, d’éducation et de formation qui, au travers de la massification de la société, se sont progressivement organisés selon les modes du commerce. Ce phénomène connu sous le nom de « marchandisation » s’étend d’ailleurs à l’ensemble de la société. Cette récupération de tous les espaces de liberté se poursuit à marches forcées et pas seulement dans le domaine sportif. On le retrouve dans l’éducation, la formation, les études, la recherche et les sciences, mais aussi, la santé, l’art, la culture, les loisirs, le tourisme. Partout se répand l’impératif utilitaire et totalitaire.
Au Brésil : le Dieu sportif
Reste aussi à comprendre ce que Dieu vient faire dans tout ça. La réponse peut être trouvée du côté du Brésil et des Églises évangéliques. On trouve quelques lumières dans un article à propos d’un livre intitulé (je traduis) : « Quand Dieu entre en jeu »[5]. Il indique, dans ses réflexions sur le foot, les religions et la société dans le plus grand pays d’Amérique latine, que dans l’optique pentecôtiste, l’enseignement du football va de pair avec l’enseignement pentecôtiste, qui se dit lui-même l’enseignement du Christ. On a donc logiquement habillé le Christ sur la colline qui domine Rio de la tenue et des couleurs de l’équipe nationale de football. Bel exemple de syncrétisme brésilien où se mélangent nation, religion, église, foi, foot, finance, sport, commerce, politique ! Ainsi, sur le terrain de foot, mais aussi au Parlement, le prosélytisme religieux des « prophètes de Dieu » est tel que la foi évangélique acquiert une « hyper-visibilité publique ». Gilberto Gil, qui fut ministre de la Culture au Brésil, c’était en 2003, soutenait que le Brésil a « un peuple métissé, qui a créé à travers les siècles, une culture essentiellement syncrétique ». Toutefois, le syncrétisme religieux « catholico-évangélico-afro-brésilien » est assez distant du Dieu « exclusif » de toutes les églises pentecôtistes alignées sur des positions ultraconservatrices pour la défense de la famille traditionnelle contre l’idéologie du genre, obsédées par l’avortement et par un anticommunisme viscéral. Mais quand même, parler de foot, au Brésil, signifie parler de religion et parler de religion signifie parler de politique, car les joueurs se font porteurs de la religiosité, alimentant la culture syncrétique brésilienne. Quant aux Églises, le football leur « offre rien de moins que la plus grande et la plus importante scène pour la prédication, la rendant capable d’atteindre en même temps des milliards de foyers partout sur la planète. »
Et maintenant ? Et ailleurs dans le monde ?
Pour élargir notre palette, j’ai fait appel aux lumières d’Olivier Bauer[6], savant théologien du sport, officiant à l’Université (réformée, protestante) de Lausanne. Je vous invite donc à un petit tour du monde.
De nos jours, on distinguera d’une part, le « sport », entendu dans son sens originel, comme divertissement et exercice physique en y ajoutant la dimension ludique – le « sport pour le sport » – et d’autre part, le « sport de compétition », y compris « amateur », axé sur la performance, le rendement, la rentabilité et le profit. Ce « sport contemporain » est mis au service du rendement financier et / ou de la puissance et du pouvoir. Il sert des intérêts ambitieux, notamment politiques. À ce stade de son évolution, le sport est devenu totalitaire ; il s’est mué en un moyen, un instrument au service d’une totalité qui le domine : ici, la finance ; là, la puissance.
Petit tour du monde dans le temps et l’espace
Dans le rapport au sport des religions et spiritualités, on voit des tendances très différentes, souvent venues d’un passé lointain, dans la conception que les religions et les spiritualités en ont dans le monde. En voici quelques exemples :
Pour les religions et spiritualités asiatiques (en gros : Chine, Corée, Japon, Vietnam…) prédomine la place du corps au centre de la conception et de la pratique du sport. Les arts martiaux, considérés comme des pratiques de développement personnel, sont intégrés dans les pratiques spirituelles du bouddhisme, du taoïsme, du confucianisme.
Quant à l’islam qui veut des « fidèles forts », il encourage les exercices physiques « pour lutter contre eux (les infidèles)… afin d’enrayer l’ennemi de Dieu et le vôtre. » C’est là une conception fort « utilitaire » du sport.
Dans la culture hindoue, on pratique de longue date des sports, considérés comme des exercices spirituels, devenus « traditionnels » : le yoga évidemment, la lutte (pahalvānī, mallayuddha), qui sont deux pratiques conçues pour produire « une transformation métaphysique ». L’hindouisme encourage le jeu en soi ; le Brahmasūtra évoque un jeu ou un sport libre, spontané, facile, gratuit, réfléchi, responsable, participatif, sans aucun effort ni aucun but ; la « nature innée » de la réalité ultime est donc de « jouer, d’aimer jouer et de pouvoir jouer ».
Le judaïsme lui se montre peu favorable à la pratique athlétique, longtemps associée aux coutumes grecques jugées idolâtres. Cette tradition se maintient chez les croyants les plus orthodoxes.
De son côté, longtemps, le christianisme s’est méfié du sport. Au début du IIIᵉ siècle, Tertullien, jugeait « les activités du stade » indignes. Par la suite, les choses évoluèrent : dans la France médiévale, les chanoines, « des évêques et même des archevêques » jouaient « à la pelote » dans les cathédrales les jours de Noël et de Pâques. Dans sa fresque immense décrivant le Disque Monde, Terry Pratchett en fera tout un roman : Allez les Mages ! [7], où les mages, qui sont les gardiens de la spiritualité et de la science, découvrant le sport, se lanceront dans un mémorable match de football de rue, qu’ils gagneront ; précisons : en s’interdisant d’avoir recours à la magie.
Les Mayas jouaient au pok-a-tok, où les joueurs tentaient de faire passer « une balle de latex dure de 10 à 15 cm » dans deux « gros anneaux de pierre » en la frappant « avec les hanches, les épaules et les avant-bras » et le Popol Vuh, le récit maya de la création du monde, raconte l’origine divine du jeu.
Les Iroquois pratiquaient le lacrosse, un sport qu’ils disent venu du Monde du Ciel, où il est pratiqué « pour régler pacifiquement les conflits » ; ils y jouaient clan contre clan, mais spirituellement, pour le plaisir du Créateur.
De la religion considérée comme un sport
Pour ce qui est de la religion considérée comme un sport, on se reportera au reportage historique[8] que fit Alfred Jarry à propos de la montée de la côte du Golgotha où les concurrents s’affrontent sur leur bicyclette, d’un modèle assez ancien, en une lutte digne des plus âpres arrivées alpines.
Au fil du temps, le sport s’est imposé comme pratique sociale et les religions ont bien dû s’y faire. Cependant, évolution ou pas, il y a lieu de garder la main sur les fidèles, qui même quand ils pratiquent des activités sportives, doivent rester des ouailles soumises aux impératifs de la religion. Dès lors, les religions imposent des limites à ces pratiques sportives en invoquant les principes et les interdits religieux. Quelques exemples à nouveau :
Le judaïsme demande de respecter le Shabbat, ce qui ne laisse que cinq jours par semaine pour l’entraînement et la compétition ; mais il peut exister des accommodements.
Le protestantisme a longtemps consacré le dimanche exclusivement au culte. En Angleterre, il faudra attendre 1974 pour que le football professionnel se joue aussi le dimanche.
L’islam demande de se montrer pudique et d’éviter la promiscuité ; ainsi, même pour pratiquer l’exercice physique, il faut cacher ses awrah (parties honteuses ou défectueuses), ce qui implique pour les hommes de se vêtir du nombril aux genoux et pour les femmes de cacher tout leur corps. L’islam décourage le sport mixte et interdit aux femmes de regarder le sport masculin ; le jeûne du ramadan est difficile à concilier avec la pratique d’un sport de haut niveau. Dans des cultures musulmanes qui dénigrent le sport féminin, les femmes doivent pouvoir le faire « en accord avec l’islam » en respectant les prescriptions vestimentaires et en évitant la mixité.
L’hindouisme soumet le sport féminin à des règles de pudeur que des tenues trop moulantes ne permettent pas de respecter. Le sport est aussi contrarié par le système des castes, qui ne peuvent se mélanger. C’est notamment le cas du rugby qui implique le contact étroit des corps dans les mêlées, les touches ou les plaquages alors que la religion interdit le contact corporel entre membres de castes différentes.
L’Église orthodoxe de Russie a récemment mis en place un « double mouvement de sportivisation de la religion et de théocratisation du sport » ; le 6 juin 2018, le patriarche orthodoxe Kirill de Moscou – par ailleurs, ex-agent du KGB – a proclamé « sa volonté d’évangéliser le sport russe, dont il fait un élément du prêche orthodoxe » ; il s’agit d’offrir un « service missionnaire » et une « éducation spirituelle et patriotique ». On notera que cette évolution particulière accompagne et soutient celle de l’Empire rêvé par le pouvoir qui tient actuellement en mains l’État et la Nation. Une telle syntonie entre religion, sport et pouvoir pose évidemment la question de leur indépendance réciproque et celle de la subordination au pouvoir.
D’ailleurs, sport et religion ont des points communs. L’un et l’autre tendent à créer une communauté, au niveau local et national. L’un et l’autre font du spectacle avec des règles, une hiérarchie, une liturgie officielle (les hymnes, les drapeaux) ou culturelle. Dans les stades comme dans les églises, on chante en chœur et on reste silencieux lors des moments rituels. Sans compter qu’il y a là une forte coïncidence avec le fonctionnement du pouvoir politique…
La neutralité, principe fondamental
Ainsi, de façon générale, la question de la neutralité religieuse se pose évidemment en sport comme dans toute la vie publique ; en miroir, il faut aussi souhaiter la neutralité du sport vis-à-vis de la religion comme face à la société. En corollaire, il convient de maintenir dans leurs domaines propres et le sport et la religion, afin qu’ils ne deviennent pas des instruments de propagande et de domination au service du pouvoir. Ou a contrario, de sorte qu’ils ne puissent user de leur influence pour manipuler la société et le pouvoir ou imposer leur domination à l’ensemble de la société. Jusqu’à présent, ce fut surtout le fait de la religion ; il est vrai que sa rivalité avec le pouvoir temporel existe depuis la nuit des temps. On frémit à l’idée d’une société organisée sur le mode sportif. Cette neutralité du sport et de la religion se doit de s’étendre à tous les domaines de la vie, y compris au niveau international. Cette neutralité est une sorte de règle fondamentale d’hygiène de vie en société.
[¹] Stefano Pivato a enseigné l’Histoire contemporaine dans les universités de Trieste et d’Urbino. Il fut un des premiers à introduire en Italie l’histoire du sport.
[²] Stefano Pivato, Contro lo sport – da Pie X a Umberto Eco, Ed. Utet, 2024.
[³] Voir Religions en Italie – https://fr.wikiital.com/wiki/Religioni_in_Italia, qui recense une série d’enquêtes relativement récentes sur le sujet.
[⁴] Genoa : Le Genoa Cricket and Football Club, abrégé en Genoa CFC ou plus communément Genoa est un club italien de football basé à Gênes fondé en 1893.
[⁵] Claude Petrognani, Quando Dio entra in gioco. Riflessioni su calcio, religioni e società di un antropologo in Brasile, Rogas, Roma, 2025, 120 p. Voir aussi : « Le Dieu des Brésiliens, de Lula et Bolsonaro. Considérations socio-anthropologiques » dans la revue Religioni e Società (XXXVIII, 106, Mai – Août 2023, Fabrizio Serra Editore – Pisa – Roma). Claude Petrognani est sociologue. Voir la notice du CNRS : Claude Petrognani est post-docteur en Sciences religieuses à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE-PSL/Paris Sorbonne).
[⁶] Olivier Bauer, Sport et spiritualité, dernière version 2024, In Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics. (pp. 199-201).
[⁷] Terry Pratchett, « Allez les Mages ! », Éditions L’Atalante, Nantes, 2010.
[⁸] Alfred Jarry, « La Passion considérée comme course de côte », in Spéculations, Fasquelle éd., 1911.
Post a Comment
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.