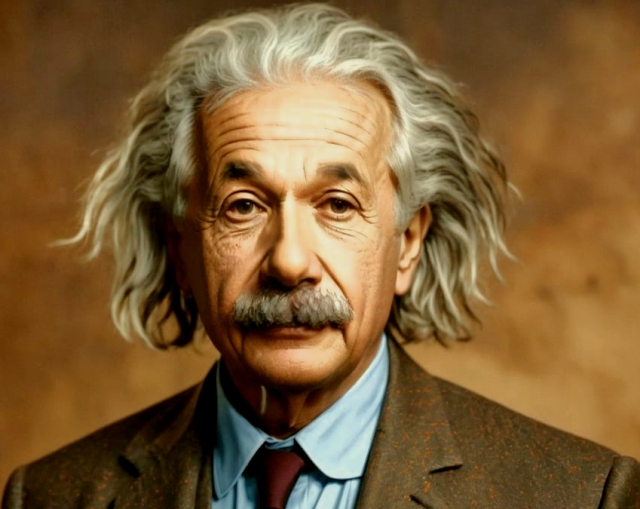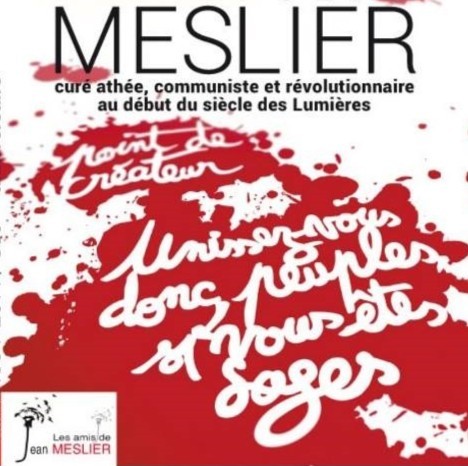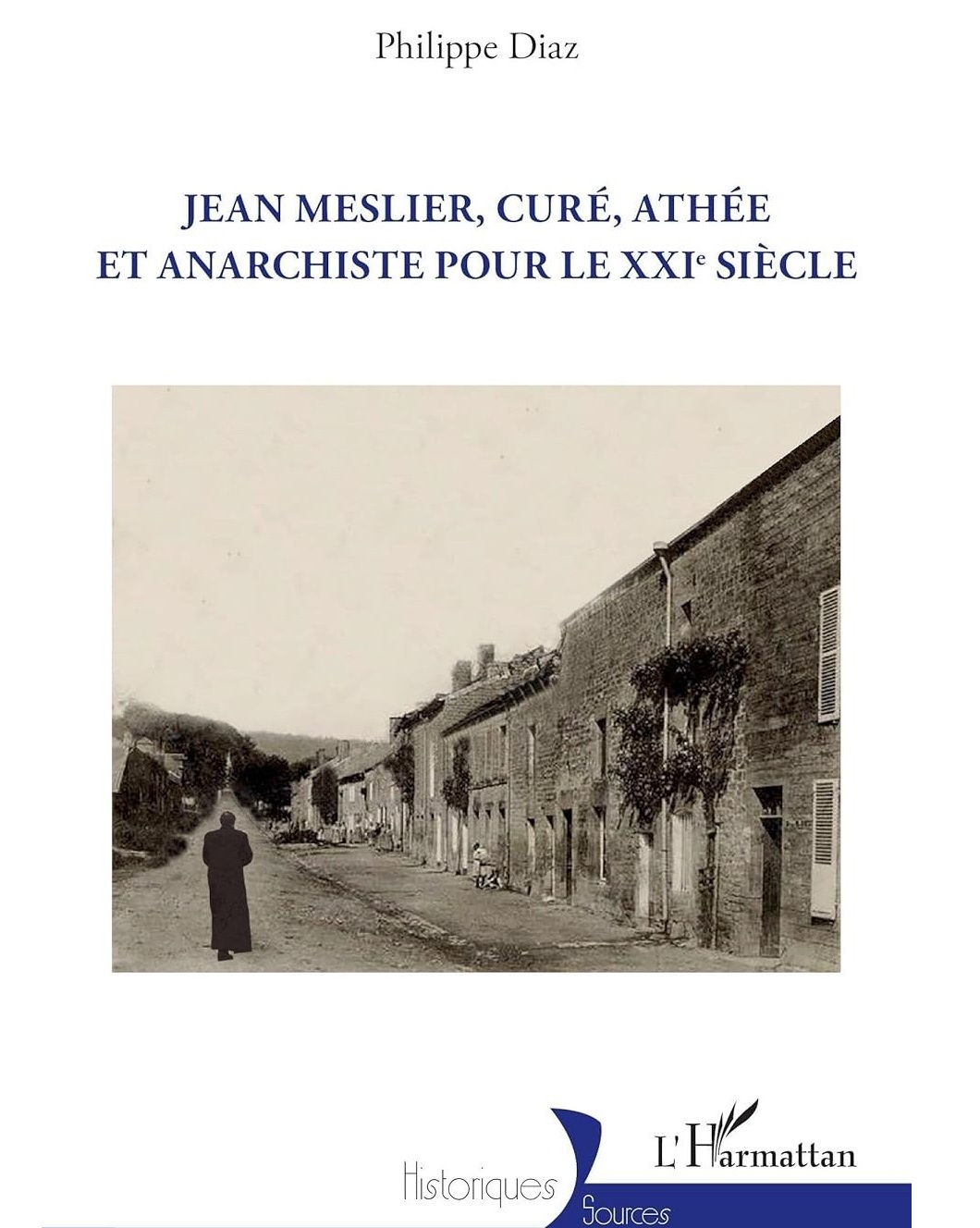
Meslier à nouveau recruté par l’anarchisme ![1]
Serge Deruette
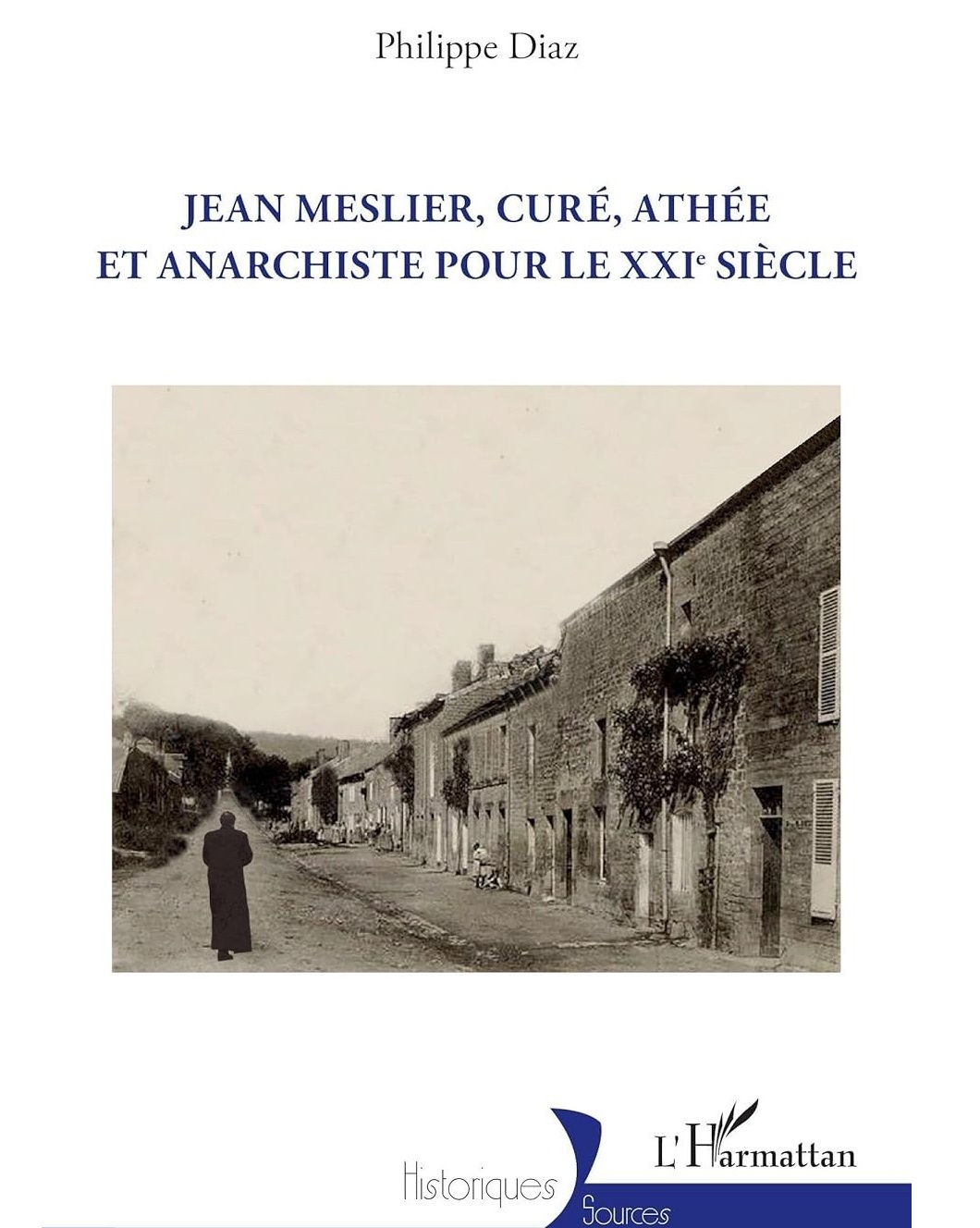
Le petit livre que Philippe Diaz vient de publier sur Jean Meslier donne de lui, à bien des égards, je vais le montrer, une image fantaisiste qui le discrédite. Il traduit la passion que l’auteur nourrit pour ce penseur qu’il découvre, ce qui, en soi, n’a rien de rédhibitoire, ne serait-ce l’obstination que, contre vents et marées, il met à faire de Meslier un précurseur sinon même un penseur de l’anarchisme.
C’est là pour moi, outre l’amateurisme, le plus grand défaut de ce petit livre récemment publié chez L’Harmattan, une maison d’édition connue pour éditer souvent des ouvrages d’auteurs qui les formatent eux-mêmes tant dans la forme que pour le fond, se dispensant ainsi de tout comité de lecture comme gage de sérieux.
Pour sa défense, on pourrait dire que Diaz n’est pas le premier à vouloir annexer Meslier aux idées politiques qu’il chérit. Il reproduit là une démarche que beaucoup ont été et sont aujourd’hui encore tenté de faire : projeter sur le curé athée leurs propres pensées ou désirs et, alors mêmes qu’elles sont absentes de ses intentions, le recruter pour sa propre cause, aussi éloignée soit-elle de ce qu’écrivait ce penseur que l’on se plait à annexer à sa propre cause.
Instrumentalisation
Le premier, le plus illustre aussi, de ceux qui ont choisi de travestir Meslier à leur profit, est bien sûr Voltaire, qui n’avait pas manqué l’opportunité de transformer l’athée matérialiste, communiste et révolutionnaire qu’est Meslier en un prêtre de village partageant ses propres préoccupations de grand bourgeois déiste, celles d’écraser « l’Infâme ». Dans son Abrégé de ce qu’il appelait le « Testament de Meslier », il n’hésitait pas à tronquer le Mémoire de ses démonstrations matérialistes qu’il ne partageait pas, et de ses positions communistes et révolutionnaires qu’il appréciait moins encore, y insérant en revanche des idées de son cru, totalement étrangères à l’athéisme de Meslier.
Plus près de nous, il y a quelques années, le Québécois Marcel Sylvestre[2], pour l’annexer à son combat qu’il veut « laïc » contre le voile islamique, avait, lui aussi, sous couvert de l’« actualiser », instrumentalisé le Mémoire de Meslier, le réduisant à être essentiellement un argumentaire permettant de s’en prendre aux musulmans. Un point de vue qui dénature à l’évidence profondément les préoccupations de Meslier. Car s’il était implacable dans sa critique des religions, il était en revanche plein de mansuétude pour « ses paroissiens et tous leurs semblables », c’est-à-dire pour tous les croyants qu’il voulait « désabuser », comme il le disait dans le langage de son époque, mais sans jamais les incriminer ni les mépriser, eux qui l’étaient déjà tant par les puissants et les nantis.
Ils sont loin d’être les seuls. Que l’on pense à Onfray qui, avant qu’il ne vogue vers d’autres cieux, avait non seulement, lui aussi, fait de Meslier un « anarchiste » ou un « libertaire »[3]. Et qui, encore, l’avait encore transformé en « libertin »[4]. Rien que ça ! On pouvait mieux faire : dans l’ouvrage même qu’Onfray préface, Thierry Guilabert, son auteur, qui se montre pourtant tout aussi anarchiste ou libertaire que lui, reste bien plus soucieux d’éviter de se livrer à ce genre de défiguration intéressée de notre curé athée. Ainsi n’occulte-t-il pas que ce dernier parle bien dans son Mémoire de la nécessité de « quelque dépendance et quelque subordination » entre les hommes dans la société future, se contentant de refuser l’idée qu’il y soit « question ni d’État, ni de gouvernement ». Il reviendra d’ailleurs par deux fois sur la question pour mélanger les genres, arguant à juste titre que « ces notions de communisme, socialisme, anarchisme » étaient « inconnues » à son époque pour conclure qu’il était difficile de « distinguer chez lui le socialiste du communiste, le communiste de l’anarchiste »[5].
Philippe Diaz n’a pas ces scrupules qui veut, sans détour, métamorphoser en l’anarchiste qu’il est lui-même un Meslier qui ne l’est aucunement.
Son livre est composé d’une introduction (pp. 7-25) suivie d’extraits du Mémoire et conclu par un article sur « l’anarchisme de Jean Meslier » (pp. 144-163). Ce sont donc deux courts textes encadrant une sélection de passages du Mémoire, telle qu’elle a déjà été faite plusieurs fois depuis celle de Roland Desné, à la suite de sa publication des Œuvres de Jean Meslier en 1970-1972[6].
Les extraits du Mémoire (pp. 26-143), j’y reviendrai in fine, y sont présentés sans suivre l’ordre pourtant très précis que suivait Meslier, et ils n’y sont pas autrement introduits que par un seul court titre, noyant ainsi la logique pourtant si explicite du Mémoire. Diaz fait aussi largement l’impasse sur la partie philosophique matérialiste, réduite à quelques pages (pp.74-85), alors que celle-ci est pourtant, avec sa partie politique révolutionnaire, la raison pour laquelle Meslier fait véritablement date dans l’histoire des idées. Pourquoi un tel choix de citations, pourquoi écarter des pans entiers de démonstrations meslières, pourquoi en mélanger les citations restantes ? Ces questions restent sans réponse.
Que l’on se garde bien aussi de citer Meslier à partir de ce livre, car Diaz a pris soin, sous le prétexte de lui rendre, dit-il, « sa modernité et sa pertinence » (p. 13) d’en actualiser la prose. Cela ne va pas non plus sans que soient exclues tant de nuances et d’inflexions dans l’argumentation que l’on trouve dans le Mémoire. Et puis, cette volonté de paraître à la mode d’aujourd’hui comporte aussi pas mal de mésinterprétations et d’anachronismes déformant le sens des termes qu’employait Meslier. Le fait est que l’auteur de ces remaniements n’indique nulle part s’être préoccupé de vérifier le sens de mots vieux de trois siècles dans un dictionnaire de l’époque de Meslier, comme l’étaient l’excellent Furetière ou celui de l’Académie française.
Ainsi en va-t-il aussi, pour prendre un exemple parmi tant d’autres, du mot « industrieusement » qui est supprimé, retranchant par là-même du sens au texte puisque, s’il n’a plus vraiment ce sens aujourd’hui, il signifiait alors « habilement, avec adresse, subtilement ». Ainsi aussi ne saura-t-on pas que Meslier utilisait ces termes particulièrement datés (ils l’étaient déjà à son époque, datant de plus de trois siècles avant lui, et il les ressuscite en somme, mais en les grevant d’une connotation négative qu’ils n’avaient pas alors) mais cependant si colorés et expressifs qu’ils en paraissent intemporels, de « déicoles », christicoles » et « déichristicoles »[7]. (chap. 72)
Pour son texte introductif, Philippe Diaz ne s’embarrasse guère de vérifier ses affirmations. Il comporte bon nombre d’imprécisions, de confusions et d’erreurs petites mais grandes aussi. Certaines d’entre elles sont amusantes ou cocasses, d’autres sont malheureuses et navrantes. Mais, en soi, elles n’ont pas grand intérêt sinon d’illustrer la faiblesse et le caractère farfelu de la connaissance qu’a Philippe Diaz de Meslier et de sa pensée.
J’en propose une compilation non exhaustive en annexe de cette critique et préfère ici m’attacher au texte final (pp. 144-163) dans lequel l’auteur s’efforce, sans trop s’embarrasser de scrupules, on le verra, de démontrer que Meslier correspond à l’image qu’il se fait de lui.
Anarchie, anarchie chérie !
Contre toute évidence, l’auteur commence par contester que Meslier ait, pour sa société future, avancé le « besoin de gouvernement » (p. 145). Tout comme Thierry Guilabert[8], il ne voit « rien qui présuppose un État » lorsque Meslier parle de la nécessité de « sages magistrats » pour gouverner les hommes (pp. 145-146). Mais à sa différence, pour le définir comme précurseur de l’anarchisme, sinon même comme « anarchiste » lui-même, il n’hésite pas à convoquer le point de vue d’auteurs de la première moitié du XXe siècle, comme Sergent et Harmel (parfois notés « Sergent et Amel ») qui, anarchistes eux-mêmes, l’embringuaient avec empressement dans leur courant de pensée, ou encore l’étonnant anarchiste individualiste Émile Armand dont les motivations étaient pourtant le plus souvent aux antipodes de celles de Meslier (pp. 147-148).
Plus déroutant encore est de voir Diaz convoquer le marxiste italien Labriola pour défendre cette thèse de prédilection des anarchistes, sous le prétexte qu’il a écrit que Meslier se prononçait pour l’abolition, non de l’État en tant que tel, mais de « l’État hiérarchique coercitif »… Ainsi que disent les jésuites : « qui cherche trouve ! ».
Comme s’il ne pouvait y avoir d’autre État que celui des puissants et des riches, comme s’il ne pouvait en exister qui défendent les non-possédants – la Commune de Paris n’a-t-elle été qu’un mythe ? –, notre auteur ne veut rien voir d’autre, quand Meslier dénonce les rois et les grands de ce monde, que « son refus de l’État était clair » (p. 148).
Se rend-il compte qu’à ce prix, c’est l’ensemble des penseurs et des précurseurs du communisme qui peuvent joyeusement être rattachés à l’anarchie : les révolutionnaires paysans des XVIIe et XVIIe siècles Münzer et Winstanley, et pourquoi pas, tant qu’à faire, Engels et Marx eux-mêmes, et Lénine, qui les dénonçaient tout autant.
À l’appui de sa thèse d’un Meslier anarchiste, le seul argument un tant soit peu sérieux que Diaz avance est cette citation (légèrement aménagée et tronquée) du Mémoire qu’il reprend : « toutes les villes et autres communautés voisines les unes des autres devraient faire alliance entre elles et devraient maintenir la paix et la bonne union entre elles » (p. 149). Une thèse que Diaz rapproche immanquablement d’une option fédérative et non centralisatrice du pouvoir, plus proche de fait de la conception anarchiste que de la conception marxiste.
Mais qu’est-ce à dire ? Si Meslier n’est à l’évidence pas un défenseur d’un pouvoir centralisé pour l’organisation de sa société communiste, de là à en déduire qu’il prône l’anarchie, c’est oublier que l’horizon dans lequel il pense est borné à ses villages paysans. Comment aurait-il pu concevoir la société future en y prônant un pouvoir centralisé, alors que le seul exemple qu’il en avait était celui des rois de France contre lesquels il appelait au tyrannicide ! Et puis, depuis quand prôner la solidarité entre villages serait-il un gage irréfutable d’anarchisme ? Depuis quand exclut-elle toute conception organisée d’un pouvoir qui, comme Meslier l’envisage dans son projet et son programme révolutionnaires, doit défendre les pauvres et les protéger contre les rois et autres potentats ? Depuis quand une telle solidarité ne l’implique-t-elle pas aussi ?
Il faut bien des circonvolutions à Diaz pour admettre que, lorsque, de façon claire et incontestable, Meslier expose qu’« il est absolument nécessaire pour le bien de la société humaine qu’il y ait entre les hommes une dépendance et une subordination des uns aux autres », y posant comme condition qu’elle soit « juste et bien proportionnée » (p. 150), cela ne correspond pas vraiment avec sa thèse. Plutôt que de l’admettre, il préfère y voir seulement l’occasion par laquelle « les “experts” se justifient » quand ils veulent nier à Meslier son anarchisme… ou comment un fait incontestable est (« industrieusement », aurait dit Meslier[9]) transformé en justification de ce qui serait une erreur !
De cette « direction des plus sages » qu’invoque encore Meslier dans son Mémoire, Diaz ne veut seulement retenir qu’il n’y a « pas d’organisation venant d’en haut » : « ce sont les peuples qui les choisiront » dit-il. Même si Meslier ne dit rien à ce propos – la seule chose qu’il avance, et une seule fois, c’est qu’il faut les « établir », rien d’autre –, on peut sans grande difficulté admettre qu’il ne se serait pas opposé à cette idée de les élire. Mais en faire une idée anarchiste ne va cependant pas de soi : depuis quand l’anarchisme serait-il synonyme d’élections ? Et depuis quand celles-ci, si souvent cataloguées par les anarchistes comme un « piège à cons », seraient-elles maintenant garantes de ce que l’organisation politique ne vienne pas d’en haut, et gage de ce qu’elle vienne d’en bas ? Voilà bien ce que Diaz s’abstient d’expliquer.
À l’appui de sa thèse, il préfère citer les fondateurs de l’anarchisme, dont Bakounine et Kropotkine, mais aussi James Guillaume (pp. 150-153) et sa communauté jurassienne d’horlogers dont il fait grand cas (pp.155 et 158). Il les cite pour tenter de montrer qu’ils correspondent à la conception politique que défend Meslier, dans une pétition de principes qui, à l’évidence, ne convaincra que les convaincus. Notons encore que, à l’instar d’Onfray qui l’admire, il ne répugne pas à recourir à l’autorité de cet anarchiste ultra-misogyne qu’était Proudhon (p.150). Meslier était pourtant bien, lui, un défenseur de l’égalité des sexes. Ce dont Diaz, étonnamment, ne dit rien, et n’en retient non plus aucune mention sans sa compilation d’extraits.
Ce que dit réellement Meslier
Soyons clairs sur le point de vue politique de Meslier : s’il a bien un projet et un programme d’action révolutionnaire qu’il expose en conclusion de son Mémoire, il le fait en homme de son temps. Il le fait aussi fort prudemment, ne se risquant pas à se prononcer sur les formes politiques à créer lorsque la société communiste qu’il prône aura triomphé.
À la seule exception près où, dans sa « Conclusion », s’il écrit (et répète tant il l’a dit auparavant[10]) qu’il s’agira d’« établir parmi vous de bons, de sages et de prudents magistrats qui soient pour vous gouverner paisiblement », il ne parle pas de la manière concrète dont devrait être politiquement organisée et dirigée la société future. Et s’il est très clair sur le caractère communiste de cette société, celle où l’on travaillerait tous et partagerait tous en commun les ressources de la terre et les fruits de ce travail, il laisse, sans tirer de plans sur la comète, faut-il croire, aux peuples libérés de la domination des puissants le soin de décider eux-mêmes de la façon dont ils se gouverneraient.
Pour clore le débat, rien ne vaut mieux que de reprendre l’ensemble des peu nombreux passages de son Mémoire oùMeslier traite de la façon dont doit être dirigée la société qu’il prône, où l’on partagera en commun les richesses de la nature et du travail, comme aussi l’éducation des enfants. Ce sont bien là les seules mentions qu’il consigne, mais elles sont fort instructives :
Les « maux et méchancetés ne seraient certainement point si les hommes établissaient entre eux une juste proportion d’états et de conditions, et telle qu’il serait seulement nécessaire pour établir et garder entre eux une juste subordination et non pas pour dominer tyranniquement les uns sur les autres » (VIe preuve, chap. 42)
« Tous les hommes sont égaux par la nature […] ; mais comme ils vivent en société et qu’une société ou communauté d’hommes ne peut être bien réglée ni se maintenir en bon ordre sans qu’il y ait quelque dépendance et quelque subordination entre eux, il est absolument nécessaire pour le bien de la société humaine qu’il y ait entre les hommes une dépendance et une subordination des uns aux autres ; mais il faut aussi que cette dépendance et que cette subordination des uns aux autres soit juste et bien proportionnée […] » (VIe preuve, chap. 42)
« une société ou communauté d’hommes ne peut être bien réglée ni se maintenir en bon ordre sans qu’il y ait quelque dépendance et quelque subordination entre eux, il est absolument nécessaire pour le bien de la société humaine qu’il y ait entre les hommes une dépendance et une subordination des uns aux autres ; mais il faut aussi que cette dépendance et que cette subordination des uns aux autres soit juste et bien proportionnée (VIe preuve, chap. 42)
Dans la « Conclusion » de son Mémoire, Meslier ne cesse de le répéter :
« De bons magistrats sont capables de bien gouverner les autres ; ils sont capables d’établir de bonnes lois et de faire de bons règlements de police […] c’est donc dans les actions sages qu’il faut chercher cette sagesse et cette prudence qui sont si nécessaires pour bien gouverner, et ainsi, ce sont des anciens remplis de prudence et de sagesse qu’il faut établir pour gouverner sagement les autres. » Conclusion, chap. 96
S’adressant à ses « chers peuples », il leur dit :
« Vous serez misérables et malheureux, vous et vos descendants, tant qu’il n’y aura point de juste subordination parmi vous […] » (id.)
« Vous seriez heureux si vous étiez délivrés de ces deux détestables et insupportables jougs des superstitions et de la tyrannie, et si vous étiez gouvernés seulement par de bons et sages magistrats. » (id.)
« Rejetez d’un commun consentement tous vos prêtres, tous vos moines et tous vos tyrans, pour établir parmi vous de bons, de sages et de prudents magistrats qui soient pour vous gouverner paisiblement, pour vous rendre fidèlement la justice aux uns comme aux autres, et pour veiller soigneusement à la conservation du bien et du repos publics, et auxquels vous dussiez, de votre côté, rendre une prompte et fidèle obéissance. » (id.)
« Renversez, comme ils disent, tous ces orgueilleux tyrans de leurs trônes, et mettez en leur place de bons, de doux, de sages et de prudents magistrats pour vous gouverner avec douceur et pour maintenir heureusement en paix. » (id.)
« Que l’on attache l’honneur et la gloire, les biens et les douceurs de la vie, et même l’autorité du gouvernement à la vertu seule, à la sagesse, à la bonté, à la justice, à l’honnêteté, à la probité, etc., plutôt qu’à la naissance et qu’aux biens de la fortune » (id.)
Meslier le répète encore dans sa lettre à « Monsieur le curé de… » par laquelle il présente la teneur de son Mémoire au confrère qui découvrira celui-ci. Il s’agit, écrit-il, de
« mettre tous les hommes dans une juste subordination et établir parmi eux un doux et paisible gouvernement, sans quoi les pauvres peuples n’ont qu’à s’attendre à être toujours misérables et malheureux dans la vie. »« mettre tous les hommes dans une juste subordination et établir parmi eux un doux et paisible gouvernement, sans quoi les pauvres peuples n’ont qu’à s’attendre à être toujours misérables et malheureux dans la vie. »
Voilà, dans le texte, tout ce que Meslier dit de la façon dont il voit l’organisation de la société future. C’est à la fois fort peu et fort éloquent de clarté.
Et pourtant, dans une espèce de « plaidoyer anar pro domo » où il dit repérer les mêmes idées que celles des théoriciens de l’anarchisme (ou de sa variante, le « communisme libertaire »), Diaz trouve seulement en Meslier, et en son Mémoire reconverti en « auberge espagnole », ce qu’il y apporte et désire y trouver : ses propres idées, aussi confuses, aussi peu étayées soient-elles.
On pourrait donc à bon droit aussi se demander depuis quand suivre aveuglément une opinion qui est affirmée sans être argumentée – la sienne – est une attitude anarchiste ! Car pour boucler sa pétition de principe, Diaz, conclut en réaffirmant ce qu’il voulait démontrer sans jamais l’avoir fait : que « tout cela confirme s’il en était besoin [NB : « s’il en était besoin » !] que Meslier fut bien un précurseur de l’anarchisme ».
Dont acte, donc !
Un choix déséquilibré de textes
Pour le reste, on l’a dit, son ouvrage nous livre, comme on en a si souvent fait[11] (pp. 26-143), des extraits du Mémoire. Ceux que propose Diaz ne sont présentés par aucune introduction sans que cela empêche son collecteur de les estampiller crânement comme étant un « nouvel abrégé, mais qui cette fois, respecte intégralement la pensée de son auteur » (p.25). Ces extraits (pp. 26-143), comme tous autres, ont le mérite de donner à lire la pensée de Meslier. Et si Philippe Diaz les aménage pour rendre au texte, dit-il, « sa modernité », il le fait, rendons-lui cela, sans le travestir comme, jadis, l’avait fait Voltaire dans son l’Abrégé.
En revanche, parce que ces extraits ne sont pas le moins du monde présentés dans la structure qu’avait voulue Meslier, le texte du Mémoire s’y retrouve immanquablement saucissonné sans grande cohérence. Ils n’offrent qu’une vue fort partielle, partiale aussi : celle du choix de celui qui les a triées.
Cette sélection d’extraits fait la part belle à la première partie du Mémoire, là où Meslier critique les aberrations des textes bibliques, dénonçant leurs abracadabrances. C’est, somme toute, la partie la plus facile d’accès, mais aussi la plus datée, à destination expresse de ses paroissiens « et de tous leurs semblables », ceux de son temps. La partie la plus abordable pour les masses par laquelle il voulait alors détruire toutes les raisons qu’il y avait de croire au travers de la démolition des miracles, des révélations et des prophéties que les gens du peuple invoquaient… à leur époque donc.
Mais aujourd’hui ? Ce ne sont plus ces arguments bibliques qui amènent les croyants à avoir la foi. Et ce ne sont plus les Églises ou aucun autre culte qui font l’opinion, mais les télés et autres grands médias mainstream qui mènent les peuples à accepter la politique des puissants. Ce n’est donc pas spécialement la partie du Mémoire de Meslier qui convient, ainsi que Diaz l’indique dans son titre, « pour le XXIe siècle ».
Autre grande absente dans cette sélection très personnelle de citations du texte de Meslier, la démonstration matérialiste par laquelle il innove et précède véritablement Holbach. Elle est réduite, je l’ai dit, à la portion congrue, très congrue (pp. 74-85). Quant à la longue et minutieuse critique de l’âme immatérielle que chérissent les cartésiens autant que les chrétiens, et à laquelle Meslier se livre en prenant Malebranche comme repoussoir, pas un mot dans les pages qui suivent (pp. 85-91), intitulée par Diaz « un Dieu immatériel » : quelle lacune ! Car sur cette question que Meslier s’affirme comme le véritable pionnier du matérialisme moderne, avant La Mettrie, Holbach et Diderot.
Des extraits d’ordre philosophique particulièrement rachitiques (quantitativement aussi : quelque quarante pour cent de son Mémoire) au regard de l’importance que Meslier y accorde à démolir toute idée de Dieu et à démontrer comment la matière se débrouille si bien toute seule, ayant « d’elle-même son être et son mouvement »[12].
Des centaines de pages dans lesquelles on ne trouve bien sûr aucune mention d’une quelconque annonce ou amorce de la théorie darwinienne que Diaz dit se trouver chez Meslier[13] – comment d’ailleurs aurait-ce été possible ?
On n’y trouve pas plus de mentions, ce qui ici est particulièrement dommage, et dommageable pour rendre de compte de la pensée mesliériste, de sa théorie de la matière qui, incréée, contient en elle-même son propre mouvement et organise la vie, le monde et son évolution. Quel manque ! Quel gâchis de ce qui fait de l’œuvre de Meslier un moment capital dans l’histoire des idées philosophiques !
Philippe Diaz en a-t-il seulement conscience ?
ANNEXE
Libertés et arrangements, petits et grands, avec l’histoire
p. 7
Le texte commence avec des approximations historiques qui, si elles ne sont pas bien graves en soi, démontrent le peu de peine pris à vérifier ce qui est dit : ainsi, Meslier avait-il pensé la lutte des classes « 150 ans avant Marx », là où c’est quelque 120 ans avant le Manifeste.
On l’a dit, on trouve aussi, même première page, cette aberrante incongruité, reprise en page 4 de couverture qui plus est, où Diaz nous raconte que Meslier « fut le premier » à « esquisser la théorie de l’évolution 100 ans avant Darwin ». Passons sur les fort approximatifs « 100 ans » avant que, en 1859, Darwin ne publie son Origine des espèces. On cherchera en vain la moindre démonstration de cela, qui est tout simplement pure invention, rien d’autre : il n’y a, de fait, rien dans le Mémoire qui puisse faire penser à une quelconque théorie de l’évolution des espèces, qu’elle soit darwinienne ou lamarckienne ! Meslier s’en tient à sa démonstration du mouvement interne à la matière, mais se garde bien d’invoquer que les animaux et les plantes dont il parle seraient le produit d’une quelconque évolution d’espèces qui les auraient précédés. Tout ce qu’il affirme est que tout évolue en raison du mouvement interne à la matière. Rien de darwinien en cela. En revanche, tout du matérialisme philosophique, que Diaz occulte.
pp. 7-8
S’ensuit l’idée que Meslier « est le premier avant Proudhon et sa célèbre [sic] “La propriété c’est le vol” à formuler le besoin d’abolir la propriété privée, principale cause des inégalités, et à promouvoir la possession commune des biens ». Qu’en est-il deux siècles avant lui de Thomas More ? Ou encore, par exemple, de ce qu’écrivaient et pour quoi se battaient les révolutionnaires communistes Münzer au XVIe siècle et Winstanley au XVIIe ? Ne précédaient-ils pas Meslier ?
p. 8
Si Diaz dit bien que Meslier a « écrit un traité sur l’athéisme, non pas en tant que concept intellectuel, mais en tant qu’outil de libération des peuples », il n’expose pas en quoi réside ce lien entre athéisme et libération populaire, alors même que celui-ci est loin d’être évident en son époque où l’athéisme est une pensée réservée à l’élite. Il préfère reprendre, contre toute évidence historique, l’assertion fausse d’Onfray que Meslier serait « en fait le premier à affirmer que Dieu n’existe pas »[14]. Car sous le manteau, et sous la répression quand elle était affirmée, cette idée circulait déjà avant Meslier. Pour ne prendre qu’un exemple, citons, quelque cinquante ans avant lui, Matthias Knutzen, ce « Meslier allemand » pourrait-on dire, tant il le précède tant dans la pensée athée que dans la critique sociale. L’innovation historique que représente l’auteur du Mémoire, en revanche, a été de produire la première somme systématique et achevée d’athéisme, combinée à une conception philosophique et à la première pensée révolutionnaire pour instaurer le communisme, non au travers de l’imagination utopique, mais par l’action révolutionnaire des masses. Ce qui, à défaut d’être le premier à affirmer l’athéisme, n’est vraiment pas mal du tout pour un petit curé de village ! Diaz aurait pu s’enthousiasmer là-dessus, ç’aurait été à raison.
p. 9
Passons sur quelques affirmations péremptoires, à l’emporte-pièce, telles que : il écrivait « seulement la nuit » ; son traité fait « 1.000 pages », là où ce nombre, en fait, est approximativement, celui des pages imprimées, quand Roland Desné les publiera en 1970-1972. Le Mémoire fait entre quelque 274 feuillets et 366 feuillets recto-verso[15], pour ceux dont nous possédons une description mais sont aujourd’hui perdus, et un nombre intermédiaire de feuillets qui varie selon les trois versions des manuscrits autographes qui ont été conservées à la BnF (306, 333 et 352 f. r-v).
p. 9
Diaz avance que Meslier se réfère à Descartes qui « préconise le doute méthodique », là où Meslier n’a cure de cette méthode pour connaître le réel. Il ne la retient pas dans les éléments qu’il emprunte incidemment à Descartes, au travers de la connaissance qu’il a du cartésianisme par ses lectures de Malebranche et de Fénelon. En invoquant cette idée, Diaz montre, bien involontairement sans doute, que sa connaissance qu’il a de ce qui intéressait Meslier chez Descartes est pour le moins inventive. Aussi, quand il parle pour ce dernier d’un « recours constant au libre examen » : les preuves qu’il avance de l’existence de Dieu participeraient-elles de ce constant recours ?
p. 9
Meslier serait, d’après Diaz, « le premier dans l’histoire des idées à défendre » les animaux : qu’en est-il alors de Montaigne avant lui, que Meslier cite abondamment comme « judicieux » auteur, et notamment au travers sa défense des animaux ?
p. 11
Meslier « fut probablement également influencé » par Gassendi ! Malheureusement pour Diaz qui l’affirme sans preuve, le fait est que Meslier ne parle jamais et ne cite à aucun moment ce penseur ! Lui qui pourtant n’hésite jamais à citer ses sources à l’appui de ce qu’il dit, il ne le fait jamais pour Gassendi que, plus que vraisemblablement, il ne le connaissait pas !
pp. 10-11
Le style redondant, « ennuyeux », « illisible » de Meslier est, pour Diaz, la raison pour laquelle « très peu de gens l’avaient lu ». Ignorant, ou ne se préoccupant pas de ce que les titres « à rallonge » (en forme d’abstract de l’époque en somme) étaient monnaie courante au temps de Meslier, l’auteur invente que la difficulté d’aborder le Mémoire « peut se comprendre juste à la lecture du titre ». À l’inverse, comme l’a si bien montré Roland Desné[16], Meslier écrivait dans son style « de curé » pour convaincre, insistant, répétant, tapant plusieurs fois sur le clou, multipliant les redites pour se faire comprendre, comme sans doute il le faisait à destination de ses paroissiens en grande majorité analphabètes (les nombreuses croix faisant lieu de signature au bas de ses registres paroissiaux en attestent).
p. 11
Diaz affirme que Meslier « ne s’est soucié ni du style ni des répétitions » et qu’« il écrivit ces mille pages, probablement sans se relire et sans réaliser qu’il avait déjà expliqué la même chose plusieurs fois auparavant. »… ! Mais comment peut-on dire cela ? Comment Meslier aurait-il alors recopié au moins quatre fois son Mémoire si ce n’est pas là se relire ! Reprenant cette idée qu’Onfray a déjà évoquée – montrant par là qu’il n’a pas lu le Mémoire de Meslier, ou l’a au mieux peut-être survolé –, et dans les termes mêmes par lesquels son mentor idéologique l’évoque, Diaz avoue qu’il n’y voit qu’« une structure presque totalement obscure à la première lecture » du texte de Meslier. Celui-ci, au contraire, présente en fait une grande cohérence et est très structuré, avec une introduction, trois parties distinctes (antireligieuse, sociale, philosophique) réparties en chapitres, et une conclusion dans laquelle Meslier expose son projet révolutionnaire.
p. 12
Diaz, sans vérifier le moins du monde, reprend l’information qui circulait au XVIIIe siècle selon laquelle « on parle de plus de deux cents copies circulant à Paris quelques années après sa mort », sans se rendre compte qu’il s’agit, pour la plus grande partie de ces copies, non du Mémoire lui-même, mais des abrégés que Voltaire a repris à son compte après les avoir remaniés à sa sauce.
pp. 14-15
Diaz propose une généalogie fantaisiste de Meslier. Ainsi y retrouve-t-on, parmi ses ancêtres, « selon les recherches des historiens » (!), qu’il est né et a vécu « dans une famille de la petite bourgeoisie de province et non pas, comme le prétendra Voltaire, dans une famille d’ouvrier », là où Maurice Dommanget avait déjà, en 1965, exposé que ses parents étaient à la fois des paysans plutôt aisés, des ouvriers l’hiver qui travaillaient le serge, et des commerçants vendant leur production.
Et Diaz ajoute : « Ces [sic] ancêtres comportent des prêtres et des avocats » ! Mais où a-t-il été trouvé cela ?
p. 15
Diaz écrit que c’est à onze ans que « son père l’envoya » au séminaire de Reims, et que c’est là que le petit Jean « lut tous les livres religieux qu’il trouva », « il lut tout avec avidité et commença à prendre des notes sur les passages qui le questionnaient ».
Mais où, diable, Diaz a-t-il trouvé cela ? Quelle histoire romancée, inventive ! D’après les notices biographiques le concernant, ainsi que le note Maurice Domanget, il aurait à cet âge d’abord été confié à un curé du voisinage pour y apprendre le latin avant de rejoindre le séminaire de l’archevéché[17]. Quant à sa boulimie de lecture et ses « prise de notes », on n’en trouve mention nulle part ailleurs. L’ensemble des informations avec lesquelles il nourrit son Mémoire viennent de lectures et prises de notes contemporaines à l’écriture de celui-ci, qui précèdent directement ou sont parallèles à la première rédaction de celui-ci.
p. 15
Disant se fonder sur ce que Maurice Dommanget avait écrit, il affirme qu’il « est tout à fait concevable que Meslier ait pu rencontrer Bayle ». Nouvelle assertion malheureuse, puisque Dommanget dit précisément le contraire ! Le premier grand biographe de Meslier expose patiemment qu’il « n’a pu profiter du séjour de Bayle tout près d’Étrépigny pour mettre à contribution par contact direct » ce penseur et que, s’il cite « assez souvent » son Dictionnaire Historique, « dans toute son argumentation concernant le christianisme », Meslier « paraît avoir ignoré ses autres ouvrages » et « fait silence » sur lui[18]. Le fait est qu’en 1681, alors que Meslier n’a que dix-sept ans, Louis XIV fait fermer l’Académie de Sedan et que Bayle doit s’exiler aux Provinces-Unies.
p. 16
Entre autres errements, sans que l’on sache d’où il sort tout cela, après avoir encore, à la page précédente, évoqué une histoire de conflit familial auquel il aurait été mêlé quand il avait dix-sept ans, Diaz revient encore sur son jeune Meslier insatiable de lectures : « il dévora tous les livres d’histoire ancienne qu’il put trouver et continua à analyser tous les textes sacrés chrétiens qu’il compara aux textes païens, mais aussi à ceux d’autres religions ». Quelle imagination ! Et, nota bene pour ces textes d’autres religions : Meslier n’en parle pas sinon allusivement dans son Mémoire, et au travers d’ouvrages historiques qu’il possédait dans sa cure au moment de la rédaction de son Mémoire.
pp. 19-20
Diaz reprend péremptoirement comme vraie l’antienne éculée, due à Voltaire[19] sur un voyage à Paris qu’aurait fait Meslier « pour continuer ses recherches » (p. 19), où il aurait aussi commencé à avoir « des discussions animées, entre autres sur Descartes » avec le Père Buffier. Cette histoire, relatée par Maurice Dommanget avec beaucoup de prudence (« on rapporte que… » dit-il) et sans pouvoir la situer, si jamais elle était vraie [20], n’a jamais été étayée par aucune preuve et personne, et notamment l’historien Guennadi Koutcherenko qui avait enquêté sur cette question dans les années 1960, n’a jamais pu établir cette relation entre Meslier et Buffier, ni son voyage à Paris, qui semble bien plus hypothétique que réel.
pp. 20-21
Les relations tendues de Meslier avec le seigneur local, Toully, et son incartade avec lui, qui pourtant sont largement avérées par le procès-verbal d’audition de l’archevêque Mailly qui le convoqua à ce propos[21], est racontée de façon purement extravagante et fantasque : le seigneur, lit-on sous la plume de Diaz, « n’hésita pas à enlever les enfants des familles protestantes pour les baptiser de force et les rééduquer » !
Enfin, après avoir été puni par l’archevêque (un mois de pénitence au séminaire de Reims), Diaz note que « de retour à Étrépigny, il ne désarma pas et continua son combat pour les habitants de sa commune ». À l’inverse, on le sait pourtant, muselé par la collusion du prélat et du hobereau local, Meslier laissa le seigneur tranquille. En revanche, lui qui avait ainsi été vaincu dans la bataille du village, se résolut à bien plus : à mener la guerre entière contre l’ordre féodal et monarchique. Ce le sera en rédigeant son Mémoire dénonçant notamment cette accointance de l’Église et de l’État.
p. 22
Étonnamment, cette dispute où Meslier avait refusé de recommander au prône le seigneur est placée, non en 1716 où elle eut réellement lieu, du vivant de ce seigneur mais… à la mort de celui-ci ! Comprenne qui pourra !
pp. 22-23
Sur le Mémoire de Meslier (qu’il persiste à appeler erronément « Testament », titre que Voltaire donne à son extrait trafiqué et que reprend Onfray), Diaz parle sans trop de souci de deux, puis de trois copies, ajoutant, « certains pensent quatre », ce que Miguel Benítez a pourtant établi de façon indiscutable[22]. Il se lance ensuite dans une histoire rocambolesque et pleine d’erreurs historiques où Meslier, selon notre imaginatif auteur, « essaya de faire croire à ses amis prêtres qu’il n’y en avait qu’un seul ».
p. 24
Quant au récit de la destinée de son Mémoire – dans laquelle on est entre autres amené à lire cette aberration que Voltaire, ce pourfendeur de « l’infâme », aurait été « extrêmement religieux » – on apprend que Le Bon Sens, texte anonyme d’Holbach qu’après la Révolution, un éditeur avait ingénieusement intitulé Le bon sens du curé Meslier serait, non la synthèse vulgarisée de son Système de la Nature, mais… « un nouvel extrait du Testament » !
À ces abracadabrances, Diaz ajoute « un troisième abrégé » qu’il dit beaucoup plus « fidèle » et qui n’est autre que le petit opuscule fait dans les règles du genre, par questions et réponses : le Catéchisme du curé Meslier que Sylvain Maréchal a publié en 1790, se couvrant lui aussi de la notoriété dont jouissait alors le nom curé d’Étrépigny[23].
p. 25
Dernière exagération : sur la connaissance des idées les plus radicales du Mémoire de Meslier par les « doctrinaires de la révolution française » qui ne savaient sans doute de Meslier que de qu’en disait l’Abrégé expurgé de Voltaire, Diaz convoque à nouveau à son secours son mentor Onfray qui, dans ses élucubrations et son style fleuri, écrivait qu’ils « n’auront qu’à se baisser pour ramasser les fleurs rouges et noires du Testament ». Amen, donc.
[1] Philippe Diaz, Jean Meslier, curé, athée et anarchiste pour le XXIe siècle, L’Harmattan, 2025, 167 p.
[2] Jean Meslier et l’imposture spirituelle, Presses de l’Université Laval, 2021, 103 p.
[3] (Les ultras des Lumières. Contre-histoire de la philosophie, IV, Paris, Grasset, 2007, p. 40, aussi sa « Préface » au livre de Thierry Guilabert, Les aventures véridiques de Jean Meslier (1664-1729). Curé athée et révolutionnaire, éd. Libertaires, 2010, pp. 8, 14 et 18.
[4] Ibid., Contre-histoire, p. 70 et « Préface », p. 8.
[5] Les aventures véridiques de Jean Meslier (1664-1729), op. cit., respectivement pp. 88, 201 et 235 ; voir aussi p. 90.
[6] Un recueil de textes fort bien balancé : Roland Desné, Extraits du Mémoire de Jean Meslier (1664-1729) suivis des « Lettres aux curés de son voisinage », Textes présentés, établis et annotés par Roland Desné, d’après le manuscrit autographe conservé à la Bibliothèque Nationale (Millau, L’œil ouvert ; Paris, Éditions rationalistes, 1973, XXXIII-221 p.).
Il y a ensuite l’édition de Textes choisis par Luciano Verona (Milan, Cisalpino-Goliardica, 1975, 104 p.) qui fait suite à son petit livre, Jean Meslier, prêtre athée socialiste révolutionnaire. 1664-1729 (même éd., 1974) ;
puis de rapides « Textes choisis et présentés par Armand Farrachi » qui paraissent en 2000 sous le titre Le curé Meslier. Mémoire, dans lesquels la partie philosophique et matérialiste de l’œuvre est également réduite à la portion congrue (Paris, Exils, 134 p.) ;
ceux que j’ai proposés, largement introduits chacun pour en faciliter la lecture, dans Lire Jean Meslier, curé et athée révolutionnaire. Introduction au mesliérisme et extraits de son œuvre, préface de Roland Desné, Bruxelles, éd. Aden, coll. « Opium du peuple », 2008, 414 p. ;
ceux rassemblés par Marc Genin dans Y. Ancelin, S. Deruette, M. Genin, Jean Meslier. Curé d’Étrépigny (de 1689 à 1729) Athée et révolutionnaire, préface de R. Desné, n° 19 des Cahiers d’Études ardennaises, Charleville-Mézières, éditions Société d’Études ardennaises, 2011, 275 p. ;
puis ceux encore cette même année, de Noël Rixhon : Le curé Jean Meslier : « Dieu n’est pas » (Bruxelles, éd. EME, 2011, 109 p.) qu’il m’avait aimablement demandé de préfacer.
[7] Ainsi par exemple, là où Meslier écrivait de sa plus belle plume :
« […] nos déicoles, et particulièrement que nos déichristicoles, qui se disent être les seuls véritables adorateurs du vrai Dieu, font industrieusement profession de s’attacher principalement à la spiritualité de son culte et à interpréter spirituellement tout ce qui regarde les mystères, les maximes et les cérémonies de leur religion, afin de mieux couvrir sous ce beau et spécieux prétexte de spiritualité, toutes les faussetés et toutes les absurdités qui s’y trouvent […] » (Chap. 72) ;
il nous faut, avec l’aménagement qu’en propose Diaz (p. 87), nous résigner à ne pas percevoir l’ironie avec laquelle Meslier dénonçait l’ingéniosité manipulatoire des « cultivateurs du Dieu chrétien et nous contenter d’un bien plat :
« De plus les chrétiens s’attachent principalement à la spiritualité du culte de ce dieu et interprètent spirituellement tout ce qui touchent aux mystères, aux maximes et aux cérémonies de leur religion, afin de mieux couvrir toutes les faussetés et toutes les absurdités qui s’y trouvent. »
[8] Voir note 5.
[9] Voir note 7.
[10] Au moins quatre fois dans sa « Preuve VI », aux chap. 42 et 48.
[11] Voir note 2.
[12] Mémoire, « VIIe Preuve », chap. 71 (entre autres).
[13] Au début de son « Introduction », p. 7, repris en p. 4 de couverture. Mais rien, étonnamment – heureusement, tant c’est incongru – dans son livre lui-même.
[14] Onfray, dans un de ses jugements dont il a, aujourd’hui comme hier, le secret, affirme que Meslier est « l’inventeur » de l’athéisme… et qu’il l’a trouvé : « il faut, écrit-il, un premier, un inventeur, un nom propre telle une borne à partir de laquelle on peut affirmer : voici le premier athée. » (Traité d’athéologie, Paris, Grasset, 2005, p. 54).
[15] Miguel Benítez, Les yeux de la raison. Le matérialisme athée de Jean Meslier, Paris, Honoré Champion, 2012, pp. 14 et 16.
[16] Voir sa préface au t. Ier des Œuvres de Jean Meslier qu’il a éditées (Paris, Anthropos, 1970).
[17] Maurice Dommanget, Le curé Meslier. Athée, communiste et révolutionnaire sous Louis XIV, Paris, Julliard, 1965, p. 17.
[18] Maurice Dommanget, op. cit.
[19] Il l’évoque dans son introduction à l’Abrégé frelaté qu’il avait fait du Mémoire et que cite encore en 1830 l’abbé Bouillot, dans la note biographique qu’il consacre à Meslier. Voir Œuvres de Jean Meslier, op. cit., T. III, 1972, pp. 400-401.
[20] Op. cit., pp. 44-45.
[21] Nous l’avons publié dans Yvon Ancelin, Serge Deruette, Marc Genin, op. cit., pp. 44-47.
[22] Miguel Benítez, op. cit., pp. 11-24 et 692-696.
[23] Il a été réédité sans mention de date (en 2013, comme m’en informe Raymond Roze des Ordons, un de ses trois éditeurs) aux éd. Syrare, 65 p.
Post a Comment
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.