
La démocratie n’est pas soluble dans le pouvoir divin
Pierre Gillis
On pourrait aussi dire que la souveraineté populaire ne procède pas d’une délégation du pouvoir divin. Cette idée n’est certes pas toute récente, mais sa vigueur et sa pertinence m’ont à nouveau sauté aux yeux à la lecture d’un roman de Deon Meyer. Ce dernier est une vedette mondiale du polar. Il réside en Afrique du Sud et écrit en afrikaans, ses romans palpitants dressent un portrait au scalpel de l’Afrique du Sud post-apartheid, de ses avancées et des cruelles désillusions qu’elle a suscitées. Il a pris le risque, avec un de ses derniers romans, L’Année du Lion[1], de quitter le registre du polar et de se lancer dans un récit post-apocalyptique, mais sans quitter le cadre sud-africain. Une épidémie, quelque chose comme une grippe espagnole à la puissance 10, « la Fièvre », disent-ils, a éliminé 95 % de l’humanité ; les survivants tentent de faire société, de reconstruire avec les moyens du bord, de penser et de régler les futures relations sociales – sous la houlette d’un sage, géographe et juriste, féru de philosophie. Le récit est touffu, appelle différents niveaux de lecture – questions écologiques, héritage scientifique, rôle des croyances, légitimité des hiérarchies… La variété des angles d’approche est explicitée par un procédé narratif adapté à l’objectif : l’auteur donne la parole à plusieurs protagonistes de l’aventure, et, du même coup, il nous propose un découpage nerveux et efficace.
Les deux héros de l’histoire sont Willem Storm, le sage, et son fils Nico. Storm est le fondateur d’Amanzi, une « colonie » qui matérialise une utopie démocratique et solidaire. Qu’on ne s’y trompe pas : la saga d’Amanzi n’a rien d’une robinsonnade, c’est la formation d’une société qui est au centre du récit, pas la lutte d’un individu isolé bataillant pour tirer quelques ressources d’une nature hostile. La construction d’Amanzi n’est qu’une des stratégies de survie adoptées par les humains paumés dans un environnement désertifié. D’autres choisissent des voies beaucoup moins recommandables, renouant avec les pratiques nomades des chasseurs-cueilleurs, dans un monde où l’objet de la chasse se centre sur les productions agricoles et artisanales des reconstructeurs. Les bandes de chasseurs-cueilleurs sont des bandes armées de motards pillards. On se retrouve donc d’entrée de jeu dans une situation où les préoccupations militaires sont légitimes, induisant la création d’un embryon d’armée a priori très éloignée des aspirations généreuses des fondateurs de la colonie. Le chef de l’armée est lui-même un personnage central et hors norme : ancien soldat, ancien détenu condamné pour le meurtre de son amie infidèle et de son amant, il a le statut d’un Cincinnatus, chef militaire à qui les pleins pouvoirs sont accordés en phase de conflit aigu, mais qui rend ce pouvoir aux instances civiles démocratiques une fois la menace dissipée et l’agression extérieure vaincue.
Il y a quelque chose de Yuval Noah Harari et de son fameux Sapiens[2] dans la philosophie de Meyer : les instincts animaux des humains sont canalisés par les histoires qu’ils se racontent, celles qui rendent viables, pérennes les organisations sociales de grande envergure. Des problèmes surgissent quand ces histoires se diversifient, et qu’elles développent des visions du monde antagonistes. C’est ce qui se produit rapidement à Amanzi : la fracture qui divise la communauté en devenir oppose la majorité des fondateurs, plus ou moins imprégnés d’une culture moderne, laïque et scientifique, au pasteur anglican Nkozi Sebego, dont la foi a des relents très évangélistes. Le point de vue de Meyer est solidement athée : ce sont deux discours humains qui s’affrontent, aucune place pour une éventuelle transcendance dans cette confrontation. L’antagonisme des positions en présence se traduit par la création de deux « partis » à l’occasion d’élections organisées pour élire le comité directeur de la colonie, « Amanzi libre » d’un côté, et le « Parti des Cœurs vaillants » de l’autre. Le pasteur affirme fortement que le seul président légitime est Dieu ; dans les faits, Dieu a besoin d’un porte-parole, et c’est à ce titre qu’il revendique la fonction présidentielle – par délégation, en quelque sorte. Il s’avère un politicien redoutable, capable de tordre les faits, de manipuler les frayeurs des adhérents à la communauté, voire même de trahir Amanzi au profit des pillards pour provoquer une crise dont il espère être le bénéficiaire. Interviewé[3], Meyer explique comme suit la complexité de ce personnage :
Il incarne les extrémismes religieux, mais il développe aussi l’idée que les hommes et les femmes les plus vulnérables sont attirés par la religion. En Afrique du Sud, la croyance en un dieu prend une importance considérable et, devant l’avenir incertain, beaucoup se tournent vers lui.
Le seul référent philosophique revendiqué par Willem Storm est Spinoza. Lorsque le pasteur Nkozi lui demande s’il croit en Dieu, Willem Storm répond :
Tu sais ce qu’a répondu Einstein, un jour, quand un rabbin lui a posé la question, Nkozi ?
― Non.
― Einstein a répondu : je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l’harmonie ordonnée de ce qui existe, et pas en un dieu qui se préoccupe du sort et des actions des êtres humains.
― Et c’est ce que tu crois ?
― C’est ce que je croyais. Maintenant, en fait, je ne crois plus qu’en Spinoza[4].
Et plus loin :
Spinoza était le premier homme à vouloir séparer l’Église et l’État, le premier à dire que le fondement de toute politique devrait être la liberté individuelle et que la démocratie était le système de gouvernement le plus adapté à la liberté individuelle[5].
Meyer érige ainsi la laïcité en principe premier de la démocratie. À peine les survivants en sont-ils à jeter les bases de leur organisation sociale que ce clivage émerge comme décisif. Le roman évoque très sommairement d’autres lignes de clivage potentielles, comme le développement d’un embryon de marché, trop ténu à ce stade pour être important, ou, moins sommairement, comme la domination du pouvoir militaire, qui pourrait être crucial mais dont la primauté est escamotée par les vertus personnelles du chef de guerre. Meyer nous parle de l’Afrique du Sud, et il indique clairement dans l’interview citée plus haut le rôle énorme que la manipulation religieuse joue dans cette société qui ne concrétise pas les promesses de progrès social associées à la victoire politique de l’ANC, dans les années ‘90. Mais ça se passe ailleurs aussi : Donald Trump célèbre ses succès avec quelques pasteurs évangélistes notoirement réacs, comme Johnny Moore et Robert Jeffress, et il a rendu un hommage appuyé au prédicateur décédé Billy Graham, de sinistre mémoire. On peut aussi penser au Brésil et à l’élection à la présidence du néo-nazi Jair Bolsonaro, élection en faveur de laquelle la mobilisation massive des Églises évangéliques a sans doute été décisive.
Ce n’est pas pour satisfaire mes propres fantasmes que je mets en exergue le volet manipulatoire des gesticulations du pasteur – le complotisme m’énerve copieusement. Ce volet est mis en avant par Meyer, au point que Willem Storm fait longtemps figure de naïf, débordé par les manœuvres de Nkozi. Ce dernier est soupçonné (le roman laisse la fin ouverte quant au bien-fondé de ces soupçons, mais il présente au lecteur quelques solides présomptions de culpabilité) d’avoir communiqué aux pillards des renseignements essentiels pour leur grande opération militaire d’agression, dans l’espoir que la défaite d’Amanzi déstabilise le pouvoir du président élu. Ce scénario me rappelle le procès de Louis XVI : il avait espéré en finir avec la Révolution avec l’aide des armées levées par ses pairs, les monarques européens de droit divin, et en complotant avec ces derniers. Il a heureusement payé cette trahison de sa tête. À Amanzi, la trahison s’avère aussi vaine : les pillards sont défaits, et le président se révèle capable de retourner la confusion politique en faveur du noyau démocratique et laïc, en jouant le pat, comme aux échecs – il démissionne. Ces événements dramatiques débouchent sur une scission de la colonie : le pasteur et ses ouailles la quittent, pour en fonder une autre, qu’ils baptisent New Jerusalem.
Cette fin (ce n’est pas stricto sensu la fin du roman, qui se focalise sur d’autres épisodes que je ne discute pas ici) m’a fait penser à une remarque pertinente de feu Théo Hachez, qui dirigea la Revue Nouvelle de 1994 à 2008, l’année de son décès. Nous avions eu quelques discussions sur le concept de nation, sur sa réalité sociale et son opérationnalité politique, et il m’avait fait part de la proposition suivante, qu’il ne présentait d’ailleurs pas comme lui étant personnelle : une nation existe – la mayonnaise a pris – à partir du moment où une opposition politique majeure ne débouche pas sur une scission, en particulier à la suite d’une défaite politique. Exemple évident : la gauche française a longtemps été majoritaire au sud de la Loire, mais jamais une victoire de la droite à l’échelle nationale n’a débouché sur la tentation de créer une république occitane. La nation française existe. C’est en ce sens qu’il n’y a pas de nation belge : la volonté de la majorité des Flamands de s’inscrire sans réserve dans la mondialisation néo-libérale entre en conflit avec les réticences des Wallons et des Bruxellois à le faire, et la réponse des élites flamandes consiste à vouloir poursuivre leur voie en larguant les Wallons.
Le départ des troupes du pasteur Nkozi peut se lire à l’aide de cette grille. La contradiction entre démocratie et théocratie est décidément inconciliable, il n’est pas possible de faire nation sans trancher à ce sujet. On le savait, bien sûr, je suis conscient que j’enfonce des portes ouvertes, mais est-on obligé de bouder son plaisir en retrouvant cette conclusion dans un grand roman ?
Notes
- Deon Meyer, L’Année du Lion (traduit de l’afrikaans et de l’anglais par Catherine Du Toit et Marie-Caroline Aubert), éd. du Seuil, Paris, 2017. ↑
- Yuval Noah Harari, Sapiens, Une brève histoire de l’humanité, Paris, éd. Albin Michel, 2015. ↑
- Interview de Deon Meyer par Christine Ferniot, Télérama, 15/11/2017, voir le site https://www.telerama.fr/livre/deon-meyer,-un-lion-venu-dafrique-du-sud,n5326834.php/ ↑
- Deon Meyer, op. cit., p. 150. ↑
- Ibid., p. 263. ↑


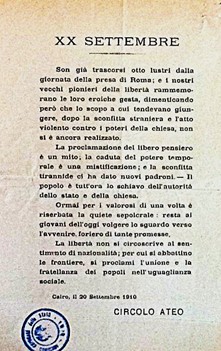

Vous devez être connecté pour commenter.