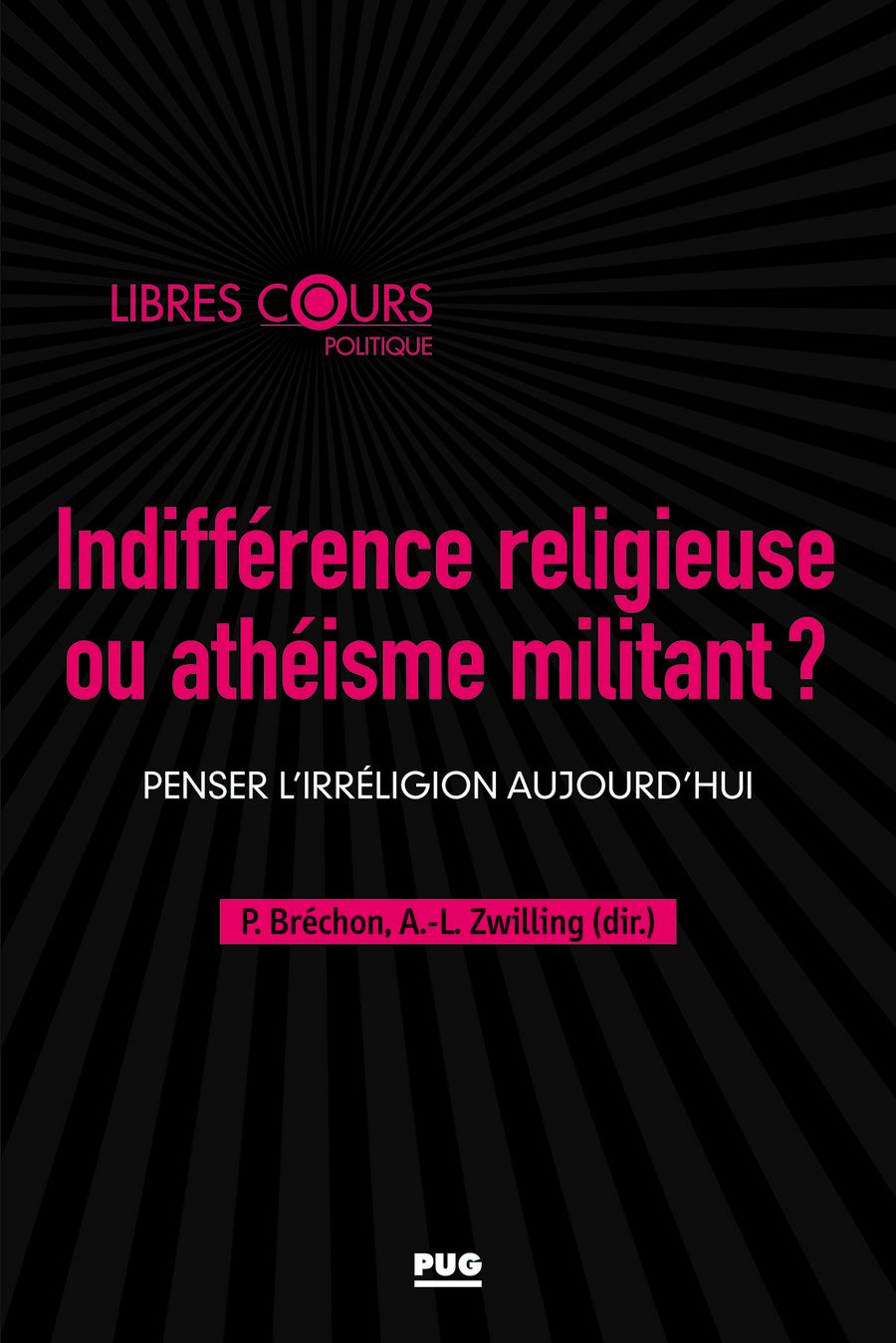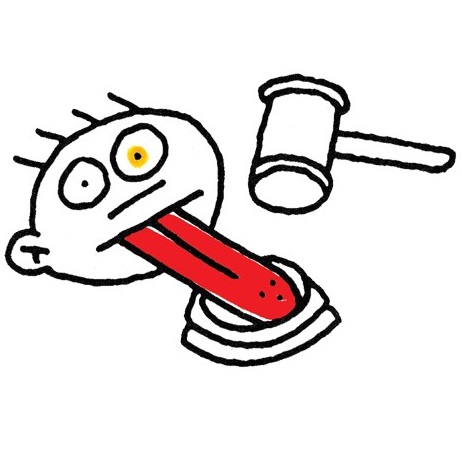L’athéisme, enfin objet d’étude sociologique
Patrice Dartevelle Comme, selon le dicton, « petit à petit, l’oiseau fait son nid », l’athéisme devient un objet d’étude pour les sociologues spécialisés en religions et en croyances. C’est une nouveauté. Dans un ouvrage que j’ai utilisé précédemment, Philippe Portier et Jean-Paul Willaime
La Confession libertine de la Marquise Émilie du Châtelet
Dans cette Confession libertine, comme dans les précédentes entrevues fictives, un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrante ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens de vous faire
Je m’accuse
C’est tout ce que je peux faire. Écrire ces quelques mots, c’est tout ce que je peux faire pour vous. Parfois, on discute ensemble. Quand j’ai le temps, enfin quand cela me prend. Vous, vous avez toujours envie d’en parler,