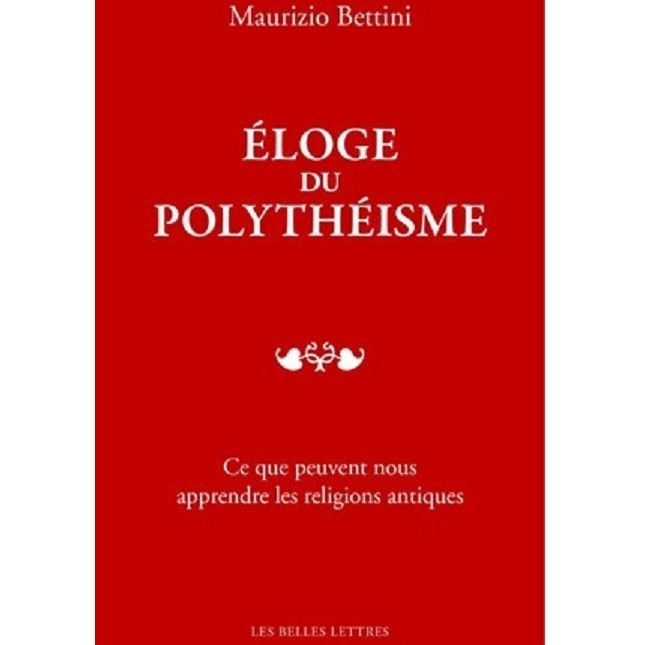L’éloge du polythéisme ou de l’illusion à la confusion
Trouver des vertus au polythéisme antique est une attitude fréquente chez les anticléricaux ou les athées. Il en est longtemps allé de même en Belgique de la part de ces derniers vis-à-vis du protestantisme ou du judaïsme. Sans doute y
Les caractères de l’utopie athée de Dom Deschamps
Penseur athée, l’utopie que propose Dom Deschamps l’est tout autant. C’est un des traits – il y en a tant d’autres – par lequel elle se distingue de celles de ses grands prédécesseurs que sont More ou Campanella, pour qui
Dom Deschamps : un athéisme évanescent
au siècle des Lumières
Le bénédictin français Dom Léger-Marie Deschamps vécut au siècle des Lumières (1716-1774). Comme ses penseurs, il a proposé sa conception du monde et, comme certains d’entre eux aussi, il était athée. Cependant, il s’oppose autant au christianisme et à la