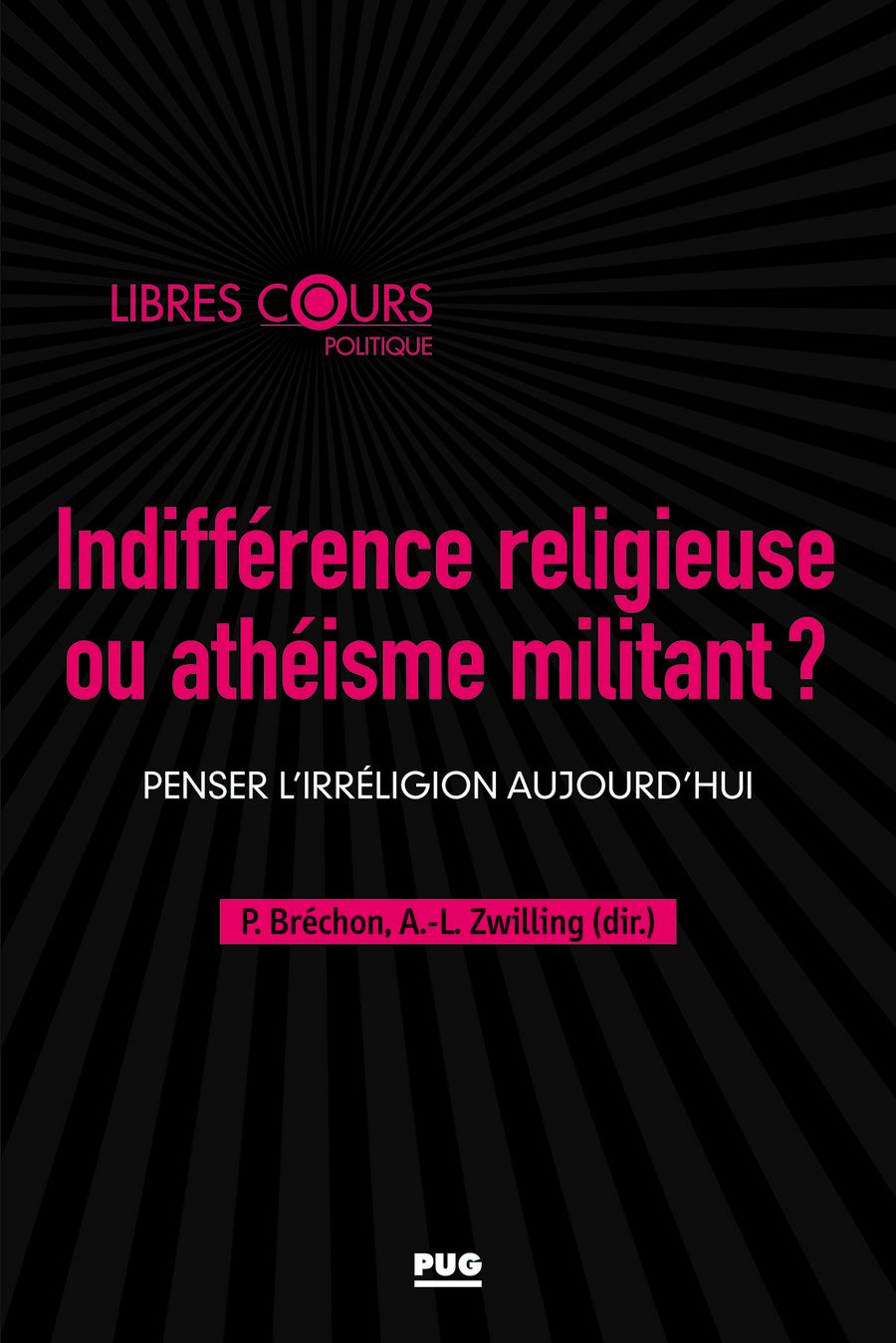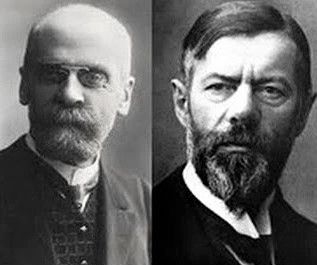L’athéisme, enfin objet d’étude sociologique
Patrice Dartevelle Comme, selon le dicton, « petit à petit, l’oiseau fait son nid », l’athéisme devient un objet d’étude pour les sociologues spécialisés en religions et en croyances. C’est une nouveauté. Dans un ouvrage que j’ai utilisé précédemment, Philippe Portier et Jean-Paul Willaime
Déterminisme et libre arbitre en sociologie
L’opposition entre déterminisme et libre arbitre n’est bien sûr pas une question scientifique que la sociologie serait en mesure de trancher. Ce n’est d’ailleurs, en l’état actuel de nos connaissances, pas une question scientifique du tout : c’est une question métaphysique, préalable