
Vivre et mourir sans dieux
Je suis né dans une famille ouvrière où l’on ne parlait pas ou si peu des grandes questions existentielles. Mes parents, comme bien d’autres au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, étaient davantage préoccupés par les conditions de subsistance du jour suivant que par le questionnement philosophique ou religieux. Si mon père se montrait relativement indifférent à la spiritualité, ma mère, issue d’un milieu catholique, cultivait depuis son plus jeune âge une foi inconditionnelle sans pour autant fréquenter les lieux de culte. En dépit de leurs différences, ni l’un ni l’autre n’éprouvaient le besoin de questionner leurs conceptions de la vie. L’incroyance de mon père lui paraissait naturelle et la foi de ma mère s’apparentait davantage à celle du charbonnier qu’à un chemin spirituel parsemé de doutes. Lui préférait ne pas parler de « ces choses-là » et elle, bien que ne doutant pas du bien-fondé de sa croyance, ne vivait pas sa foi comme un ensemble de certitudes arrogantes. Dans ces couples caractérisés par une mixité confessionnelle assez marquée, la problématique de l’éducation des enfants n’est pas toujours chose aisée. Mes parents eurent l’intelligence d’adopter une forme de Yalta éducatif au terme duquel je fréquenterais l’Enseignement public, mais suivrais le cours de religion au moins durant l’Enseignement fondamental. Il était convenu entre eux qu’à l’entrée dans l’Enseignement secondaire, je pourrais choisir l’option qui me conviendrait le mieux. C’était sans compter avec ma précocité contestataire !
J’ai le souvenir qu’assez rapidement le cours de religion me déplut. Cet homme, au regard sévère, de noir vêtu, me paraissait aussi inquiétant qu’un corbeau prêt à fondre sur sa proie. À longueur d’heures, il racontait à une classe médusée des histoires étranges et parfois cruelles qui me mettaient mal à l’aise. Tel un acteur de théâtre, sa prosodie ajoutait une note inquiétante au sens mystérieux de ces propos. Je m’ouvris à mes parents de mon malaise et surtout de mon souhait de rejoindre le cours de morale laïque. Ma mère réagit vivement et mon père, respectant vraisemblablement le pacte, n’intervint pas. Je retournai donc avec des pieds de plomb en classe de religion. Un jour, cependant, mon fardeau m’apparut trop lourd à porter. Mon refus de poursuivre dans cette voie était catégorique. Mes parents durent bien se résoudre à m’inscrire en Morale. J’avais dix ans. Rétrospectivement, j’ai le sentiment que c’est dans l’expression de cette volonté enfantine que se trouvent les germes de mon incroyance. Ma mère terriblement déçue ne m’en tint pas rigueur mais, de ce sujet délicat, il n’en fut plus jamais question entre nous. Je sais qu’elle n’approuva pas mes engagements philosophiques ultérieurs et qu’elle en souffrit. J’appris même qu’elle allait régulièrement prier pour recommander à Dieu le fils qu’elle aimait, mais qui refusait de rejoindre le troupeau.
À l’âge de quatre-vingt-six ans, elle fut victime d’un accident vasculaire cérébral qui devait l’emporter deux mois plus tard. À son chevet quotidiennement, je compris qu’elle avait parfaitement conscience de la gravité de la situation. Nous nous ouvrîmes l’un à l’autre comme jamais auparavant. Nous évoquâmes nos souvenirs familiaux dans un climat émotionnel intense. Au détour d’un de ces dialogues, elle me posa une question qui, depuis, n’a cessé de me résonner dans la tête : « Comment fais-tu pour vivre sans Dieu ? ». Sur le moment, je ne sus quoi répondre. Après un long silence, j’en vins à balbutier quelques propos peu cohérents en guise de réponse. Allais-je ajouter de la désespérance à la souffrance d’un être cher qui vivait ses derniers jours ? En pareilles circonstances, avais-je le droit d’instiller dans son esprit le moindre doute ? Comprenant mon embarras, elle n’insista pas, mais je compris à son regard que sa foi lui était d’un grand secours. Au demeurant, il n’est pas sûr qu’en d’autres circonstances, je me serais autorisé à mettre en doute la manière dont elle interprétait le sens de la vie. Elle avait la foi chevillée au corps, une foi non questionnée qu’elle partageait avec nombre de ses contemporains. Quinze années se sont écoulées et je n’ai cessé de m’imaginer le type de réponse que j’aurais pu lui fournir non pour la convaincre, mais pour lui dire que le chemin que j’ai emprunté ne m’a pas conduit à Damas, mais sur les terres de la liberté de pensée, du libre-examen et de l’humanisme.
D’abord, j’aurais voulu lui dire que je récuse l’assertion des contempteurs de l’athéisme selon laquelle l’incroyant serait un être sans foi ni loi. Ma posture sans les dieux ne signifie pas que ma vie fut exempte de foi. En dépit de nombreuses déconvenues, je persiste à croire en l’homme ce qui revient à dire que j’ai foi en l’homme. La nature humaine est complexe, souvent incompréhensible et parfois scandaleuse. Je ne partage ni l’avis de Thomas Hobbes, repris plus tard par Freud, qui prétendait que « l’homme est un loup pour l’homme » ni l’optimisme d’un J.-J. Rousseau. L’homme, cet être qui est capable de bonté et en même temps de cruauté, d’intelligence mais aussi de bêtise, d’inventivité et en même temps d’immobilisme. Cet homme qui peut passer allégrement du noble à l’ignoble et de la petitesse au génie mérite que l’on place en lui beaucoup d’espoir. En tout cas, comme Camus l’exprimait dans « La Peste », je pense : « qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser ». Mon optimisme est mesuré. Je suis bien conscient que certains hommes sont peu recommandables et peu amendables. Pour autant est-ce raisonnable de ravaler tous les hommes au rang de criminels en puissance ? Mon pari fut et reste de faire crédit à tous les hommes d’être capables d’amendement, mais je leur impute la responsabilité de ne point essayer. Outre que l’athée n’est pas dépourvu de foi, il n’est pas non plus contre toutes les lois. Certes, il refuse les lois divines mais contester ces lois ne fait pas de lui un anarchiste qui conteste l’idée même de loi. « Ni dieu ni maîtres » disent les anarchistes. Je peux souscrire à un tel credo si, par maîtres, on entend des clercs affirmant détenir des vérités premières auxquelles l’humanité devrait obéir. Je suis farouchement contre les lois divines mais absolument favorable aux lois publiques sans lesquelles on ne peut, à mon sens, faire société. Dans une société démocratique, les lois publiques supplantent les lois divines ; c’est précisément ce que Ph. Barbarin, primat des Gaules, est en train d’expérimenter. Néanmoins, être légaliste n’implique pas l’acceptation irréfléchie de la loi imposée par le pouvoir législatif. La loi n’a rien de sacré et peut être changée à tout moment si elle s’avère inutile, injuste ou si on lui découvre, chemin faisant, des effets pervers. Ma foi raisonnable en l’homme et la nécessité de placer les lois publiques avant toutes les autres constituent, pour moi, la base d’un bien vivre et sûrement d’un mieux vivre dans la mesure où les religions au lieu de nous rassembler n’ont réussi qu’à nous diviser voire nous élever les uns contre les autres. Le Jésus des Évangiles ne nous avait-il pas prévenu lui qui proclamait qu’il nous apportait « l’épée et le feu » ?
J’aurais aussi voulu dire à ma mère que je récuse avec force l’idée selon laquelle l’église détiendrait le monopole de la morale. Dans tous les secteurs de la vie, la religion s’est ingéniée à prescrire des modes de conduite très précis, chacun étant assorti d’une sanction divine en cas d’inobservance. Qu’il s’agisse de l’alimentation, de l’interrelation humaine mais aussi et surtout de la sexualité, les pères de l’église, à commencer par Saint Paul, ont balisé très sévèrement le trajet de l’homme ici-bas. L’histoire nous montre qu’en cette matière, il y a loin de la coupe aux lèvres. À toutes les époques, les religions ont trahi leurs messages moraux pour satisfaire les plus bas instincts de leurs dirigeants ou zélateurs. En lieu et place des grands idéaux moraux prônés par les religions, nous avons eu droit à ce que Nietzsche appelait « la moraline », espèce de succédané de morale. Le lucre, le stupre, la fornication et la compromission avec les puissants ont été cachés pendant près de deux millénaires. Dans sa pièce « Le Diable et le Bon Dieu », Sartre écrit : « L’église est une putain, elle vend ses faveurs aux riches », expression qu’il emprunte à Savonarole, moine dominicain du XVe siècle qui paiera de sa vie cette terrible accusation. Les temps sont cependant venus pour que ces forfaitures fassent la Une de tous les journaux.
Mais le questionnement de ma mère portait davantage sur ma personne que sur la possibilité de constituer une société hors les auspices des dieux ou des institutions religieuses. Comment son fils pouvait-il vivre sans un dieu à qui s’adresser dans le malheur et la détresse comme elle l’avait certainement fait au cours de son existence ? Elle qui, en dépit de sa croyance, vivait si douloureusement sa fin de vie ne pouvait imaginer son fils spirituellement démuni face à la mort. La réponse que j’aurais voulu lui adresser tient en une phrase : j’ai la conviction que la mort triomphe de toute espérance et que le néant est mon seul avenir. Pour le dire autrement, j’accepte pleinement l’idée que ma vie ne soit qu’un bref instant entre deux néants. Notre naissance doit au plus grand des hasards. Je ne suis finalement que le résultat de la rencontre fortuite d’un ovule lambda et du gagnant d’une course de spermatozoïdes. Quelle chance pour l’un d’entre eux d’arriver le premier. Il aurait tout aussi bien pu terminer sa course le nez contre le latex d’un préservatif ou pire succomber dans une lingette sanitaire. Je suis venu du néant et j’y retournerai sans le moindre doute. N’en déplaise à ces bonimenteurs du ciel, le plus probable est que la vie soit absurde, qu’elle n’ait a priori aucun sens et que nous ayons la lourde responsabilité de tenter de lui en donner un. Dans la conclusion de son livre « La Foi d’un incroyant », F. Jeanson, ami de Sartre, dit : « Je crois que nous avons à exister selon nous-mêmes, à donner sens à notre vie en la vivant, et qu’aucun d’entre nous n’est rien et ne possède rien, mais qu’ensemble nous pouvons tout », et d’ajouter « L’Univers est peut-être “une machine à faire des dieux”. Mais la vraie foi consiste à parier que l’espèce humaine est capable d’incarner Dieu, de le réaliser, d’en finir avec Lui en inventant sa propre humanité ». Vivre sans ami imaginaire, ce n’est ni scandaleux ni héroïque. C’est tout simplement prendre acte de l’absurdité de la vie et s’obliger à lui trouver un sens tant sur le plan personnel que sociétal. Terrible responsabilité, j’en conviens. Mais l’intérêt de notre vie se mesurera à l’aune des efforts consentis par chacun d’entre nous pour la rendre vivable et utile. Plutôt qu’implorer quelques hypothétiques divinités, l’homme serait bien inspiré de ne pas attendre le salut du ciel, mais de tenter par lui-même et avec ses pairs « d’enrayer la banqueroute de l’humanité » (A. Gide).
Je sais que cette réponse risque de ne pas satisfaire grand monde à commencer par ma mère si elle était encore en vie. Mais je me devais à moi-même de répondre à sa question.

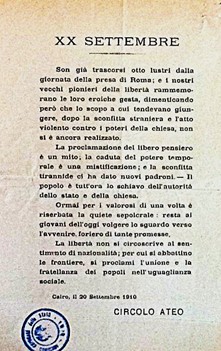


Vous devez être connecté pour commenter.