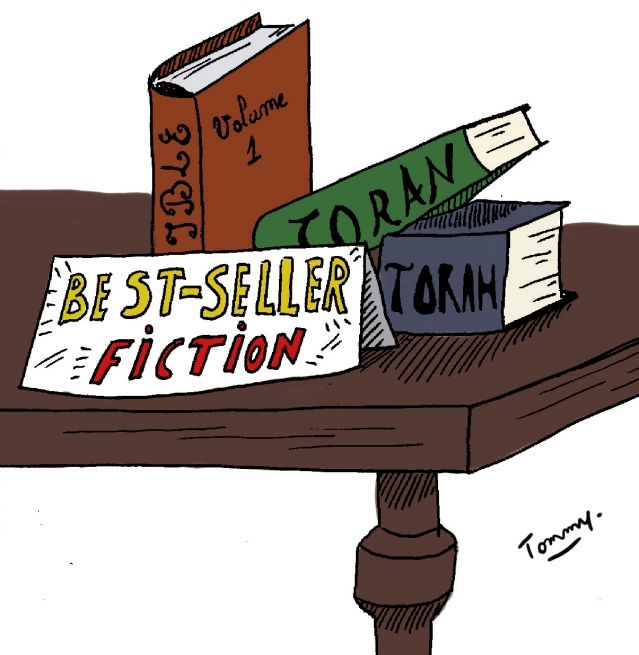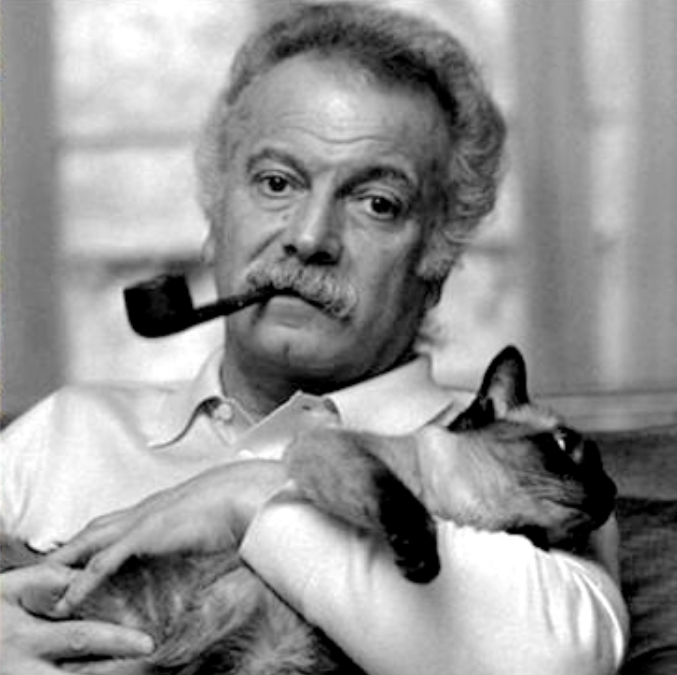S’affirmer athée aujourd’hui
Coming soon
Mais comment peut-on être athée ?
Laïque, pourquoi pas ?
Clovis Trouille, un athée iconoclaste
Le bon vieux petit dictionnaire qui traîne sur nos tables définit l’iconoclaste de diverses manières. Au sens étymologique, donc au sens premier, il s’agit simplement de quelqu’un qui détruit les images et les représentations figurées. Un enfant qui déchire une image,
La folie « ramadanesque »
Dans un communiqué, le Ministère marocain des Habbous et des Affaires islamiques note : « l’observation du croissant lunaire du mois de ramadan 1437 de l’Hégire n’a pas été confirmée, dans la soirée du dimanche 29 chaâbane 1437 A.H. » correspondant au 5 juin
La chanson athée de langue française. Approche sociologique
Dans un premier article (Newsletter n°14), on avait abordé les chansons athées que je qualifierais volontiers d’historiques et on concluait « il en est d’autres ». Dans un deuxième article (Newsletter n°15), on en découvrait les sans dieu (dont quelques belges)