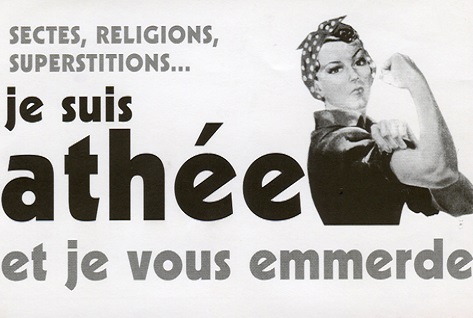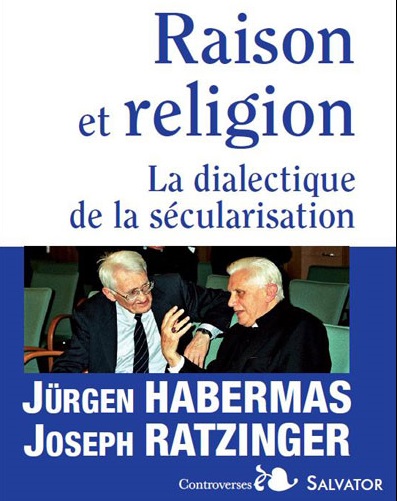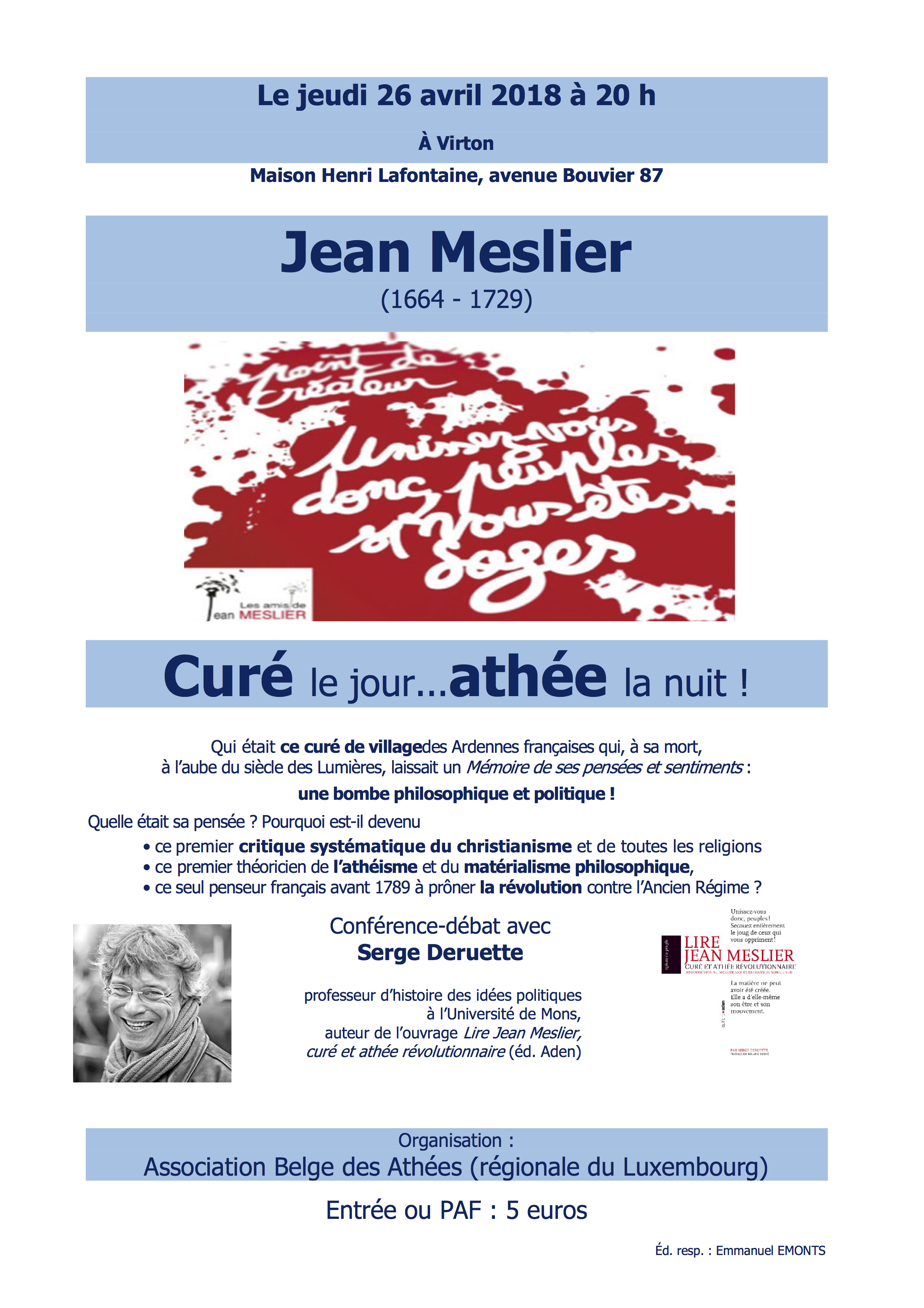Mais comment peut-on être athée ?
Laïque, pourquoi pas ?
De la religion au-delà de Saint-Germain-des-Prés
On est moins que jamais près d’en finir avec la religion, le religieux, la religiosité et, bien entendu, le retour du religieux.
J’ai déjà fait part de mes doutes sur ce retour, sur la faiblesse des arguments intrinsèques en faveur de
Beigbeder, ou l’art de recycler les poncifs les plus éculés
Juste avant d’être frigorifié fin février, j’ai saisi au vol dans une interview, sur « La RTBF - La Première », quelques mots qui m’ont fait dresser l’oreille : « L’athéisme est aujourd’hui difficilement tenable ». En soi, la phrase est ambiguë : difficilement tenable à cause des persécutions dont
La confession philosophique de Bernardino Telesio
Comme dans les précédentes entrevues fictives, un inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant. On trouve face à face l’enquêteur Juste Pape et le suspect Bernardino Telesio. Les réponses attribuées à Telesio dans ce texte proviennent des sources secrètes qui
Conférence à Virton “Curé le jour… Athée la nuit !” par Serge Deruette
Le 26 avril prochain à Virton, la section luxembourgeoise de l’Association Belge des Athées organise une conférence sur l’abbé Meslier. Qui était ce curé de village des Ardennes françaises qui, à sa mort, à l’aube du siècle des Lumières, laissait un Mémoire