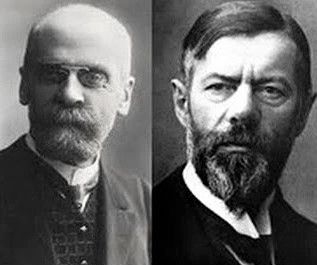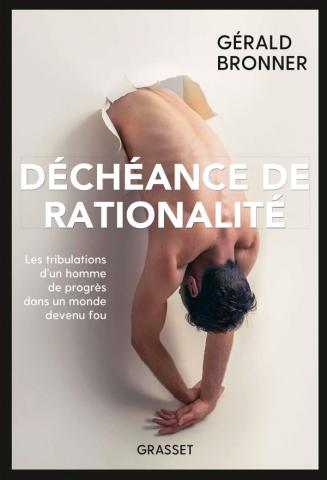Déterminisme et libre arbitre en sociologie
L’opposition entre déterminisme et libre arbitre n’est bien sûr pas une question scientifique que la sociologie serait en mesure de trancher. Ce n’est d’ailleurs, en l’état actuel de nos connaissances, pas une question scientifique du tout : c’est une question métaphysique, préalable
Déradicaliser, la belle affaire…
La question des personnes radicalisées musulmanes, djihadistes, continue de poser bien des questions. Il y a eu le 11 septembre 2001 à New York, l’État islamique et le califat, l’attentat contre Charlie Hebdo et le Bataclan en 2015, le 22