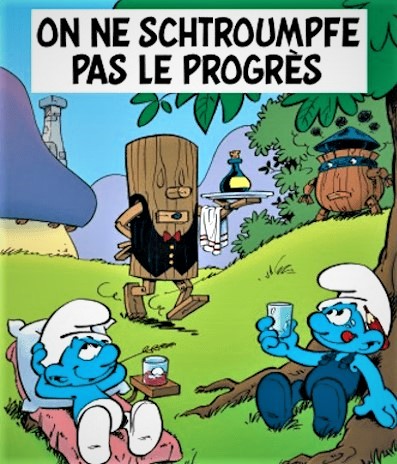Obsolescence du clivage gauche/droite et rationalité
J’adhère sans hésitation au cœur dur de la chronique de Patrice Dartevelle : Adorno, Horkheimer, sans parler du « philonazi » Heidegger ont tout faux ; attribuer aux Lumières et à la raison les catastrophes contemporaines est un contre-sens absolu.
L’héritage des Lumières. Une succession après inventaire
La question de l’actualité des Lumières, de la pertinence d’un retour aux Lumières n’est pas véritablement neuve, celle de l’obsolescence de ses principes va de pair.