
Obsolescence du clivage gauche/droite et rationalité
Pierre Gillis
J’adhère sans hésitation au cœur dur de la chronique de Patrice Dartevelle[1] : Adorno, Horkheimer, sans parler du « philonazi » Heidegger ont tout faux ; attribuer aux Lumières et à la raison les catastrophes contemporaines est un contre-sens absolu. Je ne développe pas.
Malheureusement, et comme souvent, les bêtises proférées par ces penseurs à rebours ne suffisent pas pour que les affirmations de leurs adversaires soient automatiquement validées. Illustration : lorsque Michel Foucault écrit qu’« avant l’affaire Dreyfus, tous les socialistes, enfin les socialistes dans leur extrême majorité, étaient fondamentalement racistes » (noter le glissement de « tous » à « dans leur extrême majorité »), la réponse de Patrice Dartevelle, après avoir concédé l’antisémitisme de Picard, en effet isolé, est tranchante : « pure fantaisie ». Mais si l’on fait le lien entre le colonialisme et le racisme, lien avéré à mes yeux, on est amené à se poser des questions à propos de l’attitude des socialistes au tournant des xixe et xxe siècles. Émile Vandervelde s’est certes longuement exprimé devant le Parlement belge en 1906 pour fustiger les horreurs des sbires de Léopold II, des mains coupées pour quelques tonnes de caoutchouc, mais il s’est aussi arrangé pour être absent lors de la session parlementaire de 1908 au cours de laquelle l’État belge devait accepter le legs du Roi, et transformer l’État indépendant du Congo en colonie belge. Le POB s’y opposait, notamment parce qu’il craignait que cette reprise n’obère les finances du Royaume, mais Vandervelde y était favorable, parce qu’il croyait possible (et souhaitable) de mettre en œuvre au Congo une « politique indigène socialiste », et qu’il pensait que le contrôle exercé par le Parlement pourrait mettre fin aux excès des colons. Position paternaliste, peut-on dire pour ne pas accabler celui qui deviendra le « patron », clairement teintée de racisme en fait, qu’on retrouve dans ses écrits ultérieurs sur le même sujet (Nicolas De Decker parle dans Le Vif du 12 juillet 2020 des « impressions racistes du socialiste Émile Vandervelde »). Je ne sais pas dans quel sens penchait la majorité des socialistes de l’époque, mais les tergiversations et complaisances variées de bien des pontes du POB à l’égard de l’entreprise coloniale ne sont pas de nature à me convaincre que Vandervelde était isolé. Foucault généralise sans se poser de questions, à l’emporte-pièce, mais le mouvement socialiste n’échappait pas au racisme inhérent à la colonisation.
L’affirmation de Foucault n’est donc pas que fantaisie, mais mise en contexte, elle désigne une curieuse manière de globaliser : l’entreprise coloniale se légitimait au nom de sa mission soi-disant civilisatrice, et au-delà, au nom de la raison. Bien sûr, cette plume au chapeau de la colonisation, ce sont les colonialistes eux-mêmes qui l’accrochent. Foucault, adversaire déclaré du colonialisme, ne conteste pas cette association auto-justificatrice, et attribue la responsabilité de cette catastrophe planétaire à la raison. On pourrait produire un raisonnement analogue à propos d’une autre justification du colonialisme, celle qui a emballé le combat contre les négriers arabes, les concurrents de l’époque, dans un grand voile anti-esclavagiste. On pourrait en conclure, à l’instar de Foucault à l’égard de la raison, que l’opposition à l’esclavage et la défense des droits humains sont la cause profonde de la catastrophe coloniale. Personne (ou plus personne), à ma connaissance, n’argumente en ce sens. Allez comprendre…
Le progrès a du plomb dans l’aile
Autre question discutée, et qui appelle, selon moi, des réponses nuancées : la fin du progrès, qu’on l’envisage comme grille d’analyse du passé ou comme projet d’avenir. Les néo-luddites, comme les appelle Patrice Dartevelle, « refusent de reconnaître ou même d’espérer un progrès quelconque. Comme si la vie d’aujourd’hui n’était pas meilleure qu’avant la révolution industrielle ! » Je partage sans la moindre réserve son avis sur l’effet catastrophique de « ces inepties » qu’on entend malheureusement trop souvent proférer à propos des vaccins. Mais comme pour le colonialisme et le racisme, l’esprit critique dont nous nous réclamons doit nous permettre de mesurer la part de vérité éventuellement portée par certains des contempteurs du progrès.
Harari n’est certes pas à situer dans cette lignée – au contraire, au point qu’on peut lui reprocher de la complaisance à l’égard des méfaits de la mondialisation, qu’il sous-estime dangereusement. Pourtant, dans Sapiens, il n’hésite pas à qualifier la révolution agricole, celle qui a transformé les heureux chasseurs-cueilleurs qu’étaient nos ancêtres en malheureux agriculteurs, comme « la pire des catastrophes advenue à l’humanité » : seule l’espèce Sapiens en tant que telle est sortie gagnante de la Révolution, mais celle-ci aliène les Sapiens, elle réduit l’ampleur des connaissances (qui se spécialisent dans les variétés végétales cultivées au détriment de tout le reste), et elle leur fait connaître les joies nouvelles de la famine, en cas de mauvaise saison ou de maladie des plantes cultivées, la fin du nomadisme les privant d’aller chercher plus loin ce qui leur aurait fait défaut. Mais seul le « clap » initial ne participe pas de la vision progressiste d’Harari[2] : pour lui, les tendances lourdes de notre Histoire suivent le fil du progrès des connaissances et des sciences, elles-mêmes indissolublement liées aux progrès de nos architectures sociales.
D’autres ont tenu des propos comparables à ceux d’Harari concernant la Révolution agricole, mais en visant des bouleversements sociaux plus récents, et je n’oserais pas écarter leurs questions ou affirmations d’un revers de la main. Le sort des prolos qui ont brutalement gonflé la population des villes insalubres lors de la révolution industrielle, pour des salaires de misère et dans des conditions de travail inqualifiables, était-il réellement plus enviable que celui des serfs médiévaux ?
La réponse à cette question ne coule pas de source. Au-delà des statistiques qui pourraient étayer mon questionnement, et qu’on peut trouver avec un peu de persévérance, j’invoquerai une impression personnelle, qui remonte à mes séjours au Burundi, il y a une petite dizaine d’années, pour y former des profs de science. Logés à Bujumbura, il nous est arrivé de déambuler en périphérie urbaine, dans les bidonvilles où vit une partie importante de la population. Par ailleurs, quelques plongées dans le « Burundi profond », dans les campagnes sur le flanc des collines, nous ont permis de nous faire une petite idée du mode de vie des paysans qui s’y accrochent. Pauvreté des deux côtés, sans aucun doute, mais ma perception du moment, que je n’ai pas oubliée, est que la misère la plus abominable était urbaine, là où les liens sociaux villageois ont disparu, quand bien même ces liens ne sont pas que de solidarité. Où est le progrès dans ce gigantesque exode rural – qui sévit à l’échelle planétaire ?
Qu’est-ce que ça veut dire, être de gauche ?
Je saute à la question finale de Patrice Dartevelle, qui me guide dans ma propre réflexion, à propos du succès du post-modernisme chez bien des penseurs étiquetés à gauche :
Le mot « gauche » peut-il encore apporter de la clarté ? S. Roza ne voit-elle pas que les critères qui faisaient que quelqu’un était de gauche il y a trente ou quarante ans et ceux qu’on emploie aujourd’hui n’ont plus tant de points communs ?
Question intéressante, même si la formule « tant de points communs » est subjective (combien de grains de sable pour faire un tas ?), qui pousse à tenter une définition du clivage gauche/droite – le seul exemple invoqué (« Le souci de la nature était de droite et celui de la liberté d’expression de gauche ») étant loin d’être décisif à mes yeux, d’autant que j’hésite vraiment à classifier l’amour de la nature à droite (pour ne pas quitter l’époque, on peut citer William Morris, un des fondateurs de la Socialist League (anglaise) en 1884, auteur des Nouvelles de nulle part, grand défenseur de l’environnement et du patrimoine architectural).
Les politologues ont pris l’habitude, quand ils décrivent la Belgique, de citer trois clivages déterminants : la question nationale (Flamands/Wallons), le clivage religieux (cathos/laïques), et la fracture sociale, assimilée à la coupure gauche/droite. Pour les politologues, ces trois axes sont ceux d’un espace tridimensionnel, mutuellement orthogonaux, indépendants les uns des autres. Notons que la division entre classes sociales, qui se déploie le long du 3e axe, ne renvoie pas automatiquement à une opposition d’idées[3] – encore que les idées viennent en appui pour soutenir des intérêts de groupes sociaux, de classes sociales.
Il y a derrière le fait de se dire de gauche ou de droite une prise de parti en faveur des uns ou des autres, dominés ou dominants. Plus précisément, je pense que c’est la manière de définir l’intérêt général qui caractérise le mieux le clivage gauche/droite : s’affirmer défenseur de l’intérêt général n’a rien d’original, chacun prétend l’être (à quelques exceptions près), mais définir l’intérêt général est loin d’aller de soi, nos sociétés sont bien trop contradictoires pour que la notion fasse consensus. On est de gauche quand on identifie l’intérêt général à celui des dominés, l’égalité étant la première des vertus républicaines mise en avant. En somme, le contraire de ce qu’en 1953, Charles Erwin Wilson, le président de General Motors, pressenti pour devenir secrétaire à la défense d’Eisenhower, a déclaré devant le Sénat américain : « Ce qui est bon pour l’Amérique est bon pour General Motors, et vice-versa ». Marx formulait cette idée d’une façon plus sophistiquée : la classe ouvrière s’émancipe en émancipant l’humanité. Phrase qui se laisse retourner : la classe ouvrière émancipe l’humanité en s’émancipant elle-même. Dans cette conception, le combat de la classe ouvrière (ou des dominés, pour élargir le propos) transcende les autres luttes pour l’émancipation, quand bien même celles-ci ne se définissent pas en termes de classes. Le mouvement ouvrier a fait sien ce point de vue, d’abord avec les théoriciens allemands de la social-démocratie, mais surtout dans sa composante communiste, sous l’impulsion de Lénine : son Que faire ? de 1902 est imprégné de cette idée. La lutte sur le terrain de la production économique ne suffit pas, une perspective révolutionnaire doit aller bien au-delà et soutenir les luttes y compris hors de l’usine : contre l’arbitraire policier, contre l’humiliation des nationalités, contre l’impôt écrasant les paysans, etc[4]. Et donc, le militant
ne doit pas avoir pour idéal le secrétaire de trade-union [syndical] mais le tribun populaire sachant réagir contre toute manifestation d’arbitraire et d’oppression, où qu’elle se produise, quelle que soit la classe ou la couche sociale qui ait à en souffrir, sachant généraliser tous ces faits pour en composer un tableau complet de la violence policière et de l’exploitation capitaliste, sachant profiter de la moindre occasion pour exposer devant tous ses convictions socialistes et ses revendications démocratiques, pour expliquer à tous et à chacun la portée historique et mondiale de la lutte émancipatrice du prolétariat.
Au début du xxe siècle, l’ambition était clairement de lier les différents axes, de les forcer à se rejoindre, dans un mouvement historique volontariste que Lénine appelait la fusion du mouvement ouvrier et du socialisme.
De fusion en défusion
Cette ambition s’est traduite dans l’organisation du Congrès des peuples de l’Orient (Bakou, 1920), qui assura le soutien de l’Internationale communiste aux nationalistes progressistes des pays colonisés, et elle a culminé dans les années trente, dans le contexte des fronts populaires, avec la participation active d’intellectuels prestigieux à des rassemblements antifascistes, qui avaient fière allure, et un peu plus tard dans les mouvements de résistance au nazisme.
Et elle a fait long feu depuis lors. Pourquoi ? La réponse la plus évidente est la compréhension progressive de l’imposture stalinienne. La proclamation d’attachement aux libertés démocratiques devient une incantation et perd toute crédibilité face aux procès de Moscou de 1936 et 1938 et face au Goulag. Au point qu’aujourd’hui, l’attachement aux libertés démocratiques est plutôt connoté libéral, un paradoxe quand on sait qu’en Belgique, il a fallu près d’un demi-siècle d’âpre combat de la part du mouvement socialiste pour faire adopter le suffrage universel.
Suffrage d’ailleurs abusivement dénommé universel, la moitié de l’humanité en étant exclue… Le féminisme fait bien partie de ces domaines pas directement liés à la lutte économique, à englober dans le combat universel pour l’émancipation. Sur ce terrain, il faut un peu de mauvaise foi pour pointer le stalinisme comme fauteur de discorde, les Polonais d’aujourd’hui peuvent en témoigner, les reculs des droits des femmes depuis les années 90 sont légion et ne sont pas imputables à Jaruzelski et à son gouvernement. Le rappel de l’origine du choix du 8 mars pour célébrer les droits des femmes est important pour savoir d’où on vient : c’est Clara Zetkin, à l’époque figure de proue de l’aile gauche de la social-démocratie allemande, et députée communiste au Reichstag de 1920 à 1933, qui proposa en 1910 à l’Internationale socialiste des femmes l’instauration d’une journée d’action pour les droits des femmes, finalement fixée au 8 mars. Les revendications mises en avant étaient le droit de vote, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. La convergence entre mouvement ouvrier et mouvement féministe était en bonne voie, même si toutes, côté féministe, ne s’en accommodaient pas, et même si le mouvement ouvrier n’en vint à soutenir le féminisme que lentement… et modérément.
Sur ce terrain aussi, la défusion va bon train. En cause, un problème fortement clivant : comment traiter la question des femmes musulmanes. Sans conteste, celles-ci sont opprimées, et doublement encore bien : comme femmes, et comme membres d’une communauté discriminée chez nous. On peut aussi retenir que jadis (il y a plus d’un demi-siècle), lesdits socialismes arabes (l’égyptien, l’irakien, l’algérien) prenaient en compte et luttaient contre cette double oppression, avec Nasser en fer de lance (et son éclat de rire, souvent rediffusé, à l’évocation du port du voile par les femmes égyptiennes). De l’eau a coulé sous les ponts depuis ; les socialismes arabes ont été vaincus et éliminés par le monde « libre », et le refus de l’humiliation infligée aux immigrées s’est en partie focalisé sur l’affirmation de la légitimité de signes distinctifs, comme le foulard. Au grand dam d’une partie du mouvement féministe, qui ne fait pas une priorité du soutien aux victimes de graves discriminations sociales, et s’en tient à la mise en avant d’un féminisme « pur » dans lequel les femmes des milieux populaires d’origine immigrée se reconnaissent peu. Au point que par rapport à cette problématique, les féministes les moins encombrées du souci de soutien aux populations immigrées et à leurs revendications de justice sociale, soit les féministes de droite (oui, on peut être féministe et de droite), tiennent le haut du pavé : elles ne connaissent pas, et pour cause, les affres de la conciliation – encore moins de l’amalgame – des deux points de vue.
Remarque provisoire, avant de poursuivre : pas grand-chose à voir, jusqu’ici, avec le post-modernisme. Sauf à considérer que la prise en compte des subjectivités des protagonistes des luttes politiques est une découverte des post-modernes, mais à ce compte, Machiavel est un post-moderne avant l’heure.
La rationalité de la priorité écologique
L’allusion à l’amour de la nature comme une valeur de droite mérite qu’on s’y arrête. C’est évidemment l’émergence du courant écologiste qui est dans le viseur. Je suis pour ma part convaincu que la rationalité est du côté des « écologistes » (les guillemets pour ne les pas réduire aux militants ou aux membres du parti Ecolo), et pas de leurs adversaires. La démonstration est faite, du moins je l’espère, en ce qui concerne le réchauffement climatique – les climato-sceptiques sont à la climatologie terrestre ce que les négationnistes sont à l’histoire du génocide juif. Rebondissement piquant des affrontements autour du réchauffement climatique, on aurait tort de se priver d’une auto-critique – certes prudente et timide – d’une des vedettes du post-modernisme français, Bruno Latour. Dans son Enquête sur les modes d’existence (2012), il revient sur ses critiques passées de l’institution scientifique et de la croyance en la puissance de la raison de la part de cette institution, croyance qu’il dénonçait plus tôt comme naïve :
Devant la ruine des institutions que nous commençons à léguer à nos descendants, suis-je le seul à ressentir la même gêne que les fabricants d’amiante visés par les plaintes au pénal des ouvriers victimes de cancers du poumon ? Au début, la lutte contre l’institution paraissait sans danger ; elle était modernisatrice et libératrice – amusante même – ; comme l’amiante, elle n’avait que des qualités. Mais comme l’amiante, hélas, elle avait aussi des conséquences calamiteuses que nul n’avait anticipées et que nous avons été bien trop lents à reconnaître.
De manière plus générale, la problématique de l’épuisement de la planète contraint à des révisions déchirantes, mais encore une fois, pour des raisons profondément rationnelles. Les notions de gauche et de droite ont fait leur nid dans le landerneau politique, acquérant même le statut de clivage central dans l’éventail des positionnements politiques, avec la montée en puissance du mouvement socialiste ouvrier, au cours de la seconde moitié du xixe siècle, je l’ai mentionné plus haut. À l’époque, il n’est pas abusif de qualifier tous les courants présents de productivistes (ou presque tous, à l’exception d’un quarteron de romantiques passéistes), encore que pas tous de la même manière. Les théoriciens du capitalisme, les libéraux classiques, avaient bien compris que le moteur du capitalisme, c’est la reproduction élargie du capital, nécessitant une expansion illimitée de la production – aucune dérogation possible sans toucher à l’essentiel. Du côté des adversaires du capitalisme, le lien n’est pas consubstantiel, mais il est néanmoins fait. Chez Marx, on trouve certes ci et là, dans Le Capital, des formules qui anticipent les débats à venir, avec le percutant qu’on lui connaît :
Au lieu que la terre soit consciemment et rationnellement traitée comme la propriété perpétuelle et collective, la condition inaliénable d’existence et de reproduction de la série des générations successives, nous avons affaire à une exploitation des forces du sol qui équivaut à un gaspillage […] La grande propriété foncière réduit la population agricole à un minimum, à un chiffre qui baisse constamment, en face d’une population industrielle concentrée dans les grandes villes, et qui s’accroît sans cesse, elle crée ainsi les conditions qui provoquent un hiatus irrémédiable dans l’équilibre complexe du métabolisme social composé par les lois naturelles de la vie ; il s’ensuit un gaspillage des forces du sol, gaspillage que le commerce transfère bien au-delà des frontières du pays considéré.[5]
[La production capitaliste en agriculture] « trouble encore la circulation matérielle entre l’homme et la nature, en rendant de plus en plus difficile la restitution de ses éléments de fertilité, des ingrédients chimiques qui lui sont enlevés et usés sous formes d’aliments, de vêtements, etc. […] En outre, chaque progrès de l’agriculture capitaliste est un progrès, non seulement dans l’art d’exploiter le travailleur, mais encore dans l’art de dépouiller le sol ; chaque progrès dans l’art d’accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité.[6]
Les résidus de la consommation sont de la plus grande importance pour l’agriculture. Leur utilisation donne lieu, en économie capitaliste, à un gaspillage colossal : à Londres par exemple, on n’a trouvé rien de mieux à faire de l’engrais provenant de quatre millions et demi d’hommes que de s’en servir pour empester, à frais énormes, la Tamise.[7]
Ces réflexions sont loin d’être anodines, et on peut souligner le terme « métabolisme social », que les théoriciens de l’écologie politique ne récuseraient sans doute pas, ainsi que la perspicacité de la remarque sur la diffusion mondiale des nuisances, mais elles n’ont pas été développées, et elles ne font pas le poids face à ce que Marx écrivit dans sa préface à l’Introduction à la Critique de l’économie politique, un des rares textes dans lequel il synthétise sa démarche :
À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou, ce qui n’en est que l’expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s’étaient mues jusqu’alors. De formes de développement des forces productives qu’ils étaient ces rapports en deviennent des entraves. Alors s’ouvre une époque de révolution sociale.
Autrement dit, la fin du capitalisme (prévisible pour Marx) sera à l’ordre du jour lorsque les rapports de production capitalistes deviendront une entrave pour le développement des forces productives, ce qui revient à imaginer un mode de production capable de faire mieux, et même de faire plus, que le capitalisme.
Le productivisme a fait son temps
Si l’on souhaite ne pas s’en tenir à des énoncés théoriques, on préférera alors se référer à des politiques concrètes. Les frères ennemis de la gauche ont partagé cette vision productiviste : côté social-démocrate, à partir d’une approche « intérieure » au capitalisme, les plus beaux succès étant ceux des Trente Glorieuses de l’après-guerre, où l’expansion capitaliste fut suffisante pour permettre que la classe ouvrière en touche aussi des dividendes (c’est ce qu’on a appelé le compromis social-démocrate, mais la colonisation et le pillage du Tiers Monde n’étaient pas pour rien dans cette expansion). Et côté socialisme « réellement existant » (autoproclamé), dans les démocraties populaires gérées par les partis communistes au pouvoir, l’objectif, formalisé par Khrouchtchev, mais bien présent déjà sous Staline, était de rattraper les États-Unis, de l’extérieur, en quelque sorte. Il est sans doute vain d’évoquer la Chine, où les références à Marx ne sont plus que génétiques, dans le meilleur des cas, mais où l’objectif de dépassement des États-Unis est une réalité forte, depuis Deng Xiaoping.
Il n’empêche que la finitude de nos ressources matérielles sur cette Terre est tout sauf un fantasme de nostalgiques du paradis perdu. L’irrationalité est du côté de ceux qui nient ce fait, pour parler comme les pourfendeurs de fake news. Que notre Terre soit finie, chacun le sait, les marins de Magellan en ont d’ailleurs fait le tour. L’infini, ça ne vaut que pour le cosmos, et encore, ça se discute. Le déni se situe à un autre niveau : une fois les ressources habituelles épuisées, on trouvera bien le moyen de procéder autrement et de s’en procurer d’autres. Qui ça, on ? Les scientifiques, pardi ! Ceux-ci ont beau ne l’avoir jamais prétendu, qu’à cela ne tienne… Étonnant que les performances virtuelles de nos sciences et technologies fassent l’objet d’une pure croyance : savants, donnez-nous notre énergie quotidienne. Curieux retournement, opéré contre certains des acquis solides de cette même science, comme les deux principes de la thermodynamique, celui qui énonce la conservation de l’énergie, et celui qui en prédit la dégradation sous l’effet du lissage des inhomogénéités… Chassez l’irrationnel, il revient au galop !
En l’occurrence, et malgré ses errances multiples, Latour a raison quand il écrit que « tout se passe en effet comme si une partie importante des classes dirigeantes était arrivée à la conclusion qu’il n’y aurait plus assez de place sur terre pour elles et pour le reste de ses habitants. » Les murs contemporains en témoignent, de la frontière mexicaine à celui érigé le long de la ligne verte censée pérenniser le ghetto où sont enfermés les Palestiniens, et les barrages marins ne sont pas en reste, comme celui sur lequel veille Frontex, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, créée en 2004 « pour aider les États membres de l’UE et les pays associés à l’espace Schengen à protéger les frontières extérieures de l’espace de libre circulation de l’UE ».
Nous voici de retour à la case départ, et à l’actualité du clivage gauche/droite : le critère que je propose (est de gauche celle ou celui qui identifie l’intérêt général à celui des dominés) fait pleinement sens, en particulier pour s’y retrouver dans cette problématique réputée purement écologique, souvent renvoyée au-delà du clivage gauche/droite, lui-même décrété obsolète. Face à l’épuisement des ressources naturelles, le déni n’est souvent qu’un paravent destiné à masquer l’érection de forteresses abritant une nouvelle espèce protégée, les dominants du capitalisme mondialisé, quitte à en payer le prix en guerres meurtrières. Ce déni est de droite, contrairement aux programmes politiques qui prônent un autre mode de production et de consommation des richesses – bâti sur la solidarité entre tous les Sapiens. La clarté n’est pas étrangère à cette opposition, qui n’a que peu de choses à voir avec l’amour de la nature…
Cela dit, en plaçant la question sociale au centre de gravité de la faille qui fracture nos sociétés, en faisant de l’opposition de classe la question centrale, on est amené à admettre sans trouble majeur que les enjeux en soient changeants, que les lignes de démarcation soient mouvantes, d’autant plus que les tentatives de cerner les classes sociales sur un mode taxinomique, comme pour le classement des espèces vivantes, ont fait la preuve de leur inanité : comme les forces chez Newton, qui avait compris qu’elles allaient toujours par paires, les classes ne se laissent appréhender que dans leur opposition, l’une par rapport à l’autre.
La variabilité qui affecte les thèmes d’affrontement n’est pas une exclusivité des confrontations politiques. On peut en trouver un bel exemple d’ordre philosophique, puisé dans les développements de la cosmologie. L’univers a-t-il une histoire ? Traditionnellement, les grands récits religieux se sont réservé le monopole de la réponse, élaborée en imaginant une phase initiale d’apparition de l’univers, façonné plus ou moins volontairement par un créateur omnipotent, suivie d’une longue période de fonctionnement en régime stationnaire, dans laquelle nous nous trouvons toujours, et où les choses sont ce qu’elles sont, depuis la création. Les progrès de l’astronomie et de la physique ont permis aux scientifiques de mettre un pied dans ces récits, en provoquant pas mal de tumulte, dont Galilée et quelques autres eurent à payer le prix. Ces interventions se firent de plus en plus systématiques, pour déboucher au début du xixe siècle sur le point de vue d’un Laplace (« Dieu est une hypothèse inutile »), qui envoyait aux oubliettes le mythe de la création, au prix d’une accentuation sans équivoque du caractère stationnaire de l’univers – qui n’avait donc pas d’histoire. La suite fait apparaître un renversement complet, et déboussolant : les progrès de l’astrophysique au xxe siècle ont validé l’idée exactement opposée, avec la découverte des galaxies, l’expansion de l’univers, le Big Bang, la nucléosynthèse et l’histoire de la formation des noyaux atomiques, etc. – l’univers a une histoire, aussi riche que celle des espèces vivantes. Les matérialistes, qui nourrissent leurs conceptions des acquis scientifiques, sont ainsi passés en un peu plus d’un siècle d’une négation de cette histoire, basée sur le rejet des mythes religieux, à une affirmation forte du caractère évolutif de l’univers. Au point que les théologiens font leurs choux gras de ce retournement – certains allant jusqu’à tenter d’instrumentaliser l’astrophysique dans leur entreprise de relecture des mythes…
Mon détour final par une controverse philosophico-scientifique sera peut-être perçu comme hors de propos, mais il ne l’est pas. Les débats politiques, comme les disputes philosophiques, sont en quelque sorte corsetés par les avancées des connaissances, en particulier par les progrès des sciences, et par les bouleversements sociaux. Il peut se faire qu’une avancée décisive mette fin à un affrontement – en tranchant, ou en le vidant de son sens. Laplace n’était pas moins rationnel que Georges Lemaître, mais de 1805 à 1930, la connaissance de l’univers s’est considérablement enrichie, au point de renverser les termes du débat antérieur. En politique, les oppositions décisives séparent les constructeurs de ghettos fortifiés des partisans d’une société égalitaire et accueillante à tous. Sur ce terrain aussi, une question peut acquérir une importance inédite, une pertinence inattendue, et chambouler les termes d’un débat – exemple, le réchauffement climatique. Cela ne met pas fin aux combats pour l’égalité.
Notes
- Patrice Dartevelle, « Le postmodernisme à l’assaut des Lumières », Newsletter de l’ABA, n° 31, déc. 2020. ↑
- J’ai relevé ce paradoxe dans « Fiction et fake news : depuis toujours et à jamais ? », Newsletter 29, juin 2020. ↑
- Je vise une définition « moderne », pas celle qui remonte aux affrontements au sein de la Constituante française de 1789. ↑
- Et dans cet etc., on peut évidemment inclure la liberté d’expression, sans extrapolation abusive. ↑
- Karl Marx, Le Capital, Éditions Sociales, Paris, 1976, Livre III, p. 735. ↑
- Ibid., Livre I, p. 360. ↑
- Ibid., Livre III, p. 111. ↑


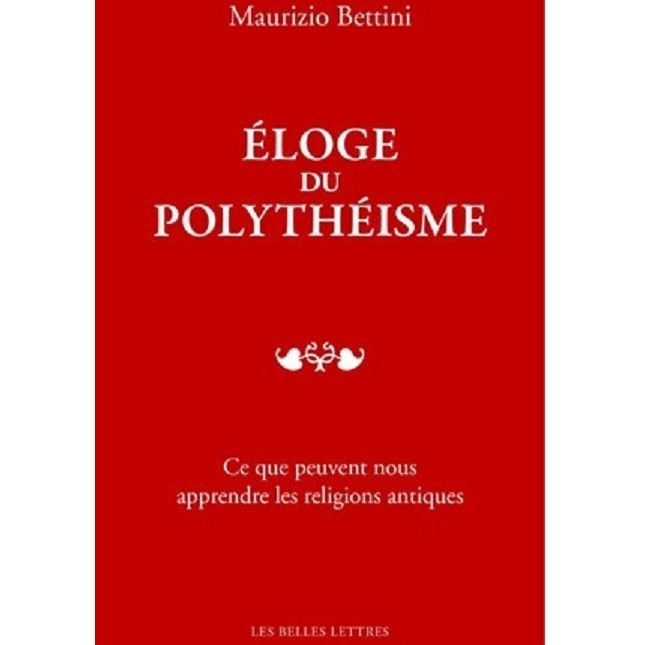

Vous devez être connecté pour commenter.