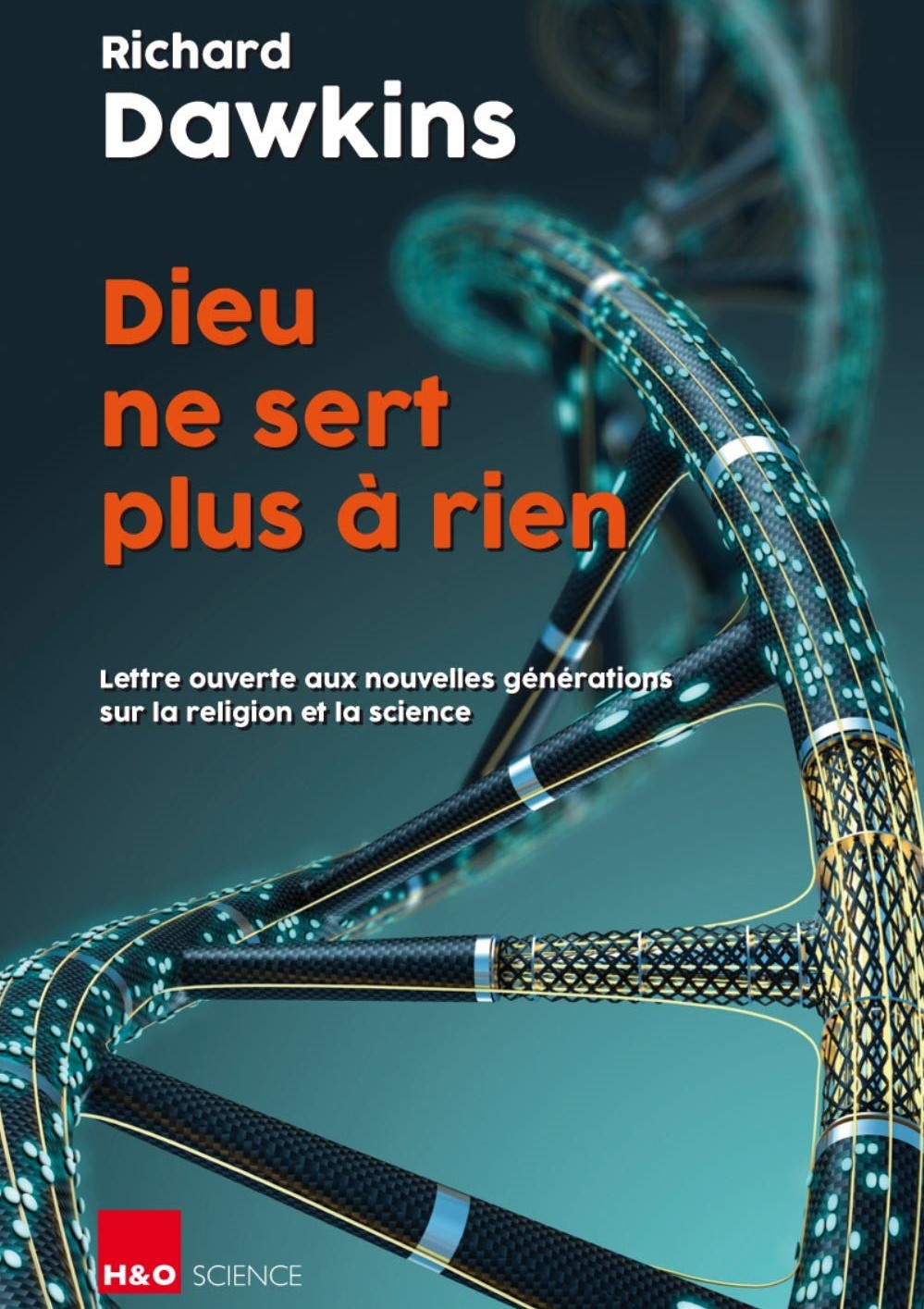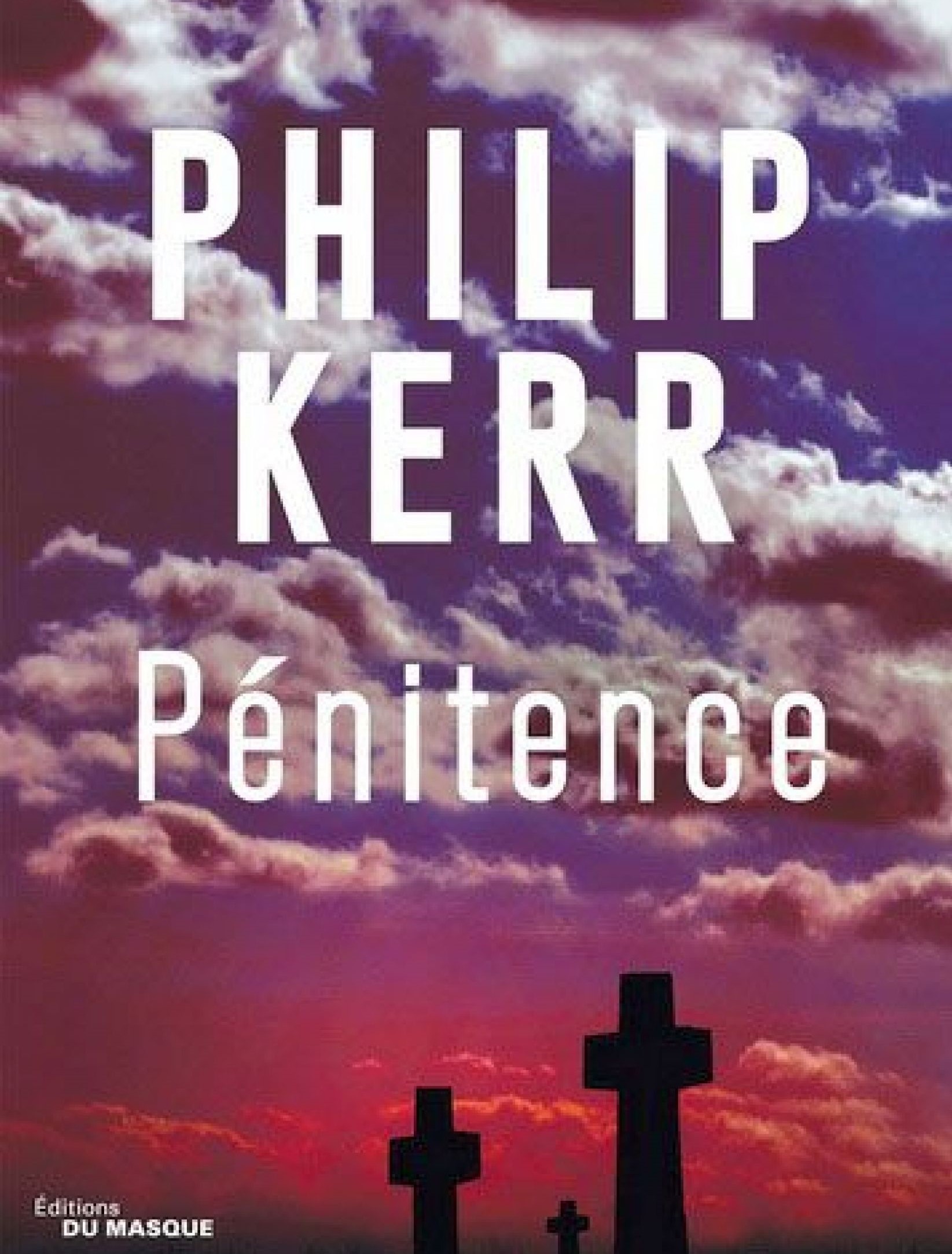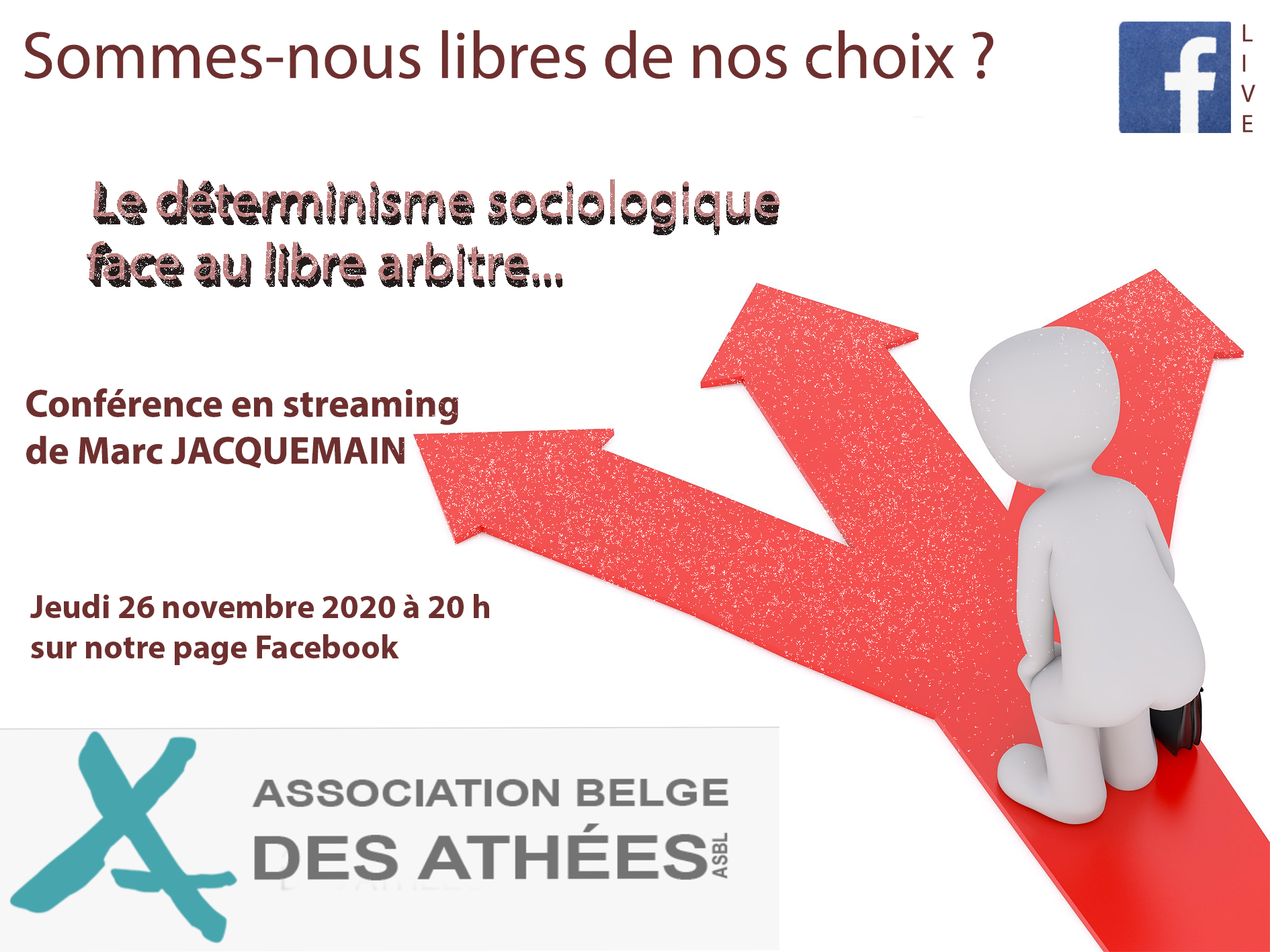Réfléchir avec Dawkins
On vient de publier en français l’ouvrage récent (2019) de Richard Dawkins, Dieu ne sert plus à rien, traduit de l’anglais par Olivier Bosseau (H&O Science, Saint-Martin-de-Londres, France, 2020).
Le sous-titre de ce livre en résume bien le contenu : Lettre ouverte aux
De la prière et de la pénitence
La période de confinement a été riche en questionnements existentiels, du genre qu’est-ce qui vous tient vraiment à cœur, ou à quoi passez-vous votre temps dilaté ? Ma fille m’a proposé un questionnaire littéraire de ce type, sur mes préférences
La Confession romaine de Percy Bysshe Shelley
Dans cette Confession romaine, comme dans les précédentes entrevues fictives, un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens
Sommes-nous libres de nos choix ? (conférence en streaming)
Le déterminisme sociologique face au libre arbitre