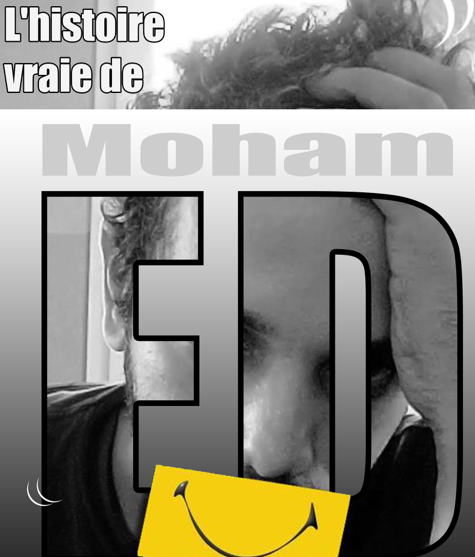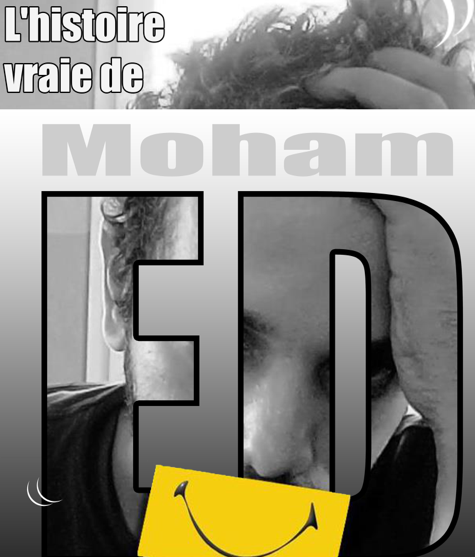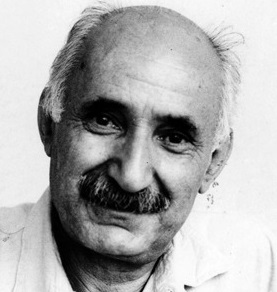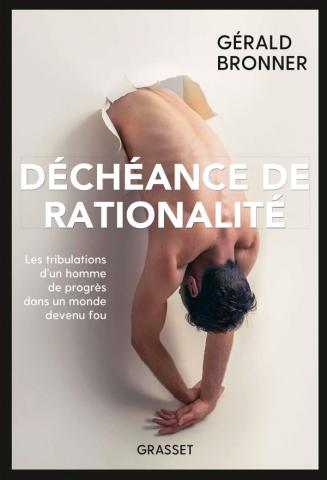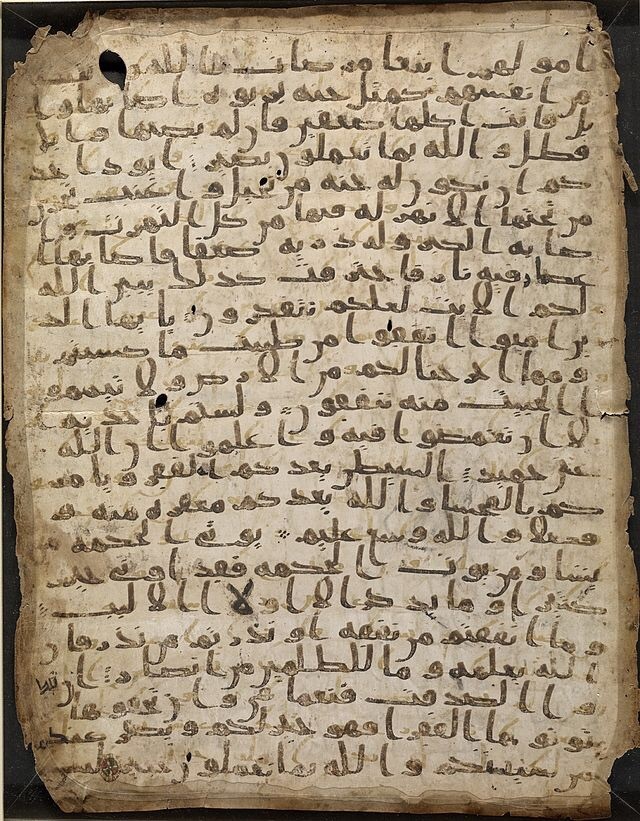La liberté d’expression en islam ou la quête du Graal
Patrice Dartevelle La réputation d’intolérance qui est liée à l’islam, qui empire depuis un demi-siècle, pourrait faire croire que l’ouvrage que l’universitaire Hamadi Redissi a consacré à la question sous le titre S’exprimer librement en islam[1] est un paradoxe. C’est en fait très
L’HISTOIRE VRAIE DE mohamED
Jean-François Jacobs Avertissement Ce récit est un « road trip » » sur le parcours tumultueux d’Ed, un Tunisien qui, pour ne pas perdre la vie, a dû fuir son pays. En voici la seconde partie. Le personnage est réel. J’ai choisi de le faire parler
L’HISTOIRE VRAIE DE mohamED
JF Jacobs AvertissementCe récit est un « road trip » » sur le parcours tumultueux d’Ed, un Tunisien qui, pour ne pas perdre la vie, a dû fuir son pays. En voici la première partie. Le personnage est réel. J’ai choisi de le faire parler à la
Mort et avenir des religions
Entendre parler – dans un docte univers universitaire souvent si prudent – de fin des religions ne peut qu’être sympathique à un athée. Même – sinon surtout insinueront les plus caustiques – chez les anticléricaux, si la difficulté d’imaginer la
Turan Dursun, l’imam turc devenu athée
Au pays d’Atatürk, la laïcité toute relative et fragile du pays a donné naissance à plusieurs générations de citoyens critiques de la religion et ce, malgré le fait que l’islam sunnite y soit érigé en religion d’État et y soit
Déradicaliser, la belle affaire…
La question des personnes radicalisées musulmanes, djihadistes, continue de poser bien des questions. Il y a eu le 11 septembre 2001 à New York, l’État islamique et le califat, l’attentat contre Charlie Hebdo et le Bataclan en 2015, le 22
L’athéisme dans le monde
Quelques précautions sont à prendre avant d’aborder un sujet comme l’athéisme dans le monde. Il va tout d’abord inéluctablement conduire à une avalanche de chiffres, que je vais réduire au nécessaire. Il s’agit toujours de sondages sur les croyances. Ils
Europe et religions. Retournements et enjeux
La question de l’Europe et du christianisme qui lui serait indissolublement lié fait toujours couler de l’encre. Dernière elle, frétille surtout celle de l’impensable pour d’aucuns d’une société sans religion et, à un degré moindre et quelque peu contradictoire, celle
Les enfants d’athées ou de chrétiens sont-ils victimes de discrimination dans les écoles bruxelloises à majorité musulmane ?
Mener sa vie « comme bon nous semble » est plutôt difficile, voire téméraire, quand on n’est pas musulman dans une école à majorité musulmane. Les enfants de chrétiens et les enfants d’athées sont victimes de discriminations, leur conduite est réprouvée et
Le Coran en libre-service
La violence musulmane ou commise par des musulmans au nom de leur foi telle qu’ils l’entendent est au centre des préoccupations non seulement des Européens, mais de bien d’autres, en premier lieu dans les pays à majorité musulmane qui en