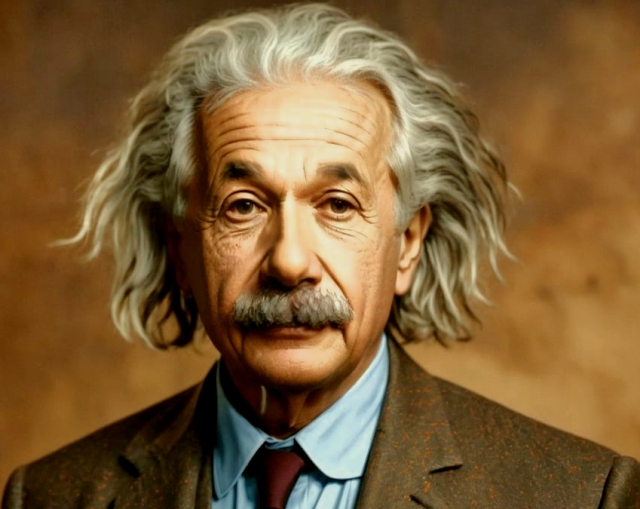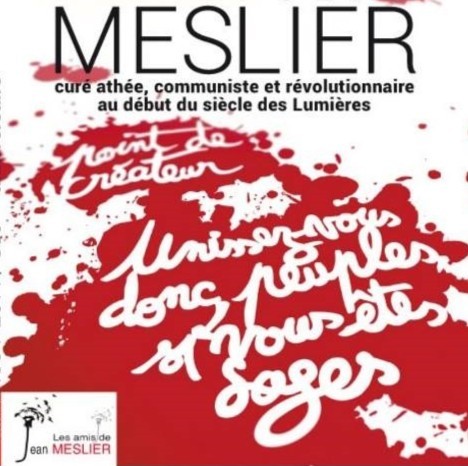La Confession intranquille de Goliarda Sapienza
Marco Valdo M.I.
Dans cette Confession intranquille[1], comme dans les précédentes entrevues fictives [2], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrante ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens de vous faire parler »[3]. On trouve face à l’enquêteur Juste Pape, la suspecte Goliarda Sapienza, née à Catane au pied de l’Etna en Sicile, connue comme comédienne et écrivaine italienne, athée et anarchiste. Pour constituer son dossier, l’Inquisiteur se réfère à son autobiographie[4] ainsi qu’à d’autres livres qui témoignent de sa vie [5].
Bonjour, Madame Sapienza. Je suis Juste Pape, enquêteur de l’Ovraar [6] en mission spéciale. Je voudrais tout d’abord m’assurer que vous êtes bien Goliarda Sapienza, née à Catane et morte à Gaète.
Monsieur l’Inquisiteur, je vous confirme sans hésiter que je suis bien Goliarda Sapienza, tombée du chou par terre à Catane en Sicile, le 10 mai 1924. C’est là que j’ai commencé à ramper et un peu plus tard, à marcher jusqu’à ce que je tombe, mon cœur m’avait lâché, dans l’escalier de la maison où je résidais à Gaète dans le Latium, le 30 août 1996.
Curieux nom, curieux prénom, que vous portez là, Madame Sapienza.
Monsieur l’Inquisiteur, évitez de m’appeler Madame Sapienza. C’est un nom un peu trop emphatique à mon goût et avec l’expérience de toute une vie, je ne suis pas sûre de le mériter. Madame ne me plaît d’ailleurs pas plus ; dites simplement Goliarda ou Madame, si vous voulez. Cela dit, vous avez raison, ce sont d’étranges dénominations et difficiles à porter. J’imagine que vous connaissez leur sens : la sapienza n’est rien d’autre que la sagesse ; pensez, s’appeler Madame Sagesse… Quant à Goliarda, c’est pire encore. Vous savez sans doute ce que furent les goliards, ces moines défroqués qui, devenus étudiants, chantaient des chansons paillardes. Me voilà ainsi avec un prénom qui fait sourire. Le tout donne une idée de ce que j’ai finalement vécu sous cette dénomination qu’on pourrait traduire en français : Paillarde Sagesse. Mais ce prénom de Goliarda me fut aussi lourd à porter du fait du décès de mes deux frères : mon aîné – fils de mon père, Alfio Goliardo est mort noyé à l’âge de quatorze ans en 1921, assassiné par les fascistes ou par la mafia, on ne sait trop. L’autre, mon cadet – Danilo Goliardo, fils de mon père et de ma mère – est mort de maladie en 1928, il avait vécu deux ans et demi. En me donnant cet étrange prénom, peut-être mes parents ont-ils voulu conjurer le destin ou plutôt, les connaissant, ont-ils voulu le contraindre ? Bref, moi, j’ai survécu et je m’y suis faite. Qu’aurais-je pu faire d’autre, d’ailleurs ?
Reprenons, Madame, il me semble que vous aviez là des parents bien singuliers.
Oui, j’ai eu des parents hors norme : ma mère se nommait Maria Giudice et mon père Giuseppe Sapienza (un couple aux noms tout aussi curieux : Marie Juge et Joseph Sagesse). Ma mère, qui me disait « Tu ne dois te soumettre à personne et moins qu’à quiconque à ton père ou à moi », avait été institutrice, militante politique, responsable syndicale et journaliste socialiste importante dans le Nord ; elle fut confinée, déportée pour vingt ans à Catane en Sicile, à l’autre bout de l’Italie par le régime fasciste ; mon père, un avocat aimé des pauvres et détesté des fascistes, mais respecté et craint de tous, était lui aussi un responsable socialiste et ensemble, ils dirigeaient la Chambre du travail de Catane et le journal l’Unione. Ils se relayaient dans ces fonctions : quand l’un d’eux était en prison, l’autre assurait la continuité. Hors norme, ils l’étaient certainement. Une anecdote : c’était sans doute en 1925 – ils étaient à Palerme où ils préparaient la publication du journal, une nuit, les fascistes vinrent pour les assassiner et tirèrent sans interruption pendant dix minutes à travers la porte de leur chambre ; mes parents, qui les avaient entendus venir, s’étaient échappés par la fenêtre. Au matin, devant la maison, les fascistes avaient organisé un simulacre de funérailles de mon père – en musique et le cercueil porté par quatre chemises noires. Quand mon père arriva en riant aux éclats, sa canne épée à la main, les porteurs jetèrent le cercueil sur la rue et tout le cortège funèbre s’enfuit terrorisé. C’est ainsi que mon père a vu de ses yeux son propre enterrement.
Vous étiez une nombreuse famille. Combien étiez-vous ?
Nous étions ce qu’on appelle aujourd’hui une famille recomposée. Ma mère et mon père restèrent ensemble jusqu’à la mort de mon père, même s’ils ne se sont jamais mariés ; comme vous le devinez, c’était assez exceptionnel, scandaleux et en quelque sorte, hérétique dans cet univers fasciste et catholique de l’Italie de l’époque. Mon frère Ivanhoé m’avait toujours dit : « Souviens-toi que tu es la quatrième génération d’athées… ». Quand mes parents se sont établis ensemble à Catane en 1920, ma mère avait six enfants : Josina (1904), Cosetta (1905) ; Licia (1906), Ivanoe (1909), Danilo (1911) et Olga (1913). Son compagnon Carlo Civari était mort à la guerre en 1917. Mon père avait trois fils ; Alfio Goliardo (1907), Libero (1909) et Carlo Marx (1911), nés de son mariage avec Lucia Musumeci, morte en 1915. Pour bien faire, il faudrait ajouter les enfants naturels que mon père avait reconnus et les autres. Deux ans après moi, le couple eut – ensemble – un garçon : Danilo Goliardo, né au début de 1926.
Comme je comprends, dit l’Inquisiteur, vos parents n’étaient pas très catholiques. Vous ont-ils appris Dieu et fait connaître la religion ?
Comme je vous l’ai dit, ma mère Maria et mon père Beppino ( en français : Marie et Joseph) étaient tous deux des socialistes et des athées, des partisans d’un socialisme anarchiste et humaniste et donc, en effet, pas très catholiques dans cette Italie fasciste. Cependant, ma mère, dans un esprit de liberté et pour me préparer au monde environnant, m’incitait à connaître les principales croyances religieuses. Mon goût précoce pour le théâtre et mon habitude de raconter des histoires ont fait qu’au cours des années, je me suis imaginée et mise en scène dans le costume d’une nonne d’un couvent médiéval préparant une crèche pour Noël, d’une houri musulmane dansant pour un émir, d’un Bouddha à la vie d’ascète, d’une Parvati amoureuse de Shiva. C’étaient des récits et des spectacles que j’avais élaborés pour lesquels je requérais l’aide de ma mère et de mes sœurs. J’approchais ainsi les religions ; ce n’était pas une mauvaise façon de le faire. D’ailleurs, pour tout vous dire, dès l’enfance, je voulais être poétesse, comme Sappho, ou alors, pupara ici au féminin, puparo est le nom qu’on utilise en Sicile pour désigner le marionnettiste, ou encore, cantastorie, mot des deux genres – l’aède, le poète récitant, le chanteur d’histoires. Chez nous, je veux dire dans notre famille, tout le monde avait toujours tant à faire. Tant et tant qu’on était contraint soi-même aussi de s’inventer mille choses à faire, à trafiquer, à mener à bien, à lire, à jouer, parce que lire, jouer et imaginer étaient aussi considérés comme un « faire » – en grec, ποιεῖν / poiein, verbe d’où dérive « poésie ». Du reste, j’étais véritablement une Sapienza, la fille de « l’avocat », mais comme Sapienza, j’étais en même temps une petite-fille de cordonniers, eux-mêmes enfants et petits-enfants d’on ne sait trop quelle sorte, de gens venus d’ailleurs, dont on ne comprenait pas bien s’ils étaient turcs ou grecs, de vendeurs ambulants, trafiquants, petits voleurs débarqués du Levant, des Levantins…
Ah, demande l’Inquisiteur, vous appreniez les religions par le spectacle, en les mettant en scène ? Vous souvenez-vous de comment vous vous représentiez la religion chrétienne ? Comment voyiez-vous alors Jésus-Christ ?
Jésus-Christ, Monsieur l’Inquisiteur ? Je l’avais rencontré à l’hôpital, où je séjournais pour soigner la tuberculose qui me rongeait ; une religieuse m’en avait parlé et m’avait emmenée à la chapelle pour me le montrer. C’était un monsieur aux cheveux blonds, avec une barbe blonde et un manteau bleu ciel – et, chose étrange, il tenait un cœur à la main. De retour à la maison, pour le servir, je fis un petit autel, avec une photo de lui, avec bien entendu le cœur sur la main, car je ne pouvais le penser autrement. Je mis à côté de lui les photos de ses amis et collaborateurs. Saint Paul, etc. Ils étaient douze. J’allumai des bougies, je mis des fleurs, je m’agenouillai en pensant à lui… Je le fixai tellement que je le vis se détacher de la photo et venir vers moi toujours avec son cœur dans la main. La foi est pleine de mystère, n’est-ce pas ?
Vous l’avez rencontré, lui, le Christ ? C’est un miracle.
Oui, Monsieur l’Inquisiteur, ce Jésus-Christ, je l’ai vraiment rencontré, je l’ai vu venir vers moi avec son cœur à la main, il souriait. Était-ce un miracle ? Je ne le pense pas. La seule chose certaine, c’est que j’en ai le souvenir, mais c’est un souvenir d’enfant ; depuis, je ne l’ai plus jamais revu.
Que me dites-vous, Madame, du mystère, je veux parler de ce mystère de la vie, ce mystère qui se trouve dans la foi ?
Bien sûr, le mystère… Il faut du temps pour que se développe le mystère de la vie, qui est l’aura du destin. Chacun a son destin. Ce que j’en sais, c’est que – comme me l’a dit une fois le Commendatore Insanguine[7], chez qui quand j’étais encore une enfant de pas même dix ans, j’allais apprendre à faire des marionnettes – moi, je suis destinée au futur, à des entreprises, des arts différents et, véritablement, ma vie s’est déroulée ainsi dans ce mystère tel que l’avait annoncé le Commendatore. En ce qui me concerne, pour le mystère, il n’y a jamais eu besoin d’une foi, d’une religion, d’un Dieu ; le mystère était là au cœur de la vie. Voyez-vous, je suis née dans le mystère et le bouleversement des choses à l’époque où les automobiles sont apparues et filaient par les rues étroites, quand le ciel avait été blessé par les ailes impitoyables des aéroplanes, quand on faisait soleil la nuit en tournant un interrupteur… C’était insolite, c’était l’émerveillement. Le monde était soudain plein de mystères et puis, après un moment, on s’y accoutumait. Quant à l’au-delà, je vous dirai ce que ma mère m’a dit quelques mois avant de mourir d’une très longue agonie : « Pourquoi parlent-ils de paradis et d’enfer ? Comme ils sont bêtes. Mon paradis est ici… »
Et Dieu donc, Madame, vous paraît inutile ?
On pourrait le dire ainsi, Monsieur l’Inquisiteur, que Dieu est inutile ou alors, qu’il est improbable. Comme disaient Ivanoe, Carlo, mon père, tout le monde chez nous – c’est la seule chose sur laquelle tous ont toujours été d’accord – Dieu est mort et il a emporté avec lui dans sa tombe tous les diables du monde. Moi, je pense qu’il n’a même jamais existé. Et puis, votre Église, pour ne parler que d’elle, est une « toursiveuse », comme dirait un de mes amis, une rusée, une vieille entremetteuse espiègle. À ce sujet, je vous cite un passage de mon Art de la Joie, où Modesta, alias Mody, mon double littéraire comme vous l’avez sûrement déjà appris, s’exprime à ce propos en répondant à Carlo :
« CARLO : Oh, Mody, je t’ai apporté le livre d’un certain Pierre Daco, un prêtre de merde, comme dirait Nina. Regarde : Qu’est-ce que la psychanalyse ? Je l’ai lu toute la journée d’hier, ce bâtard en fait du christianisme, je n’en croyais pas mes yeux.
MODESTA : Et tu m’étonnes ? D’ici peu nous aurons aussi un matérialisme chrétien. Ces gens-là ne sont pas nés de la dernière pluie, comme dirait Nina. »[8]
Au fait, Monsieur l’Inquisiteur, il vous intéressera sans doute de savoir que dans sa première édition en italien, L’arte della gioia avait comme sous-titre : « roman anticlérical »[9].
Mais, Madame, si vous avez été à l’école à Catane, en Sicile, vers 1930, sous le régime fasciste, vous avez reçu le catéchisme.
En effet, Monsieur l’Inquisiteur, tout ça est exact. Mais à l’école, je ne suis pas allée longtemps ; à cette école-là, car, j’ai dû la quitter, mais j’ai eu l’école à la maison et aussi chez le professeur Isaya, un ami de mon père. Donc, un temps, j’ai été à l’école. Là, un prêtre nous enseignait le catéchisme. J’ai dit qu’il avait tout l’air d’« une seringue qui injectait la drogue de la religion ». Une de mes condisciples a entendu ma réflexion et l’a répercutée. Ce fut un scandale ; on m’a tenue à l’écart comme une pestiférée. Mon père m’a retirée de cet enfer et ensemble, sur la terrasse de la maison, on a brûlé mon uniforme de « Piccola italiana », obligatoire pour les filles à l’école. Je n’en avais plus besoin. Maintenant que j’y songe, il est vrai qu’enfant, j’ai eu un côté religieux et ce côté religieux m’amenait à prier devant l’olivier sarrasin, un dieu aussi vieux que le monde ou devant une pierre qui m’évoquait une sainte, un ange, une colombe, une mouette. Ces roches, ces arbres, m’apparaissaient comme des divinités. D’autres fois, je rêvais d’aller dans un couvent et je me disais : « Bienheureux, ces mystiques qui peuvent choisir les chemins de la solitude et de la prière ! » Je me disais : « Ah, si je pouvais croire en Dieu ! » J’ai dû garder quelque chose de cette religiosité au long de ma vie, car on m’a souvent appelée une religieuse laïque.
Si vous n’êtes pas catholique, comment vous qualifiez-vous ?
Ma réponse est d’abord matérialiste, comme Épicure et compagnie. On naît matérialiste, voyez-vous Monsieur l’Inquisiteur. C’est en quelque sorte dans le sang ; on naît matérialiste, comme on naît anarchiste. Moi, je suis née les deux. Mais c’est assez difficile, cette grande liberté de soi-même et de ses propres pensées. Imaginez, j’ai grandi dans l’Italie fasciste. Croyez-moi, en ce temps-là, comme enfant, il était plus facile d’être un de ces petits insectes bien dressés et bardés de certitudes qui défilent dans les parades tout tirés à quatre épingles, les filles dans leurs jupes noires plissées et chemisettes blanches et ne plus penser à rien. Oh, le rêve de tout déléguer à un Père ou à un Dieu ! Mais mon uniforme de « petite Italienne » – celui des filles de 8 à 14 ans embrigadées dans l’organisation de jeunesse fasciste féminine[10] – a été brûlé et de ses cendres, mon matérialisme est ressorti pur et sans tache.
Et notre Sainte Mère l’Église ?
L’Église, les prêtres, Monsieur l’Inquisiteur ? Voici un florilège familial à leur sujet. Mon père qu’on avait envoyé au séminaire pour qu’il fasse des études, n’y est pas resté quand il s’est aperçu « de quelle engeance de cochons de voleurs de pain qu’ils mangent sont les prêtres. » Il le disait comme ça. Et mon oncle Nunzio ajoutait : « les prêtres sont des à moitié femmes avec des jupes sales. »
Donc, vous situez votre foi dans la vie, mais, dit l’Inquisiteur, la foi et la vie n’est-ce pas la même chose ?
La foi dans la vie ? Quelle question ! La foi et la vie, la même chose ! Drôle d’idée, Monsieur l’Inquisiteur. Pour moi, la foi est plus proche de la folie. La vie a quand même sa part de raison ; elle en fait usage. La vie, ça va, ça vient ; elle est difficile, elle porte la joie et la souffrance. Elle m’a appris qu’elle est raison et folie. On y tient, on n’y tient plus, on y croit, on veut la quitter, on y revient. Jusqu’au bout, elle vous tient, elle vous mène. Une fois commencée, la vie est ou alors, elle n’est plus. Donc, elle continue obstinément jusqu’au bout ; non, tout compte fait, il n’y a pas besoin d’inventer une foi dans la vie.
Vous avez, dit l’Inquisiteur, traversé des épisodes de folie, vous avez frôlé la mort, n’avez-vous pas alors appelé Dieu, cherché la foi ?
Foi et folie ont un même goût, un même arrière-goût, c’est presque le même mot. Ces épisodes dont vous parlez… Ce furent des moments terribles. Moi, je voulais seulement dormir. Soudain, je me réveillais en joie et cette joie, je la prenais étroitement dans mes bras et je me remettais à marcher. Quand et pourquoi j’aurais appelé Dieu ? Et que faire de la foi ?
Et, dit l’Inquisiteur, votre rapport au monde, votre incarnation dans la vie, comment la voyez-vous ?
D’abord, Monsieur l’Inquisiteur, il faut savoir vivre avec soi-même et c’est un apprentissage. Il faut arriver à se reconnaître, à se situer parmi tous ces autres. C’est un jeu d’essais et d’erreurs, de hasard et de nécessité. Ça dépend aussi où on est tombé du chou. Il y a les circonstances. Moi par exemple, aux yeux de la loi, je suis une enfant « naturelle » et mes parents ont dû me reconnaître, car ils n’étaient pas mariés. On était en Sicile, sous le fascisme et moi, j’avais des frères qui n’étaient pas mes frères, j’avais des sœurs naturelles dans le quartier et même, plus tard, dans la maison. Dans la maison Sapienza, précisément, j’étais dans leur monde, celui de mes parents, celui de la famille. Moi, je voulais construire le mien. Plus tard dans ma vie, j’ai cru y arriver en incarnant des personnages. J’ai été comédienne au théâtre, au cinéma. Finalement, j’ai laissé tomber. Belle expression que la vôtre que cette « incarnation dans la vie ». Elle me plaît, je l’aime beaucoup, mais s’incarner dans des personnages, c’est se perdre, c’est perdre ses propres traces. Pourtant, j’étais douée, j’avais du succès, j’avais de la personnalité, mais je me diluais. Laissons de côté ma vie personnelle chaotique, mais quelle chose merveilleuse est un travail qui vous plaît ! En fait, après bien des errements, j’ai compris que je voulais m’incarner en moi-même et que seule l’écriture offrait cette voie. Je l’ai prise et je l’ai suivie jusqu’à la fin. J’ai continué à la parcourir, même si de mon vivant, je n’ai jamais pu faire publier mon œuvre principale, celle qui m’avait pris tant de ma vie : L’Art de la Joie[11]. J’avais achevé ce roman en octobre 1976 ; il a enfin pu être publié en partie quelques mois après ma mort en 1994 et il n’est revenu en Italie pour une édition intégrale qu’en 1998, édition dont la diffusion resta limitée. Il ne connut son édition de grande diffusion qu’en 2008 et certainement grâce au fait d’avoir été connu et reconnu à l’étranger au travers de ses traductions.
Et l’âme, Madame ?, demande l’Inquisiteur.
L’esprit, voulez-vous dire, Monsieur l’Inquisiteur ? Vous voyez, il faut en revenir aux vieux païens. Pour ceux qui croient en Dieu et l’appellent l’âme, l’esprit se trouve dans la poitrine. Ma mère, Maria, qui disait « Dans cinquante ans, on ne parlera plus de Dieu… » et qui ajoutait que sur les calendriers à la place des saints, on mettrait les noms de Marie Curie, de Louis Pasteur, des vrais bienfaiteurs de l’humanité, situait l’esprit dans la tête, dans l’intelligence. Pour moi, l’esprit se trouve dans le sang, celui qui bat dans le cœur, qui cogne au front ; c’est le mouvement qui maintient le corps en vie. L’esprit ne saurait être détaché du corps. Tout ce qui bouge est vivant. Ce qui s’arrête, s’arrête et meurt. Après cinquante ans dans les bras de la terre, le corps recommence à bouger, il devient engrais et nourrit les plantes, les arbres et alors, reviennent les fruits. La boucle est bouclée. Ainsi, il vaut la peine de cultiver son jardin. Rien de ce qui est vivant ne se perd. Pareil pour les cendres qui vont jusqu’à faire des montagnes aussi hautes que l’Etna. L’esprit se transmet durant la vie par les yeux, la parole. Avec et au travers de l’art et l’écrit, il perdure au-delà de la vie individuelle.
Et la mort, comment la voyez-vous ?, demande l’Inquisiteur.
D’abord, Monsieur l’Inquisiteur, je vous parlerai de la mort de mon père, l’avocat athée Giuseppe Sapienza. Il est mort à Palerme, dans un lit, d’une crise cardiaque, dans les bras d’une jeune dame de sa connaissance ; une jolie dame, au demeurant. Ils rentraient d’une soirée au théâtre. Pourquoi pleurer pour lui ? Il est mort comme il le voulait. Ce qui l’effrayait le plus et ce à quoi il a échappé ainsi, c’était de finir à petit feu, paralysé des années comme son frère Giovanni. D’ailleurs, il savait qu’il n’en avait plus pour longtemps, le médecin l’avait averti. Il a continué à vivre à sa mode ; c’était un homme d’action et de fait, il est mort en pleine action. Une dernière chose à ce propos. À ses funérailles, l’officiel a dit qu’une de nos cousines était à ses côtés. Une cousine ? Dans son lit ? Pourquoi pas ? Allez savoir jusqu’où s’étend le cousinage. En Sicile, on est tous plus ou moins cousins, donc, une cousine, mais ce n’était pas une prude cousine ; non, c’était une belle fille, une très belle blonde. Ils ont voulu l’écarter de la cérémonie. En grand deuil, elle pleurait comme un veau. Je l’ai prise par le bras et je l’ai amenée jusqu’auprès du cercueil. C’était quand même la dernière à l’avoir vu et touché vivant. Les obsèques de Peppino Sapienza eurent lieu à Catane ; ce furent évidemment des obsèques laïques ; il y avait une foule de gens ; beaucoup de ces petites gens de Catane. Le prêtre est venu chez nous demander qu’on arrête le cortège funèbre à son église pour une bénédiction ; un de mes frères, sans doute Carlo, l’a foutu à la porte de la maison.
La mort, je veux dire, la vôtre ; en aviez-vous peur ?, demande l’Inquisiteur. Ne craigniez-vous pas ce qui pouvait se passer après ?
Peur de la mort ? Non, Monsieur l’Inquisiteur et pourquoi donc ? Face à la mort, j’ai la sérénité athée. J’ai compté les années et réalisé à quel point est court le temps que notre mère nature nous concède. Il y a toujours quelque chose, des choses, des gens et à la fenêtre, on voit le temps filer en route vers la mort. J’ai été obsédée par ces heures qui fondent au soleil comme des méduses abandonnées sur la plage et j’ai craint de mourir. J’avais trouvé l’écriture pour retenir le temps et je m’y étais plongée. Craindre de mourir, oui ; mourir peut être un passage douloureux, horrible et difficile. Mais craindre la mort, non ! Pourquoi aussi, aurais-je dû avoir peur de ce qui aurait pu arriver après ce passage vers le néant ? Après ? Où ça ? Après ma mort ? Moi, morte, je n’aurais rien pu savoir du monde où des vivants continuaient à vivre leurs aventures, et plus encore, je n’aurais rien à y faire. C’était devenu le monde des autres, il ne me concernait plus. Et pour moi, à ce moment, j’aurais cessé de vivre, c’est-à-dire de sentir, de ressentir, de penser ; bref, je n’aurais plus rien su de rien. Et pourquoi donc, aurais-je dû m’en soucier ? D’ailleurs, je suis morte comme je l’espérais, d’un coup, foudroyée par la Certa[12], l’inévitable, la certaine, celle qui à coup sûr vient vous chercher. Elle m’attendait dans l’escalier. Comme je ne donnais plus signe de vie depuis trois jours ; les gens se sont inquiétés. On m’a retrouvée inanimée au bas des marches à l’intérieur de la maison. Voilà tout. J’avais vécu soixante-deux ans, point final. Pour le reste, je vous demande seulement ceci : ne cherchez pas à vous expliquer ma mort, ne la disséquez pas, ne la cataloguez pas, mais pensez en vous-même : elle est morte parce qu’elle a vécu. À présent, je vous laisse. Je voudrais me taire et m’en aller jouer avec la terre et avec mon corps. Au revoir.
Eh bien, dit l’Inquisiteur, il ne me reste qu’à refermer mon dossier et à clore mon enquête. Décidément oui, vous aussi, Madame Goliarda Sapienza, vous êtes athée comme votre mère, votre père et toute votre sainte famille.
[1] Intranquille : le terme « intranquille » est un néologisme importé ici en langue française à partir du portugais et spécifiquement de l’œuvre de Fernando Pessoa – Le Livre de l’Intranquillité – Christian Bourgois, éditeur, Paris, 1988 (Livro do Desassossego composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa – 1982). Le terme s’applique particulièrement bien à la vie chaotique et multiple de Goliarda Sapienza.
[2] Carlo Levi, Raoul Vaneigem, Clovis Trouille, Isaac Asimov, Jean-Sébastien Bach, Bernardino Telesio, Mark Twain, Satan, Michel Bakounine, Dario Fo, Hypatie, Cami, Dieu le Père, Émilie du Châtelet, Percy Byssche Shelley, James Morrow, Denis Diderot, Louise Michel, Jean Meslier, Alexandre Zinoviev, Edgar Morin, Savinien Cyrano de Bergerac, Jean-Paul Sartre, Terry Pratchett, Marie Curie, Charles Darwin, Jésus, Giordano Bruno, Voltairine de Cleyre, Jacques Monod, Till Ulenspiegel, Simone Veil
[3] Francis Blanche, in Babette s’en va-t-en guerre (1959).
[4] Goliarda Sapienza, Le Fil d’une Vie – Récit autobiographique, traduction de Nathalie Castagné, Viviane Hamy, Paris, 2008, 345 p.
[5] Autres livres où Goliarda Sapienza parle de sa vie :
Goliarda Sapienza, Moi, Jean Gabin, traduction de Nathalie Castagné, Attila, Le Rayol – Paris, 2012, 174 p.
et son roman
Goliarda Sapienza, L’Art de la Joie, roman, traduction de Nathalie Castagné, Viviane Hamy, Paris, 2005, Éditions Pocket, 837 p.
Angelo Maria Pellegrino, Goliarda Sapienza, telle que je l’ai connue, traduction de Nathalie Castagné, Le Tripode – Le Rayol – Paris, 2015, 62 p.
[6] OVRAAR : voir note dans Carlo Levi.
[7] Commendatore Insanguine : Commendatore Insanguine alias Antonino Insanguine, (1898-1985), Don Nino, fils de Don Peppino, fonde un théâtre d’acteurs dans la via Grassi, théâtre qu’il appelle Savoia, comme celui de son père. En 1925, il ouvre son premier théâtre de marionnettes. Il construit tout lui-même, des marionnettes aux affiches et aux scènes, et écrit de nombreux scénarios. Il ferme son théâtre de la Via Tipografo à Catane en 1960 et ouvre un commerce pour assurer la subsistance familiale. Cependant, il n’arrête pas pour autant son activité artistique. En 1968, il présente un spectacle mémorable au Théâtre Métropolitain de Catane. Ses marionnettes sont reconnaissables entre toutes : elles ont une carrure massive, un visage large et ensoleillé, et leur armure est souvent sertie de pierres semi-précieuses. Aucun de ses enfants, selon sa volonté expresse, ne l’a suivi dans son art. Une grande partie du matériel et des documents de Don Nino Insanguine est exposée à Via San Giuseppe al Duomo 26, Catania, Museo della Marionettistica di Nino Insanguine.
[8] Goliarda Sapienza, in L’art de la Joie, op.cit., p.793
[9] Goliarda Sapienza, L’arte della gioia (chap. 1-39 : première partie), Rome, Stampa Alternativa, 1994.
[10] Piccole italiane (Petites Italiennes) était une organisation fasciste à laquelle les jeunes filles italiennes âgées de 8 à 14 ans, qui plus jeunes faisaient partie des Figlie della Lupa (Filles de la Louve), étaient obligatoirement inscrites. Plus tard, l’organisation des Giovani italiane (Jeunes Italiennes) fut l’équivalent féminin de l’Opera Nazionale Balilla.
[11] Goliarda Sapienza, L’arte della gioia, Roma, Stampa Alternativa, 1998 ; mais c’est surtout l’édition Einaudi, Torino, 2008 qui la fit connaître et reconnaître.
[12] La Certa : une dénomination populaire pour désigner la Mort. Littéralement, la Certaine.
Post a Comment
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.